Résultats de recherche pour “Baloo” 181 à 210 (223)
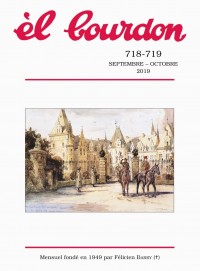
Dans les rues de Charleroi , on rencontrait des soldats français, des Russes, des Italiens, des Anglais, anciens prisonniers lâchés par les Allemands. J’ai ramené…

INTRODUCTION: La vie et ses limites
Le 13 novembre 2020 , on enregistrait 1 338 100 morts du COVID. Si nous n’avions lancé notre appel dès 2019, l’actualité nous aurait…

Littératures fantastiques. Belgique, terre de l’étrange : tome 1 (1830-1887)
On a souvent évoqué l'existence d'une « tradition » fantastique…
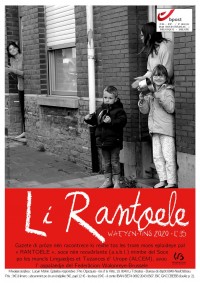
Atlas sonore de la quarantaine
Le confinement ne se prête guère à la linguistique de terrain. Pour des langues minorisées comme le wallon, dont les locuteurs sont le plus souvent pensionnés, seules quelques enquêtes…
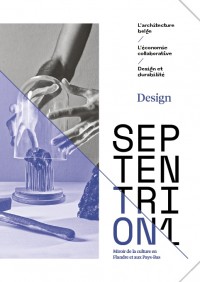
La création durable et circulaire va beaucoup plus loin que le recyclage et la réduction des dégâts environnementaux. Nous devons opérer une transition vers une économie circulaire. Avec une manière de produire et de consommer qui n’épuise pas les ressources rares de la terre, basée sur l’énergie renouvelable et mettant en œuvre des cycles fermés, sans déchets. Les designers jouent un rôle important en la matière. Par l’invention de nouveaux produits et services, et le choix des matériaux. Et en faisant en sorte que les produits durent plus longtemps, soient plus facilement réparables et recyclables. La nouvelle génération se consacre corps et âme à cette mission. Les Pays-Bas se situent à l’avant-garde, mais le courant est également perceptible en Belgique et en France. * Emma van der Leest (° 1991) fait produire des matières présentant des similitudes avec les textiles et le cuir par des bactéries, et en trouve d’autres dans le port de Rotterdam pour colorer ces substances de manière naturelle. En collaboration avec un biologiste et avec des chercheurs d’un centre médical universitaire, elle étudie la possibilité de faire produire un revêtement imperméable naturel par certaines moisissures. Au cours de sa formation de conceptrice de produits à la Willem de Kooning-academie de Rotterdam, Van der Leest s’est spécialisée en biodesign: l’utilisation de micro-organismes comme source d’inspiration, comme élément constructif ou comme base d’un produit complet. Elle travaille aujourd’hui en free-lance, enseigne à la Design Academy Eindhoven et effectue des recherches dans le cadre du Biobased Art & Design lectoraat, une coopération entre la Willem de Kooning-academie, TU Delft (université de technologie) et l’Avans Hogeschool de Breda. Elle a également fondé le BlueCity Lab à Rotterdam, un lieu de travail où scientifiques, designers, artistes, étudiants et entrepreneurs peuvent à leur gré expérimenter de nouveaux matériaux et produits conçus à partir de micro-organismes. Jalila Essaïdi (° 1980), artiste formée à l’université de Leyde, avec une spécialisation en bio-art, a fait parler d’elle dans le monde entier avec une peau capable d’amortir, voire même d’arrêter des balles. Une combinaison de tissu humain et de soie d’araignée, produite par des micro-organismes génétiquement modifiés. Plus tard, elle a capté à nouveau l’attention des médias avec un textile fabriqué à partir de bouse de vache. Il y a un an et demi, elle a ouvert à Eindhoven le BioArt Lab, où l’on s’emploie à résoudre des problèmes sociétaux en combinant nature et technologie. Pratique et pragmatique Van Leest et Essaïdi sont exemplaires des développements dans le domaine du design durable et circulaire aux Pays-Bas. Les concepteurs de la nouvelle génération font s’estomper complètement les frontières entre science, technologie, design et art. Ils collaborent de préférence avec des gens de toutes provenances, dans des réseaux ouverts, de manière à réunir autant de connaissances et de compétences que possible. Et ils ont une mission : contribuer à un monde meilleur, si possible avec un effet concret. Ils veulent offrir des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, que ce soit dans le domaine de l’écologie, de l’économie ou de la vie en société. Ils ne puisent pas leur inspiration dans de grands idéaux ou des perspectives politiques, mais sont pratiques et pragmatiques. Pleins d’ardeur, les créateurs de la nouvelle génération s’attaquent aux problèmes et, tout en expérimentant, ils se lancent avec enthousiasme à la recherche d’un produit, d’un procédé ou d’un matériau innovants. Dans cette quête, la nature offre de l’inspiration en abondance, nulle part ailleurs on ne trouve plus beaux exemples de bouclage de cycles écologiques. Les vieux métiers et les techniques et méthodes traditionnelles de travail suscitent un regain considérable d’intérêt, car la nature y est souvent habilement utilisée. Cette tendance est internationale et observable en de nombreux endroits. «On ne conçoit plus sans penser à la durabilité. Ce ne sont plus des matières diverses mais des idées et des solutions (durables) qui ont pris le dessus», a écrit Tracy Metz, journaliste et auteur américano-néerlandaise en avril 2018 en introduction à un article sur le Salone del Mobile de Milan, le plus important événement au monde - par la taille et l’influence - dans le domaine du design. Avec un clin d’œil Les Pays-Bas peuvent certainement revendiquer une place de premier plan dans ce domaine. Ce fut Piet Hein Eek qui, diplômé de la Design Academy Eindhoven, lança en 1990 une armoire en morceaux de planches de bois de récupération. Un manifeste pour l’artisanat et la conscience environnementale comme contrepoids au design bien trop léché, à ses yeux sans âme, qui donnait le ton à cette époque. Des contemporains comme Richard Hutten, Hella Jongerius et Marcel Wanders l’accompagnèrent dans cette voie, et ainsi se développa lentement le mouvement qu’on appela Dutch Design et qu’on qualifia de minimaliste, expérimental, innovateur, peu conventionnel et doté du sens de l’humour. En suivant l’enseignement de design industriel, davantage tourné vers l’entreprise, de l’Université de technologie de la TU Delft, l’étudiante Conny Bakker fut, au début des années 1990, étroitement impliquée dans la mise en place du réseau d’écodesign O2, devenu mondial depuis. Par la suite, elle soutint une thèse sur les informations environnementales pour les concepteurs. «Au début du processus de conception, les créateurs tâtonnent trop. Il leur manque l’outillage pour s’attaquer correctement au sujet. Il faut disposer d’un point d’appui pour développer une combinaison produit/marché pour le long terme. Imaginez : avec toutes ces discussions sur l’émission de dioxyde de carbone, on peut parier que la législation se fera attendre cinq ou dix ans. Si dès maintenant on anticipe là-dessus, on peut prendre un formidable avantage concurrentiel», a-t-elle déclaré en 1995 (!) dans une interview relative à sa soutenance de thèse. En 2017, Conny Bakker a été nommée professeur ordinaire de méthodologie de conception pour la durabilité et l’économie circulaire à la TU Delft. Matelas recyclable Après une première vague d’intérêt pour l’environnement et le développement durable dans les années 1990, incluant assurément le secteur manufacturier, une deuxième vague se dessine maintenant. De même que les lycéens descendent en nombre croissant dans la rue et en des lieux multiples pour faire entendre leur voix sur les problèmes climatiques, de jeunes concepteurs imaginatifs de plus en plus nombreux se manifestent avec des idées et des concepts parfois radicaux, qui peuvent contribuer à l’économie durable et circulaire. Tracy Metz l’a constaté à Milan, mais cette tendance est visible aussi lors de la Dutch Design Week à Eindhoven, qui accueille chaque année 350 000 visiteurs. Un échantillon de l’édition d’octobre 2019. Ontwerpbureau Niaga (again lu à l’envers) a développé, en collaboration avec DSM, un tapis composé d’une seule matière - du polyester - et par conséquent complètement recyclable. Et avec Auping, un premier matelas recyclable. Pour l’entreprise de traitement des déchets Renewi, qui transforme déjà près des deux tiers des ordures collectées en nouvelles matières premières, les étudiants de la Design Academy Eindhoven se penchent sur les résidus qui, à l’heure actuelle, vont directement à l’incinérateur. Pourquoi ne fait-on pas de baskets à partir de vieux pneus, lança l’un de ces pionniers. Et même des cendres des incinérateurs, on peut encore tirer des minéraux et des matériaux utiles, d’autres l’ont montré. Le musée d’art moderne Van Abbe à Eindhoven a participé lui aussi et offert une estrade à des concepteurs…

Dans La Wallonie, le pays et les hommes , section Lettres – Arts – Culture, t. II, Marcel Thiry a rédigé plusieurs articles très intéressants sur divers…
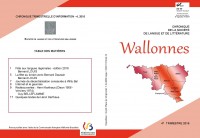
Wallonnes - 4 - 2016 - 4e trimestre 2016
Sommaire • Quelques textes de Henri Karthaus (Dison 1906 - Verviers 1974) par Guy Belleflamme • Fête aux langues régionales - édition 2016 Bernard Louis…
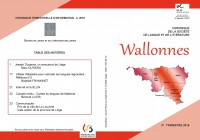
Utiliser Wikipédia pour valoriser les langues régionales. Réflexion
On a beaucoup critiqué Wikipédia. Dès sa création,…
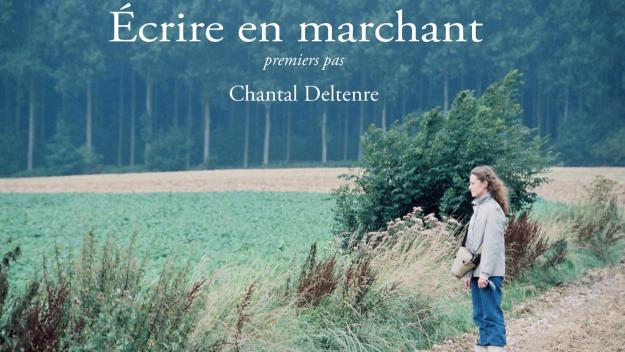
Écrire en marchant. Premiers pas
Deux événements minuscules se produisent à ce moment-là. Une mouche, soudain piégée au cordon de glu qui pend du lustre au-dessus de…
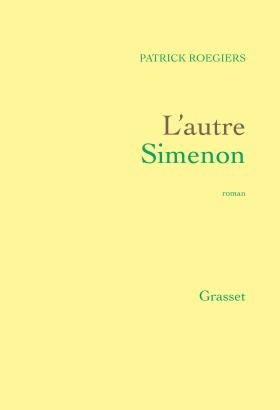
Dans l’Autre Simenon Patrick Roegiers convoque la figure de Christian Simenon, frère de l’écrivain Georges Simenon, pour éclairer à la fois les circonstances d’une époque noire, la Deuxième…
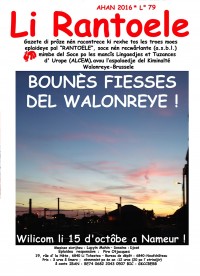
Di davance et d’ ouy. Côps d’ cour, côps d’ betch
Fåt i croere li « Canard enchainé » do 18 di nôvimbe 2015 ki rapoite on pretchmint…
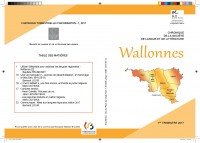
Wallonnes - 1 - 2017 - 1er trimestre 2017
Sommaire • Fête aux langues régionales, édition 2017 par Bernard Louis • Utiliser Wikipédia pour valoriser les langues régionales -Réflexion [2]…

Patrimoine : Norge le proférateur
Dans les années 1970-1980, une opinion est fort répandue en Belgique francophone : nos trois plus grands poètes vivants sont Marcel Thiry,…
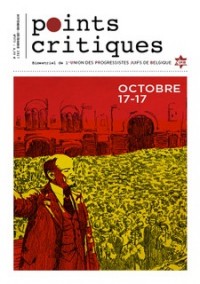
Années 30, le temps de la terreur
Parmi les victimes du stalinisme, les poètes, romanciers, peintres, hommes de théâtre occupent une place de choix. Au pire, exécutés,…
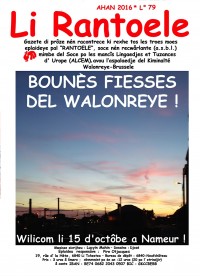
Li Rantoele - 79 - ahan 2016 - Li Rantoele - ahan 2016
Sommaire • Ratacaedje. Bounès fiesses, todi ! par Lucien Mahin , Christian Thirion • Di davance et d’ ouy. Côps d’…
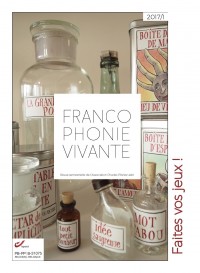
Francophonie vivante - 1 - 2017 - Faites vos jeux !
Sommaire • Editorial par Jérémy Lambert , François-Xavier Lavenne , Laurence Pieropan • Le jeu de Colin-Maillard par Michel Arnold…

Entretien avec Eduardo Halfón (3) – Genèses d’une œuvre
En mars 2015, Maxime Hanchir a rencontré à plusieurs reprises l’auteur…

Le recueil réunit trente nouvelles relativement courtes qui ont pour point commun une inclination irrépressible pour le ludique.…

Èl vî ome atôche XX sès mwins Ô, mès mwins qui sʼin vont, qui sʼ pièdʼneut come in richot dins lʼ sâbe... Pouqwè vos-in-daléz ? Djʼé co tant dandji…
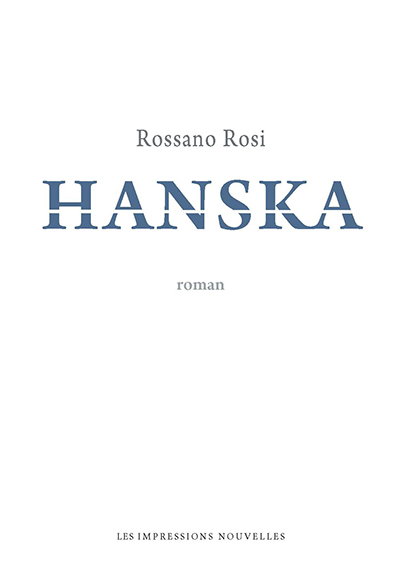
Hanska – la condition humaine en abyme
Hanska , le sixième roman de Rossano Rosi, a des allures de matriochkas, ces poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres, mais de manière si…

14-18, un passé entre front guerrier et zones occupées
DES AUTEURS N'AYANT PAS CONNU LA GRANDE GUERRE SE SONT PENCHÉS SUR CETTE EFFROYABLE…

Thilde Barboni: Sciences en bandes dessinées
Quelles sont les sciences évoquées par Thilde Barboni * , et quelle est leur place dans les intrigues de ses…
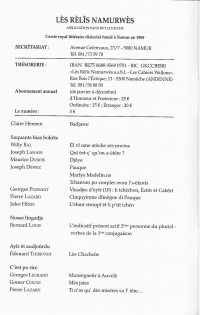
Cahiers wallons-Rèlîs Namurwès - 4 - 2016 ( 39e année ) - Juillet - août 2016
Sommaire • Èl vî ome atôche sès mwins par Willy Bal •…
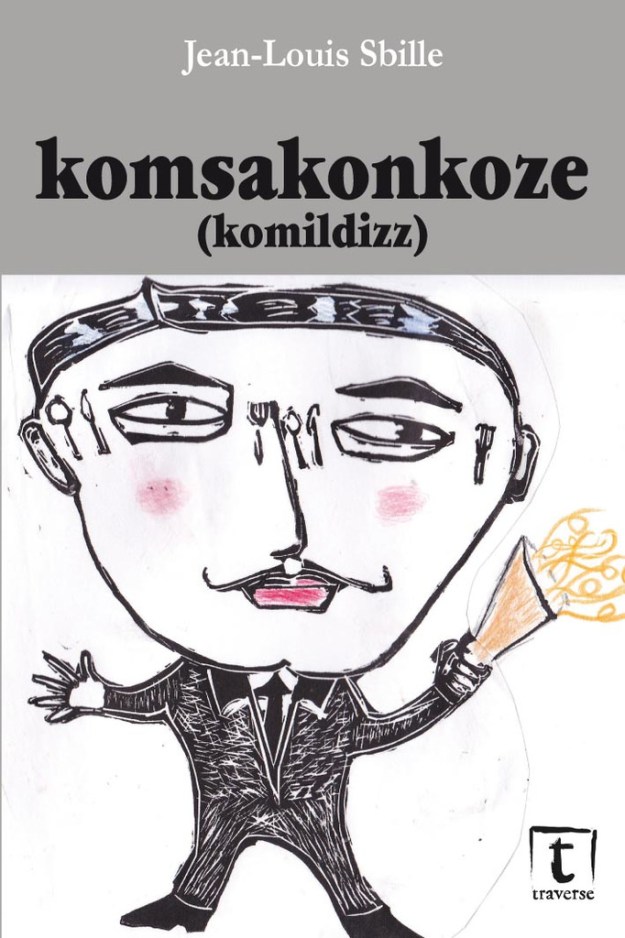
Lire, comme parler, écrire, écouter, ça se passe d’abord dans un corps. Pas dans de la pensée. Pas dans des mots. La langue, c’est d’abord une affaire…
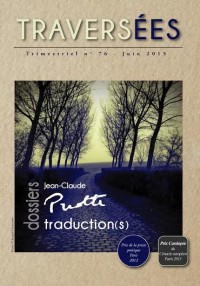
Paris , ville lumière ! Où fait-il bon même au cœur de l’orage (Louis Aragon) Je t’écris/ en cherchant dans la manche du monde/ une main/ qui transforme la balle en drapeau…

Si on se place au point de vue de l’espérance et de la volonté du féminisme comme mouvement politique au sens le plus large du terme, il ne peut y avoir de transformation des rapports sociaux sans une transformation du champ symbolique. Françoise Collin, Je partirais d’un mot. Le champ symbolique, 1999, p. 18 * Paraphrasant Olympes de Gouges , l’historienne américaine Joan Scott écrivait dans son ouvrage sur le féminisme et les droits de l’homme que les féministes n’ont que des paradoxes à offrir (Scott, 1998). Elle y soutenait la thèse que les contradictions propres au féminisme comme celle de vouloir l’égalité en se revendiquant à la fois de l’universalité et de la particularité ne faisaient que refléter celles des discours des Lumières et de la Révolution française qui, d’une part dissolvent la différence des sexes dans l’universalité des droits de l’homme, mais d’autre part la reconnaissent, la renforcent même en invoquant la nature des femmes pour justifier leur exclusion du domaine public. Les paradoxes n’ont pas fini de travailler le mouvement des femmes dont l’essence me semble être, après plusieurs décennies d’engagement en son sein, non pas de résoudre les contradictions mais de s’y engouffrer et de sans cesse les exploiter pour faire avancer la cause des femmes. La création de Sophia n’échappe pas à cette règle puisque les féministes qui fondèrent l’association à la fin des années 1980, voulaient dans un même élan subvertir les institutions académiques et leur mode de production des connaissances aussi bien que légitimer les savoirs féministes dans ces mêmes institutions. Soit tout à la fois la marge et le mainstream, la subversion et l’institutionnalisation. Sophia naît après le premier colloque européen consacré aux Women’s studies XX organisé en 1989 par les Cahiers du Grif XX sous l’égide de la Commission des Communautés européennes. Ce colloque qui faisait le point sur l’état des études-femmes XX en Europe, avait révélé la pauvreté des enseignements et recherches dans ce domaine en Belgique par comparaison avec les autres pays européens. À l’initiative du Grif, quelques militantes francophones et flamandes, enseignantes pour la plupart et excédées de ce retard, décidèrent d’agir pour assurer la transmission des savoirs féministes dans nos universités. Si ces pionnières pouvaient diverger par leurs ancrages institutionnels, leurs convictions politiques ou même leur engagement féministe, elles poursuivaient un objectif commun : la reconnaissance et la promotion des études féministes et sur les femmes. Au-delà des différences et des différends, toutes étaient convaincues de la nécessité d’inscrire le questionnement féministe dans la profondeur des consciences pour qu’un réel changement ait lieu. Si, de sa création à aujourd’hui, Sophia est restée fidèle à son objectif principal d’élaboration et de transmission du corpus féministe à travers les cursus universitaires, son statut, par contre, comme les moyens et les stratégies pour l’atteindre ont considérablement évolué. Entre autonomie et intégration, entre dissidence et collaboration, Sophia refusera de choisir, poursuivant sa critique des savoirs androcentrés en même temps que son combat pour l’institutionnalisation des études féministes : il lui faudra à chaque fois décider et juger de la stratégie à suivre en fonction de la conjoncture mais sans jamais perdre de vue ce qui constitue sa raison d’être : agir dans et sur l’ordre symbolique pour transformer en profondeur les rapports inégaux entre les femmes et les hommes. LES ÉTUDES-FEMMES ANNÉES 1990 Au moment de la naissance de Sophia, des chercheuses de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles (ULB) créent le premier groupe d’études-femmes dans la partie francophone du pays XX alors que les universités flamandes comptent déjà deux centres de recherches interdisciplinaires en « vrouwenstudies », l’un à l’Université de Bruxelles (VUB) et l’autre à l’Université d’Anvers (UIA). Celle-ci offre également un cours postuniversitaire intitulé « Voortgezette Academische Opleiding (VAO) Vrouwenstudies ». L’écart flagrant entre les deux communautés s’explique en grande partie par les contextes politique et idéologique radicalement différents dans lesquels surgit la vague féministe des années 1970 ainsi que par l’évolution, spécifique à chaque communauté, du mouvement des femmes et des rapports qu’il entretient avec les institutions (Plateau, 2001). Du côté flamand, le parti majoritaire, le CVP (Christelijke Volkspartij), possède une structure permettant à des groupes d’intérêt d’exprimer leurs revendications, ce qui ouvrait une niche pour le féminisme. Ainsi naît le groupe Vrouw en Maatschappij fondé par Miet Smet, où se retrouvent des personnalités qui plus tard défendront les intérêts des femmes et soutiendront les recherches et enseignements féministes. Quant au mouvement des femmes, il rassemble, dès 1972, en un large réseau, des féministes issues aussi bien de groupes traditionnels au sein des partis politiques et des syndicats que de groupes alternatifs féministes. C’est le Vrouwenoverlegcomité (VOK) qui continue d’organiser chaque année la journée des femmes. Féministes académiques, politiques et autonomes se côtoient donc et travaillent ensemble pour des projets ou objectifs communs. Enfin, de 1985 à 1999, le soutien politique de Miet Smet, d’abord secrétaire d’État puis ministre fédérale de l’Égalité, va permettre le développement de la recherche féministe et ainsi déclencher le processus d’institutionnalisation des « vrouwenstudies » en Flandre. Ce sont en effet, les financements octroyés à la recherche orientée vers la décision politique (les études commanditées par la ministre pour développer ses politiques d’égalité) qui ont permis aux centres d’études féministes flamands d’assurer leur fonctionnement en l’absence de soutien des autorités académiques. Rien de pareil en Communauté française où prédomine le parti socialiste pour lequel l’égalité des sexes ne constitue qu’un aspect particulier d’une question bien plus vaste, celle de l’égalité sociale. De là la difficulté des commissions femmes des partis et des syndicats, encore perceptible à l’heure actuelle, à penser l’égalité en termes de rapports sociaux de sexe s’articulant aux autres rapports de domination (classe, origine ethnique etc.). En réalité, la plupart des femmes occupant des postes de responsabilité à cette époque au sein du Parti socialiste ou de la FGTB (Fédération générale du Travail de Belgique), étaient pétries d’universalisme et n’accordaient aucune priorité aux questions des femmes, persuadées – comme la syndicaliste Irène Pétry l’exprima un jour – que les femmes sont des hommes en politique. De leur côté, les femmes appartenant aux nouveaux groupes féministes héritiers de la pensée libertaire de 1968 affichaient une défiance ouverte à l’égard de toute institution. Cette incompatibilité entre femmes dans et hors institutions a empêché la création comme en Flandre d’un réseau d’influence capable de soutenir les études féministes à l’intérieur même des universités. C’est par conséquent, hors institutions, dans le mouvement des femmes, qu’émerge la réflexion féministe, au début des années 1970, avec les Cahiers du Grif, une « réflexion théorico-pratique qui se construit dans l’action et la déconstruction » (D’Hooghe, 2011, p. 23). La première série des Cahiers (1973-1979) est le fruit du travail collectif et militant de femmes qui réfléchissent ensemble à des questions peu légitimées par l’édition ou la recherche de l’époque (les discriminations que subissent les femmes dans le travail professionnel et ménager, la reproduction, la sexualité, la création…

Introduction (in Dossier La place Cockerill)
La place Cockerill et le Quai-sur-Meuse jouent un rôle particulier dans le cœur urbain de Liège. Le vaste espace public qu’ils…

Lès bolèdjîs Pètcheûr do Bork. (Dès djins èt dès mèstîs d’ ayîr.)
(En wallon de Saint-Hubert) Prumîre…
- Page précédente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- Page suivante

