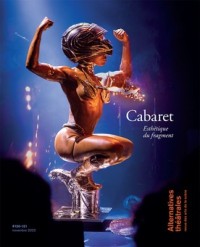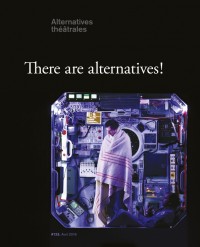Résultats de recherche 1 à 30 (38)

Avant-propos: Les oreilles du théâtre
Quarante ans déjà que le théâtre s’est découvert des oreilles. C’était dans les années 1980, Raymond Murray Schafer venait…

Lara Barsacq est chorégraphe, danseuse et comédienne. Comme interprète, elle a notamment travaillé avec L'Ensemble Batsheva et Les ballets C de la B. * Lara Barsacq…

Concevoir, rédiger, composer, adapter, citer, copier-coller, chorégraphier, improviser, diriger, au plateau ou en chambre, avec ou sans ambition littéraire, dans une…
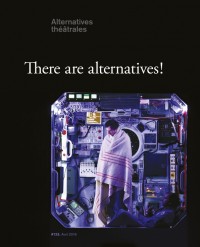
« Que pouvons-nous encore penser du théâtre et de ses pouvoirs, dès lors que l’on accepte que l’essentiel de l’activité spectatrice se déploie indépendamment de la représentation,…

La musique comme matière plastique. Entretien avec Maarten Seghers
Penser le rapport de la création théâtrale contemporaine à…

Présentation du n° 129 : En quelques mots...
Il y a plus d'un siècle en Angleterre, Virginia Woolf s'interrogeait sur l'impuissance des femmes…

Remettre en question nos privilèges. Entretien avec Sidi Larbi Cherkaoui
Quand on est fils d’immigrés en Belgique (avec…

N° 130. " Ancrage dans le réel " : Théâtre National (Bruxelles) 2004-2017 ; et Dossier Joël Pommerat Lieu à la fois singulier et reconnu sur la scène belge et européenne,…

De «La Démangeaison» à «La Mélancolie», l’expérience du Vivarium Théâtre. (Sélection du blog AT)
Reprise de « la Mélancolie des Dragons » et de « l’Effet de Serge », de Philippe Quesne, à Nanterre-Amandiers, en janvier 2018. En 2018, Nanterre-Amandiers célèbre l’anniversaire des dix ans de L’Effet de Serge (2007) et de La Mélancolie des Dragons (2008), deux spectacles pensés en diptyque, qui ont tracé les lignes de force du Vivarium Studio. L’occasion de republier cet article paru initialement dans le #98 AT, Créer et transmettre. * Une fois que le titre est posé, l’écriture démarre : ça a commencé avec La Démangeaison des ailes, leur premier spectacle créé en 2003, et le système s’est institué. En 2008, ils ont choisi d’évoquer La Mélancolie des dragons. Le spectacle qui vient de naître à Vienne en mai 2008 est recréé à Avignon en juillet à l’église des Célestins. Après le dépôt du titre, ils se mettent en quête de nourriture, littéraire, iconographique, enquêtes de terrain… Et c’est sur les bases de cette matrice que vient se greffer le jeu d’acteurs. Pour ces derniers, il ne s’agit pas alors d’interpréter un théâtre écrit à leur attention, mais de poursuivre, en jouant, le processus d’écriture. Au fil des créations, les acteurs qui jouent pour Philippe Quesne, le metteur en scène du Vivarium Théâtre, sont devenus des personnages. Il l’accompagne – ils s’accompagnent – depuis les débuts de la compagnie. Les acteurs, les gens sur scène (dit Philippe Quesne), s’occupent aussi de la fabrication du décor. Le metteur en scène, pendant la représentation, assure la régie. Il semble que depuis La Démangeaison… ils se soient constitués en bande de travail. Non pas en groupe ou en collectif, mais bel et bien en bande : c’est-à-dire un ensemble de gens qui depuis cinq ans œuvrent ensemble, avancent ensemble, sont en train de chercher et de vivre ensemble. Telle que définie par Philippe Quesne, la notion de bande fait penser à une meute (de loups ou de dragons ou de hard-rockers, c’est selon), dont il reste le « chef » puisqu’il signe les mises en scène. Pour inventer son théâtre, la bande se nourrit de son imaginaire collectif et des contraintes rencontrées en chemin. Pour La Démangeaison… ils avaient dû travailler dans un appartement. Leur dispositif scénique s’en était inspiré. Des gens entraient et sortaient dans un (décor d’) appartement, pour venir y parler de leur désir d’envol, voire le mimer. Tentatives vaines, chutes assurées… c’était le thème de leur premier travail. L’Effet de Serge (production 2007), également présenté à Avignon dans le cadre de la vingt-cinquième heure, aborde le sujet de la solitude et de l’autonomie de l’artiste. Serge, protagoniste de l’histoire, vit dans un de ceux fameux appartement dessiné par le Vivarium : une sorte de hangar, avec pour accessoires ou éléments de décoration, (ça ressemble à du théâtre mais on pourrait aussi bien y habiter), une table de ping-pong, un ordinateur, des miniatures télécommandées, une chaîne Hifi… surtout de quoi faire des effets spéciaux. Car Serge, qui, en semaine, se livre à lui-même un paquet de chips servi sur plateau roulant téléguidé…, Serge le solitaire, a une âme d’artiste le week-end. Avec trois fois rien, il crée des spectacles de trois minutes qu’il présente à ses amis le dimanche. Il aime faire partager son idée du « beau » : machine roulante avec pétard sur une musique de Haendel, effet lumineux sur une musique de Wagner. Les amis-voisins-spectateurs assistent , ébahis, et commentent ou remercient. Philippe Quesne crée sur scène un dispositif qui englobe le plateau et la salle, et s’amuse à nous présenter son théâtre en train de se faire devant des acteurs qui jouent aux spectateurs. On n’entend pas toujours bien ce qu’ils disent à leur ami créateur. Quand leurs propos sont inaudibles, leurs présences sont accentuées. Là debout devant Serge, ils cherchent les mots pour décrire leur ressenti, ils ne fuient pas la poignée de main. Le Théâtre du Vivarium est avant tout un théâtre des corps. Pour Quesne, la scénographie se nourrit de sujet et des corps vivent dedans. Ils ont une façon d’habiter le plateau comme s’ils pouvaient y vivre (« ils », c’est-à-dire la huitaine de comédiens réguliers, et leur chien.) Philippe Quesne a utilisé, ailleurs, ce procédé de la « forme chuchotée ». Par exemple, lors des tournées internationales de D’Après nature – spectacle dont le thème prétexte était « la fin du monde » – il a fallu résoudre les problèmes de traduction. Pour ce faire, le metteur en scène ne considérant pas que la fin du monde ressemblait aux films de science fiction des années 1950, où d’immenses insectes dévoraient les terriens…, songeant plutôt qu’elle était calme et silencieuse, pas du tout violente mais proche de nous, comme incluse dans chaque geste de notre quotidien, a préféré que ses comédiens jouent tout doucement, dans une forme chuchotée, accompagnée d’un surtitrage. * Au moins deux contraintes se posent à la bande pour la recréation de La Mélancolie des dragons à Avignon : d’une part, la gestion de la présence d’une seule femme au milieu d’un groupe essentiellement masculin (Isabelle en effet découvre dans un paysage enneigé sept hommes dont la voiture tirant un mobile home, est en panne) ; et, d’autre part, la réinvention scénique du spectacle à l’église des Célestins. La question de la présence féminine est évoquée avec humour par Philippe Quesne comme celle de Blanche-Neige au pays des sept nains, qui sont ici sept hard-rockers aux cheveux longs. Quant à l’adaptation du spectacle aux lieux, c’est en quelque sorte une de leur spécialité. Le Vivarium théâtre est une communauté d’acteurs qui travaille à l’occupation d’espaces autrement et à L’Invention des spectateurs. Le Vivarium invente des formes en milieu urbain autant que dans des forêts. Ils se soucient de notre organisation sociale, de nos vies d’humain et du monde, et utilisent le théâtre pour exposer leurs préoccupations : font du théâtre de tout, et partout. Certains projets sont conçus pour des lieux en extérieur : villes, parcs et forêts, etc. D’autres le sont pour de grandes scènes internationales (il sont programmés aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, Suisse, Pologne…). Ils inventent aussi des formes spécifiques nourries des échanges avec les habitants et de leur expérience dans un contexte urbain, souvent pendant les temps de résidence (au Blanc-Mesnil où ils ont séjourné trois ans.) Pour en revenir à La Mélancolie..., il sera notamment question de loger une voiture et un mobile home dans le cloître des Célestins, à proximité des platanes, d’évoquer en été des paysages enneigés (souvenirs de tournée en Islande), de suggérer des monstres sans en montrer. L’imagerie des dragons a fait long feu depuis le moyen-âge. Sur scène, il n’en restera que le goût de l’inquiétude et de l’étrangeté, traduit par un « ballet de formes » proche de la marionnette : dans un finale fantasmagorique, le paysage se sature de formes gonflables, sortes d’énormes tubes dressés et sombres. De la mélancolie si généralement référencée à la toile de Dürer, pas de tableau ni même d’allusion au maître. Pour Philippe Quesne, la mélancolie est une protection face au désenchantement. Elle n’a rien à voir avec la folie ou avec la nostalgie. Il s’agit d’un état lié à la création. Dans le spectacle, la mélancolie est transformée en parc d’attractions ! Elle entre en collision avec les dragons. L’association des mots mélancolie et dragon rappelle à Quesne l’incroyable série de peintures de Goya, intitulée Les Caprices, où il n’est pas rare d’observer des…

Ce numéro spécial d'Alternatives théâtrales édité à l'occasion de Mons 2015 n'a pas pour intention de donner à cette manifestation au long cours plus d'audience et…

Bernard Debroux : Dans Métaphysique du bonheur réel XX , vous citez plusieurs fois cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Par association d’idée, elle m’a ramené à un des spectacles les plus marquants dans mon souvenir de spectateur, 1789 du théâtre du Soleil, découvert en 1969 (!) et dont le sous-titre était une autre phrase de Saint-Just : « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur ». Dans ce même livre vous proposez une distinction entre différents types de vérité et les différentes formes de bonheur qui y sont liées : le plaisir pour l’art, la joie pour l’amour, la béatitude pour la science et l’enthousiasme pour la politique. Dans mon expérience de spectateur, il me semble que la réception de 1789 mêlait ces différents états : du plaisir bien sûr, mais aussi de l’enthousiasme ! Alain Badiou : Si l’on parle de ce spectacle en particulier, il est évidemment inséparable de l’enthousiasme flottant de l’époque toute entière, surgi en 1968. On allait de l’enthousiasme politique au théâtre et du théâtre à l’enthousiasme. Au théâtre, il y a une capacité singulière pour le spectateur qui consiste à transformer sa réception en quelque chose comme un bonheur, le bonheur du spectateur qui va faire l’éloge du spectacle à partir d’éléments qui peuvent être au contraire sinistres, tragiques, effrayants etc. C’est en ce sens que je dis que le théâtre reste dans le registre de l’art. Il y a un bonheur singulier qui est lié, non pas à ce qui est, mentionné, représenté mais au théâtre lui-même, le théâtre en tant qu’art. Dans le spectacle que vous évoquez, je suis d’accord avec vous, il y avait à la fois le bonheur du théâtre et l’enthousiasme qui vous mobilisait subjectivement pour changer le monde… B. D. : …et de la joie aussi … A. B. : Aussi, oui. B. D. : Peut-être pas la béatitude que procure la découverte scientifique! A. B. : Oh, sait-on ? Voyez la pièce de Brecht sur Galilée ! La singularité du théâtre est peut-être de produire un affect affirmatif avec des données qui, du point de vue de leur apparence ou de leur évidence, ne le sont pas du tout. J’ai toujours trouvé extraordinaire que les spectacles les plus effrayants, ceux dont on devrait sortir anéantis, arrivent à prendre au théâtre une espèce de grandeur suspecte qui fait qu’on sort de là illuminé, en un certain sens, par des crimes et d’infernales trahisons. B.D. : Les pièces de Shakespeare en sont un exemple frappant… A. B. : C’est la question paradoxale du plaisir de la tragédie. Aristote a tenté d’en donner une explication. Il a dit qu’au fond, nos mauvais instincts se trouvaient purifiés parce qu’ils étaient symbolisés sur la scène, et ainsi comme expulsés de notre âme. Il appelait ça « catharsis », purification. Nous sommes heureux au théâtre parce que nous sommes déchargés, par le spectacle réel, de ce qui empoisonne notre subjectivité. Le théâtre est une machine assez complexe. Il est toujours immergé dans son temps, donc il est traversé par les affects dominants du temps. C’est pour cela qu’il y a un théâtre dépressif ou un théâtre de l’absurde ou un théâtre épique etc. Mais d’un autre côté, quand il est réussi, quand il a la grandeur de l’art, il crée un affect qui est fondamentalement celui de la satisfaction, quelle que soit sa couleur, avec des matériaux on ne peut plus disparates. B. D. : En prolongement de cette réflexion, je voudrais faire référence à cette même époque (de l’après 68) et à mes débuts de travail dans l’action culturelle où j’aimais éclairer le sens de cette action en m’appuyant sur les concepts développés par Lucien Goldmann XX et repris à Lucacz de « conscience réelle » et « conscience possible ». C’était une idée très positive, très affirmative (qu’on peut bien sûr interroger et critiquer différemment avec le recul) qui supposait que l’art, la création, les interventions culturelles et artistiques pouvaient bousculer les habitudes sclérosées et produire du changement… Pourrait-on mettre en lien ces concepts et ces pratiques avec ce que vous appelez le « théâtre des possibles » que vous mettez en opposition avec le théâtre « théâtre » qui est dans la reproduction d’un certain réel édulcoré et où rien ne se passe…? A. B. : Je pense que le grand théâtre propose toujours une espèce d’éclaircie à la pesanteur du réel, éclaircie qui reste dans l’ordre du possible, et donc fait appel chez le spectateur à un type de conscience qu’il ne connaît pas immédiatement, qui n’est donc pas sa conscience réelle. Le théâtre joue en effet sur cette « possibilité ». Antoine Vitez répétait souvent que « le théâtre servait à éclairer l’inextricable vie ». L’inextricable vie, c’était le système d’engluement de la conscience réelle dans des possibilités disparates, des choix impossibles, des continuités médiocres. Le théâtre fait un tri, dispose tout cela en figures qui se disputent ou qui s’opposent, et ce travail restitue des possibilités dont le spectateur, au départ, n’avait pas conscience. Le problème est de savoir à quelles conditions cette conscience possible peut se fixer, se déployer, en dehors de la magie théâtrale. Y a-t-il réellement une éclaircie de l’inextricable vie ou simplement une petite parenthèse lumineuse ? C’est la question que vous posez : quelle est exactement la ressource d’efficacité du théâtre de ce point de vue ? Est-ce une capacité de transformation « réelle »? Est-ce que le passage de la conscience réelle à la conscience possible est lui-même réel ou simplement possible ? Je crois que lorsqu’on sort d’un spectacle, on demeure comme suspendu à cette difficulté… * B. D. : Le théâtre européen a été fortement influencé à partir des années 1970 et 1980 par l’irruption des sciences humaines dans l’espace social. A côté du metteur en scène on a vu apparaître le « dramaturge » au sens allemand. Celui-ci a pu même être considéré à un certain moment comme le « gardien » du sens. Le théâtre est un univers de signes (texte, jeu de l’acteur, scénographie, lumières, costumes) où tout fait sens. On entendait souvent lors de répétitions dire à l’acteur : « là, ce que tu fais, c’est juste ». Paradoxalement, je me souviens d’avoir assisté à des répétitions de pièces mises en scène par Benno Besson (qui avait pourtant travaillé de longue années avec Brecht à Berlin) encourager l’acteur en lui disant : « là, ce que tu fais, c’est beau ». A. B. : Je serai assez tenté d’admirer les deux approches et d’être dans une synthèse prudente afin d’éviter le choix. D’une certaine façon quand on disait « c’est juste », on emploie un mot qui est, soit du registre de l’exactitude, soit du registre de la norme. Juste est un mot équivoque. On peut en effet aussi bien dire : « Le résultat de cette addition est juste ». Le mot « juste » tire vers justice ou tire vers exact. Il est au milieu des deux. Je pense aussi que lorsqu’on disait « c’est juste » dans un contexte sournoisement politisé, c’était parce qu’on préférait dire juste que beau. Dire « c’est beau » était considéré comme trop intemporel… Les deux appréciations peuvent en vérité apparaître chez le metteur en scène à des moments et dans des contextes différents. « Juste » va tirer du côté de la conscience possible, de la fonction éducative du théâtre. « Beau », c’est autre chose, c’est le sentiment qu’on peut avoir d’être dans une lumière singulière, une éclaircie visible. « Beau » est une qualité intrinsèque de ce qui se voit, de ce qui apparaît, de ce qui est dit, de ce qui s’entend. Je dirais volontiers que la ruse du théâtre, c’est…