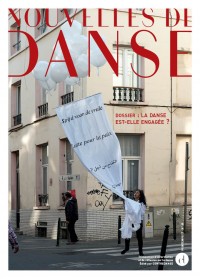Résultats de recherche pour “Truus” 2251 à 2280 (2374)

Tim Robinson et le bord des falaises
Ceci est tout à fait clair : l'endroit recommandé pour cultiver la rose des vents est le bord même de la falaise …

Antoine Boute – S’enfonçant, Spéculer – un grand éclat de rire dissonant
S’enfonçant, Spéculer est un roman conceptuel, plus proche de…
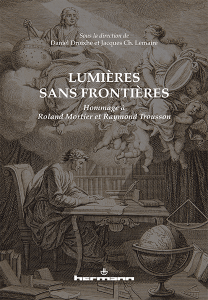
Lumières sans frontières. Hommage à Roland Mortier et Raymond Trousson
trousson-mortier Heureuse idée que celle de rendre hommage, sous le titre Lumières…

Maurice Maeterlinck, un auteur dans le cinéma des années dix et vingt
Christian Janssens étudie de manière fouillée…

Le ciel de Clémence s’est obscurci lorsqu’elle avait treize ans. Alors qu’elle empruntait le métro pour rentrer chez elle, deux jeunes hommes l’ont sauvagement…
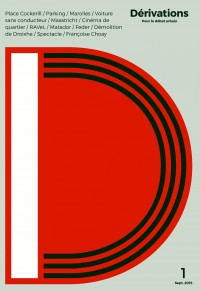
Introduction (in Dossier La place Cockerill)
La place Cockerill et le Quai-sur-Meuse jouent un rôle particulier dans le cœur urbain de Liège. Le vaste espace public qu’ils…
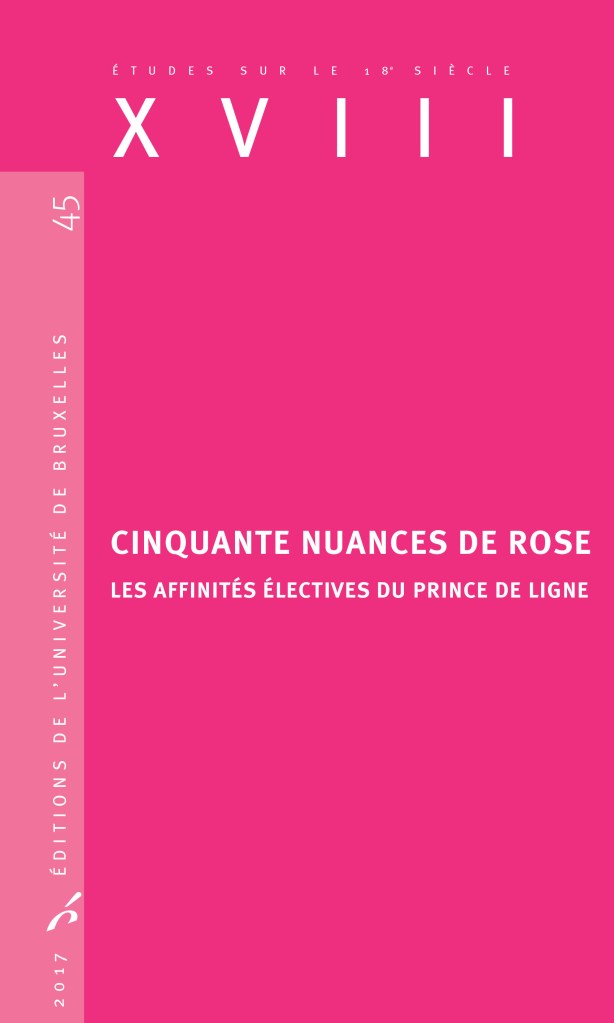
Cinquante nuances de rose. Les affinités électives du Prince de Ligne,
Pouvait-on s’attendre à ce qu’une revue universitaire pût rendre un portrait aussi…
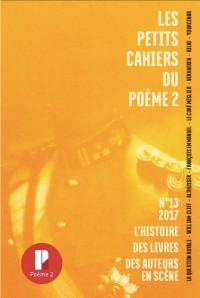
Alexis ou le Traité du vain combat
Récit de sa première période d’écriture, ce premier “portrait d’une voix” a séduit la critique, notamment Edmond Jaloux, et fait entrer Yourcenar dans le monde…

Déplacer la perception possible du monde – entretien avec Laurent de Sutter
Lors de la soirée First they came for Assange... ce 19 juin à Bozar,…

L'un à travers l'autre, et inversement (traduire Henry James et Edith Wharton)
Pour être simple, et même simpliste, disons…

Elsie DX, c'est bien plus que le nom de scène d'Elise Dutrieux. C'est un projet artistique complet, qui mélange avec élégance musique ethnique, électro, graphisme et vidéo. C'était aussi l'invité de la galerie…

Le Futur de l’archive et l’Archive de demain
Contrairement à l’image poussiéreuse que lui prête l’imaginaire populaire, l’archive est avant tout une affaire d’avenir. Dans la…

J’écris depuis huit années. Des romans toujours des romans. Hygiène de l’assassin est mon onzième roman. Je l’ai écrit il y a longtemps déjà, il y a un an et demi. Depuis, j’écris…

La novellisation, une écriture différente du cinéma (2015)
La novellisation, méchant anglicisme dérivé de « novelization », est une pratique éditoriale qui consiste…
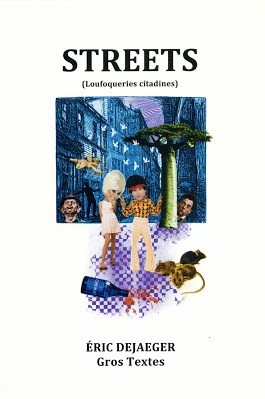
Streets (loufoqueries citadines)
Naguère professeur de langues et d’économie, Éric Dejaeger fait partie de cette armée des ombres qui, sans toit ni loi, sont les indispensables…

Panorama d’une littérature pour adolescents (Dossier)
Loin d’être cantonnée à un genre particulier , la littérature pour adolescents se…
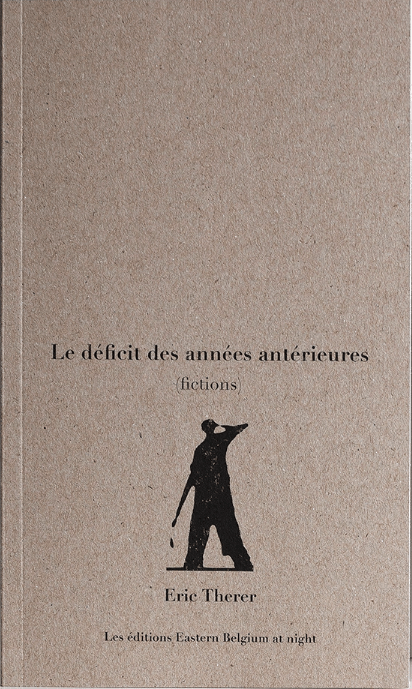
Le déficit des années antérieures
Un constat tout d’abord : Le déficit des années antérieures est un objet soigné. Très classe. « Fait maison », pourrait-on dire.…

Johannesburg – pépite d’art (3) – Exposition permanente
Cataloguée reine incontestée du crime, la ville de Johannesburg peut se targuer d’un art urbain pétri d’œuvres…

Le lien qui unit Friedrich, pianiste réputé, et Adrienne, grande amatrice de musique, est avant tout épistolaire. Ils ne se sont croisés qu’une seule fois, à la sortie d’un concert, il…

Interview de l’été – Okayss Prod
Rien de mieux qu’une journée ensoleillée pour réaliser une interview décontractée avec l’équipe d’Okayss Prod au cœur de…

In djon.ne solé brét dins l’ hastrèle, Seu l’ mousse ou cûr dès nwârs tchayés, Rtchaufant lès pîres èt lès èstèles Leumant lès éwes, l’ long dès pazés. Sa leumîre…
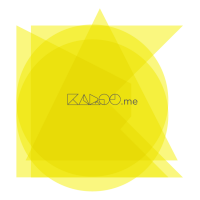
Inside Llewyn Davis. Le cycle de l’homme malchanceux. (Cinéma)
Pour leur 16e long-métrage, les frères Coen signent une variation tragicomique…
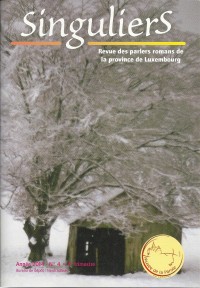
I s' vèyint voltî cès djon.nes djins la, dispôy k' i s' avint rascontrè al dicôce d' Aurvèye. Li, qu' on lumot Djôzèf, avot dja on bê posse…
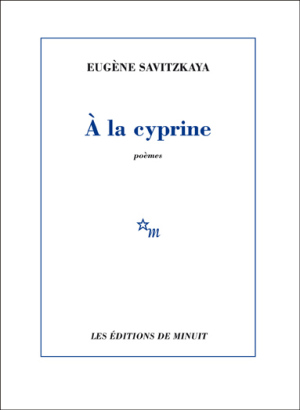
À la cyprine : – saisir l’essence, – des êtres aux substances
Le nouveau recueil de poèmes d' Eugène Savitzkaya , À la cyprine est paru aux éditions de…

Daniel Fano : chroniqueur de réel / poète exponentiel (in Varia)
Daniel Fano est un poète – « chroniqueur » , dit-il –…

Comment le klezmer fut inventé
Premières traces Les traces dont on dispose remontent au début du XIXe siècle, même si la réalité qu’elles suggèrent est plus ancienne. Des…

WePorn. Le X et la génération Y
Il y a deux décennies, Amélie Nothomb publiait Attentat (Albin Michel, 1997), son cinquième roman, et, au détour d’une histoire d’amour et des normes à respecter ou…

On connaît ce divertissement : un participant, les yeux bandés, poursuit à tâtons les autres qui tout à tour le frôlent et se dérobent. Pour se libérer de son…

Depuis une semaine, les copines du quartier ne parlent que de ça. Leurs grands frères leur ont raconté: Qu'un grand monsieur moustachu avec sa petite moto jaune vient devant…
- Page précédente
- 1
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- 80
- Page suivante