Résultats de recherche pour “les auteurs” 211 à 240 (859)

Enseigner une littérature «invisible» à l’Université. Le cas de la littérature en langue picarde
En avril 2023, la Société organisait une journée de mise à l’honneur de nos membres correspondants. À cette occasion, quatre d’entre eux ont eu l’occasion de prendre la parole sur des sujets de leur choix, soit en lien avec les langues régionales de Belgique romane, soit à propos de sujets d’études proches de nos considérations. Les intervenants ont accepté de faire part de leurs présentations par écrit et nous nous proposons de les publier dans Wallonnes, au fil des numéros. Voici la deuxième contribution: celle d’Olivier Engelaere, introduite par Baptiste Frankinet. * Présentation Il est presqu’impossible, à l’heure actuelle, d’évoquer la langue et la littérature picardes, sans arriver rapidement à mentionner le nom d’Olivier Engelaere . Historien et documentaliste de formation, Olivier a été chargé dès 1999 de développer des projets de défense, de soutien, d’illustration de la langue picarde au sein de l’Office Culturel Régional de Picardie. Et, dès cette première mission, force est de constater qu’il s’est pris d’une passion incommensurable pour le picard, sous tous ses aspects. Sa passion n’a d’égal que l’investissement et l’énergie immenses qu’il a pu déployer au cours des vingt-cinq dernières années pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées à la fin du 20e siècle. En 2009, le département Langue et Culture de Picardie qu’il avait savamment organisé au sein de l’office culturel régional de Picardie, se concrétise en une Agence régionale de la langue picarde. Cette agence, directement missionnée par la Région Hauts-de-France, est placée sous sa responsabilité et développe des opérations de promotion qui prennent les formes les plus diverses: organisation de prix, animations scolaires, développement d’ateliers d’écriture en bibliothèque ou en milieu carcéral, défense militante de la langue, soutien dans l’apprentissage, organisation d’une commission de terminologie picarde, aide à la publication, et j’en passe. Parallèlement, il fonde la maison d’édition Engelaere, une maison d’édition associative spécialisée dans les questions culturelles régionales et notamment dans l’édition en langue régionale. Cet outil vient, incontestablement, en aide aux auteurs et aux écrivains picards, et cherche à leur assurer une diffusion et une promotion convenables face au marché concurrentiel du livre en français ou en langue étrangère. Depuis 2015, Olivier Engelaere assure un cours de langue et culture picardes à l’Université de Picardie-Jules Verne à Amiens. Depuis 2020, il organise également un cours similaire à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. En 2021, il accepte de devenir membre correspondant de notre SLLW, a fortiori parce que le picard est un de nos objets d’études. La langue picarde, qu’il défend et qu’il promeut depuis des années, déborde sur une grande partie du Hainaut. Depuis 2022, il a entrepris une thèse qui étudie la littérature de langue picarde au 19e siècle, sous la direction de Marie-Françoise Melmoux-Montaubin. C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons Olivier Engelaere au sein de notre Société, en qualité de membre correspondant, en espérant qu’il pourra s’appuyer sur les études faites par cette même Société pour toute la région picarde, mais qu’il pourra également nous aider à mieux connaître le picard tel qu’il est parlé outre-Quiévrain. © Baptiste Frankinet, revue Wallonnes 4-2023, SLLW, Liège, Belgique * Enseigner une littérature «invisible» à l’université Le cas de la littérature en langue picarde par Olivier Engelaere Je tiens en premier lieu à vous remercier pour l’honneur qui m’est fait de me proposer de devenir membre correspondant de la Société de langue et de littérature wallonne dont l’objet, la défense et la promotion des langues régionale, a été, pi i est toudis, un des moteurs de mon existence. Lorsque Monsieur Frankinet m’a demandé de choisir un thème pour cette intervention, tout de suite le rapport entre nos langues régionales et le monde universitaire m’est venu à l’esprit. Comme vous le savez certainement, un évènement très important, qui a bouleversé notre paysage, dans le nord de la France, a eu lieu le mardi 14 décembre 2021. Il s’agit de la publication d’une circulaire du ministère de l’Éducation nationale qui ajoute le picard, ainsi que le flamand occidental et le franco-provençal, à la liste des langues régionales qui peuvent être enseignées à tous les niveaux de la scolarité. Je passerai sur l’aventure qu’a été l’élaboration de ce texte et les méandres politiques qui ont permis que le picard ne soit pas oublié. Le picard jouit donc aujourd’hui du même statut dans l’enseignement que le basque, le breton ou l’occitan. Ce qui ne veut pas dire bien entendu qu’il en est au même point qu’eux… bien loin de là, et c’est un euphémisme que de le dire. Cette irruption presque brutale du picard dans l’éducation nationale a engendré de suite la question de la formation des maîtres qui seront en charge de son enseignement. Immédiatement, les regards se portent vers l’Université dont une des missions est de former les futurs enseignants. Le picard et l’Université, c’est une histoire ancienne. Le professeur Jean-Michel Eloy, de l’Université de Picardie Jules Verne, a consacré un article, non publié à ma connaissance, sur ce sujet. À l’Université de Lille, une chaire de «langue et littérature picarde et wallonne» existe depuis 1892. L’enseignante actuellement en poste est Esther Baiwir, dialectologue liégeoise que vous connaissez très probablement. Cette chaire a d’abord été occupée par des médiévistes et aujourd’hui la présence du picard à l’Université de Lille dépend du Centre d’études médiévales et dialectale. Ni les mots langue picarde ni les mots littérature picarde n’apparaissent dans la présentation des composantes de ce centre sur le site internet de l’Université. Les étudiants lillois de lettres peuvent donc suivre une option «langue, littérature et culture régionale». Le nom de la région concernée n’étant pas précisée, on imagine qu’il s’agit de langue et de littérature picardes, et non flamande puisque le flamand occidental est également une langue régionale des Hauts-de-France. À Amiens, le picard est présent à l’Université depuis sa création en 1971. C’est à la demande de son premier président, Dominique Taddéi, qu’est créé le Centre d’Etudes Picardes alors sous la responsabilité de Jacqueline Picoche, professeure de linguistique. Ici aussi, l’étude du picard est proposée aux étudiantes et étudiants sous la forme d’une option dont la forme a beaucoup varié selon les époques. Ce sont essentiellement des linguistes qui ont été en charge de cette option et je me dois de citer le nom de l’infatigable René Debrie. Cette option a eu une ampleur parfois assez considérable en termes d’horaires et a recouru à de nombreux vacataires. Depuis le départ de Jean-Michel Éloy, qui avait succédé à Jacqueline Picoche, plus aucun enseignant titulaire n’est responsable directement de cet enseignement, qui se poursuit et est donc aujourd’hui entre les mains de chargés de cours, dont je fais partie. Enfin, le picard est enseigné depuis l’année 2019-2020 à l’Université Polytechnique du Hainaut à Valenciennes dans le cadre d’un module d’ouverture de 18h par semestre. La demande de l’Université était de proposer un cours d’apprentissage de la langue. Là également, l’enseignement n’est pas assuré par un titulaire mais par un vacataire, ch’est toudis mi. Il n’y a donc, aujourd’hui, qu’à l’Université de Lille, qu’une enseignante titulaire se charge elle-même les cours de l’option «picard» entre guillemets. La présence du picard à l’Université, l’enseignement de la langue, ou plutôt son étude, est surtout une affaire de linguistes,…

Résidence de création en poésie au Québec : appel à candidatures
La Maison de la Poésie et de la Langue française invite les auteurs et autrices de la Fédération…

Traduction littéraire pour enfants: Emmanuèle Sandron, Maurice Lomré
La traduction littéraire est un champ vaste et trop…

Les inscriptions pour la Petite Fureur 2023-2024 sont ouvertes !
Le concours "La Petite Fureur" est un concours littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)…

Voici un livre à la fois ardu, son écriture porte les traces des cours et des travaux universitaires dont il est issu, et surtout précieux, son ampleur nous donne un bilan argumenté des théories et des pratiques économico-sociales contemporaines.Le titre, La fabrique de l’émancipation , conjoint de façon qui peut sembler étrange deux mots divergents : la matérialité du premier ne s’oppose-t-elle pas à l’idéalité du second ? Et l’action, au sens politique arendtien de la capacité d’initiative, de commencement, de « faire naître » une réforme, une institution, une libération, n’est-elle pas plus ajustée : si l’émancipation est possible n’est-ce pas dans l’action, plurielle et responsable ? Cette apparente opposition négligerait ce que Arendt comme Bruno Frère et Jean-Louis Laville cherchent à éclairer : l’ouverture de l’espace et du temps de la politique dans le langage qui ouvre l’action. Laquelle est façonnée entre autres dans la « fabrication » des théories politiques, mais de façon insuffisante parce que coupée des inventions effectives. Tel apparaît le double but des auteurs, Bruno Frère et Jean-Louis Laville : d’abord, donner la synthèse des « fabrications » fictionnelles (façonnées en langages des sciences et des philosophies sociales, non fictives pour autant), toutes négatives, proposées depuis deux siècles par les théories de l’émancipation ; mais, ensuite, les mettre face aux pratiques auxquelles elles devraient faire droit, à leurs « fabriques » actives d’émancipation, largement positives, dans les mouvements de révoltes et d’organisations sociales, porteuses de ré-institutions démocratiques. Du paradigme négatif au paradigme associatif Les premiers chapitres mènent à bien la critique (saisie des limites) de la critique (dénonciation) des obstacles à l’émancipation sociale. Sont tour à tour convoqués les grands noms de la critique sociale : Adorno, Horkheimer, Habermas, Honneth, Bourdieu, Latour, Boltanski, principalement. Et dans la foulée, avec justesse et précision, non sans nuances, est décelé l’enfermement de cette tradition dans la critique négative du capitalisme. Le paradoxe de cette position vient de ce que, du fait de sa négativité sans issue, elle ne cesse de dénoncer ce qu’elle constitue en indépassable, le marché capitaliste. Et cela, faut-il le préciser, d’autant plus que les tentatives de révolution de type communiste ou même de réformes de type social-démocratique (liées à l’État-Providence) ont montré leur échec total ou leur réussite trop partielle pour résister aux crises économiques et écologiques.Or ce que cette position néglige, c’est une alternative à la domination qui prend racine dans l’associationisme du 19e siècle, celle des coopératives, des mutuelles ou des crèches, car cette tradition est aujourd’hui ravivée dans de multiples innovations sociales porteuses de nouvelles institutions. Sans remettre en cause la pertinence des critiques négatives, la possibilité d’une critique constructive est mise en valeur dans l’autre moitié du livre. Les « épistémologies du Sud » (Boaventura de Sousa Santos, Anibal Quijano…) montrent ainsi que les révoltes populaires sous la bannière du « bien vivre » ou du « care » expérimentent des « expériences de sociabilité non capitaliste ». De l’association à l’Économie Sociale Solidaire Ce qui se fait jour dans ces expériences, des conseils communaux zapatistes du Chiapas à la ZAD de Notre-Dame-des Landes parmi tant d’autres, ce sont autant d’émergences de nouvelles institutions démocratiques, hybrides et diverses parce qu’impures. Exemple privilégié, l’expérience de l’ONG féministe brésilienne, Sempreviva Organizaçao Feminista, « a implanté la politique d’assistance technique à l’agro-écologie du gouvernement fédéral de 2015 à 2017 ainsi que des programmes de coopération internationale » en s’appuyant sur l’auto-organisation des femmes se dégageant du patriarcat.En définitive, via Karl Polanyi qui préconise le « désencastrement » de l’économique et du social et Cornelius Castoriadis qui marque la nécessité de la « praxis » instituante (non sans divergence avec la pensée démocratique de Claude Lefort), Frère et Laville en appellent à un « universel concret » où la macropolitique se nourrit de la micropolitique. En dépit d’une distance notée avec légèreté par rapport à Hannah Arendt et d’un privilège affiché à la « description », c’est bien l’action politique qui se voit remise à l’avant-plan, mais débarrassée des incantations, morales et autres, contre le « système ». Il est d’autant plus étonnant que, au-delà de l’enquête et de l’analyse, rien n’est indiqué au plan politique sur « l’approfondissement de la démocratie » par la « transition » qu’impose la crise sociale-écologique à l’émancipation.Donner droit aux multiples initiatives des luttes, des assemblées et des associations, à l’économie solidaire que pratiquent ces dernières, n’ouvre-t-il pas la voie d’une ré-institution de la démocratie électorale représentative où la démocratie horizontale, bien plus que par une participation consultative, recevra un pouvoir législatif effectif en alternance avec la démocratie verticale en crise [1] ? Il n’empêche : ce livre foisonnant est bel et bien indispensable à la compréhension des transformations de notre monde. Éric Clémens [1] En dialogue avec les auteurs, je me permets de renvoyer à mon essai, Pour un pacte démocratique. L’enjeu d’une double Assemblée, paru aux Presses Universitaires de Louvain,…

Prix Mireille Habets et Pierrot Habets 2023 : appel à candidatures
Dans le cadre de l'édition 2023 du Prix Mireille et Pierrot Habet, un appel à candidatures est…

Le Prix Charles Plisnier 2022 est attribué à Annie Préaux
Le Prix de Littérature Charles Plisnier vient d'être attribué à l'autrice Annie Préaux pour son roman Disparu…

Prix Raymond Leblanc 2023 : appel à candidatures
L’Association Raymond Leblanc organise, en collaboration avec la COCOF, visit.brussels, Le Lombard, Casterman et Futuropolis, un concours…
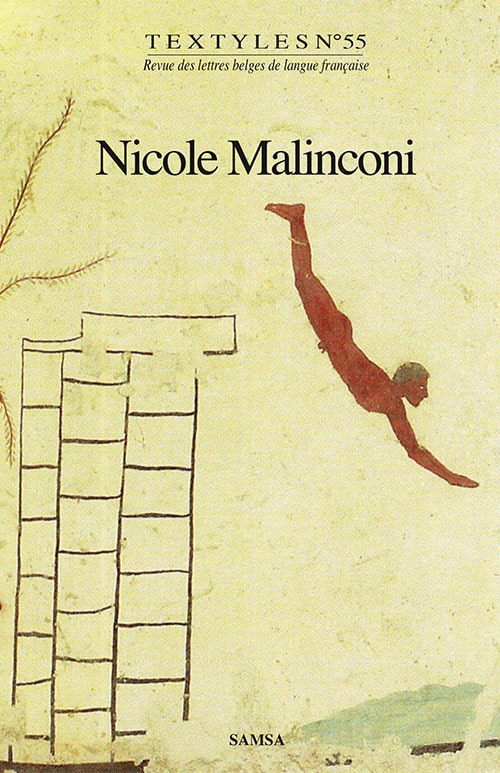
Textyles 55 : Nicole Malinconi
C’est la voix de Nicole Malinconi, traversée de toutes les voix du monde.Il fallait bien tout un volume de la revue Textyles , dirigé par Laurent Demoulin et Pierre Piret, pour considérer…

Textyles 49 : Réécritures - De l’écrit à la scène
Depuis la fin du xxe siècle, on a pu observer une mise en crise systématique du texte théâtral, voire de l’idée du…
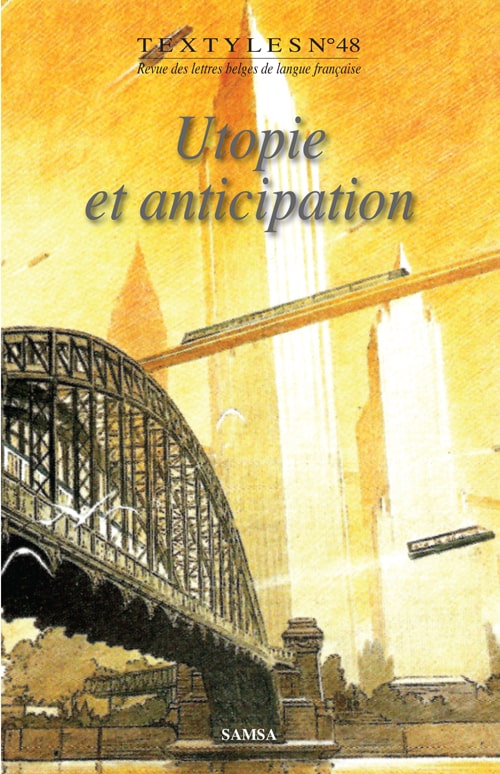
Textyles 48 : Utopie et anticipation
« Prolifique dans les littératures de l'imaginaire, la Belgique présente pourtant une inconnue à propos du récit d'anticipation. De la fin du monde de Rosny aîné…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

Prix du Roman noir de la Foire du Livre de Bruxelles : appel à manuscrits
Vous écrivez des polars, des thrillers ou des romans noirs ? Le Prix du Roman noir…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…

En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. En une dernière pirouette, Veronika Mabardi défend la parole brute et le théâtre-foutoir, révèle la beauté du déploiement d’un texte troué sur scène, clame la liberté de forme de ses écrits, revendique la perméabilité de ses mots, réveille les odeurs des Cerfs, Peau de louve et Sauvage et épingle ce qu’il convient d’ôter de sa pensée. Toujours dans cette dynamique d’ écrire ensemble , tu as rassemblé les récits de différentes personnes sur leurs maisons d’enfance 1 . En faisant ça, est-ce que cela t’a permis de savoir ce que serait ta maison idéale maintenant ? J’ai passé mon enfance à parler de ma maison idéale avec mon père. C’était un des grands thèmes entre nous. Il avait dessiné une maison-bibliothèque où tout était articulé autour d’une cage d’escaliers-bibliothèque. Et on se demandait : « Où mettrait-on tel livre ? » Mon problème plus concret est que je n’ai pas appris à changer une prise. Pourquoi je ne peux pas changer un robinet alors que je peux dessiner des concepts de maison ? Par contre, ce qui était particulier dans Maisons d’enfance , c’est qu’il était mené dans le Brabant wallon, d’où je viens. Ça me ramenait donc à un endroit où j’avais vécu et que j’avais quitté assez fâchée. Ça m’a raccrochée. C’était un projet coordonné par le Centre Culturel du Brabant wallon, avec l’IAD-Théâtre, et j’étais engagée pour récolter ces témoignages et en faire une pièce de théâtre. J’ai été rencontrer des gens, ils racontaient, on riait, on pleurait et je ne pensais pas beaucoup à la pièce de théâtre. J’étais dans la rencontre, j’enregistrais tout – comme toi – et puis, je suis rentrée, j’ai transcrit et, comme d’habitude, c’est magnifique, il n’y a rien à ajouter, peut-être juste à enlever pour mettre en lumière des choses. Il y avait une dizaine de témoignages et j’avais droit à quelques minutes par personne dans le texte. J'étais dans la matière – des portraits, des listes à la Perec et un carnet de bord –, plongée dans ce travail de peaufiner le portrait. Je rencontre le directeur de l’IAD à l’époque qui me dit : « Alors, comment ça marche, tu vas nous écrire une belle pièce ? » Je réponds : « Non, je ne crois pas... En fait, c’est tellement beau en soi, je n’ai vraiment pas envie d'ajouter une fiction à ces histoires-là, je crois que ça va être des monologues. » Il me dit : « Comment, il n’y aura pas de dialogues ? » « Des dialogues pourront s’inventer dans les trous, dans les espaces, mais je crois que je vais me limiter à la parole des gens qui est trop belle, je n’ai jamais rien entendu de pareil sur l'expérience d'habiter et d'être enfant donc ça va être ça. » Ça a été la crise avec les acteurs. Ils étaient inquiets de ne rien avoir à jouer. Je déclarais : « Non tu n’as rien à jouer, tu as juste à transmettre des choses, c’est magnifique, tu laisses passer ça dans ton corps, comme j’ai laissé passer ça dans mes doigts et tu respires aux endroits où ils respirent et tu vas sentir plein de choses. » Clash avec la professeure qui dit : « Si on fait ça, alors c’est quoi le théâtre ? » J’ai dit que, ça, ce n’était pas mon problème. Personnellement, le théâtre où les gens me montrent qu’ils font du théâtre, ça ne m’intéresse pas trop. C’est une belle question de se demander pourquoi on est touchés par ça et pas par des histoires rocambolesques et surjouées. C’était tous des gens adorables mais c’était la crise. Il y avait un étudiant qui était tellement fâché qu'il a dit qu’il ne travaillerait pas et qu’il s’en fichait. C’était un monologue d’un adulte qui se souvenait que son attachement, enfant, était avec un chien. Le comédien s’est alors assis sur une chaise, son chien à ses pieds et il a lu le livre, chargé par ce défi, qui rejoignait d'une certaine manière l'émotion de la personne qui avait parlé. C'était magnifique. Mon erreur, à l'époque, c'est de n'avoir pas pris le risque d'inviter les étudiants et leur professeure au dialogue, de n'avoir pas partagé avec eux en quoi je trouvais ces paroles théâtrales, il y avait beaucoup de place entre les mots pour la création. Quand Giuseppe Lonobile a monté Linden, c’est à cet endroit-là qu’il s’est placé : il a invité les actrices à se laisser traverser par le texte, ponctuation, rythme, résonances comprises. Je trouve que c'est très théâtral, se mettre à l’endroit de la parole de quelqu’un d’autre, dans le respect de cette dernière. Les actrices sont merveilleuses, elles se coulent dans la parole, c’est une transmission en chaîne. Et c’est là que ça devient intéressant, on rencontre des fantômes, on rencontre des autres. D’ailleurs, tu donnes une définition en creux du théâtre dans Sauvage , quand tu dis aimer les trébuchements, les indécences, les faux-pas, les silences, les ratés et qu’au milieu de ce foutoir, quelque chose émerge. J’adore cette définition, quand c’est tout lisse, il y a quelque chose d’angoissant. Tu en parlais pour dire que parfois le théâtre fait plus vrai que la réalité. Pour le moment, je fais une expérience super intéressante, je travaille avec Françoise Berlanger qui met en scène un texte, Maman de l’autre côté , où j’ai vraiment exagéré : de longs récits se télescopent avec de toutes petites phrases. Le texte est troué, plein de non-dits. Elle, elle transpose tout dans l’espace. Elle prend des risques, compose avec les mots, le son et toutes les dimensions. Ce que tu disais du volume , elle le recrée dans l’espace avec la musique. Ce que je pensais être du silence entre les phrases est en train de se remplir de regards, d'actions, de distances, de sons, de vie. Ce que j'imaginais suspendu entre les mots s'incarne entre les corps dans l’espace. C’est quand, ce prochain texte ? C’est du 17 au 28 janvier au Théâtre de la Vie . Est-ce que le théâtre te permet plus de liberté que le roman par rapport au métissage du langage, comme dans Linden, avec les segments de phrase en flamand ? Dans Linden, c’est tout bêtement parce qu’il y a un personnage flamand. Dans la prochaine pièce, il y a un personnage qui vit aux États-Unis. Il y avait du texte anglais, on l’a traduit parce qu’une des comédiennes ne parle pas cette langue et, dans la salle, il y aura des gens qui ne la parleront pas non plus. Quand on est dans la salle et qu’on ne comprend pas, on se sent exclu. Le temps qu'on pense qu’on ne comprend pas une chose qu’on est censé comprendre, on ferme tout et on rate une marche... C’était dommage, j’ai changé. Parfois, je me dis que tel écrit est du roman, que c’est pour quelqu’un qui a le temps de réfléchir, relire, regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire. Au théâtre, c’est immédiat. Par rapport au flamand, c’est différent : si quelqu’un dans la salle ne parle pas flamand, tant pis pour lui, on est en Belgique. Après tout, je suis aussi flamande. Avec l’anglais, je n’ai pas envie d’être dans ce rapport. Tes romans sont très différents. J’ai un peu feuilleté Rue du Chêne qui évoquait les romans du XVIIIe avec des noms de chapitres suivis de périphrases synthétiques avec ce qu’il va s’y passer alors que Les Cerfs, Peau de louve et Sauvage se rangent plus du côté de la poésie, où les idées viennent par vagues. Comment réfléchis-tu à la forme de tes romans ? Dans les romans que j’ai créés avec Anne Leloup (éditions Esperluète),…
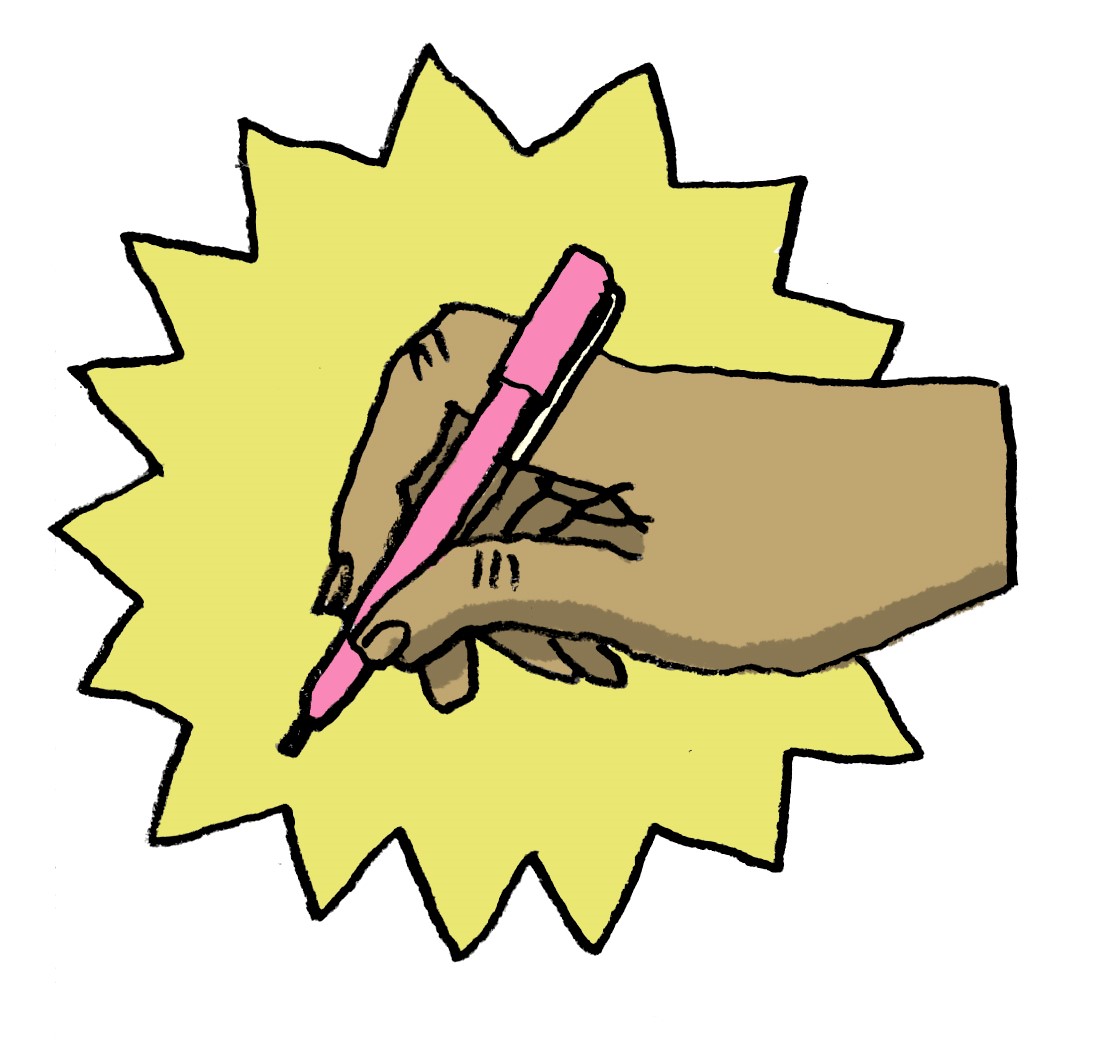
Bourses de soutien en Littérature de Jeunesse
La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie des bourses de soutien aux auteurs et autrices ainsi qu'aux illustrateurs et illustratrices en Littérature…

Appel à candidatures : Prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année…
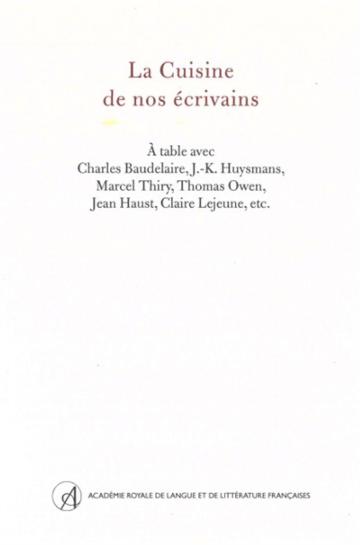
« Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme on est poète ». Incitant le lecteur au péché de gourmandise, Yves Namur cite Guy de Maupassant dans son introduction aux actes du colloque consacré à La cuisine de nos écrivains qui s’est tenu en octobre 2021, à l’occasion du centenaire de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique. La gourmandise est en effet de mise pour évoquer un sujet d’une telle ampleur. C’est que les écrivains ne manquent pas, qui ont fait de la nourriture un sujet à part entière ou la métaphore de leur art, et du repas, le subtil décor de leur roman ou le symbole de l’appartenance sociale de leurs personnages. Et que l’on ne s’y trompe pas, les auteurs et autrices dont il est question ici, « nos écrivains », sont belges ou français. Ce sont les écrivains de notre patrimoine littéraire, ceux qui ont façonné (et façonnent encore) notre imaginaire. La gourmandise, comme la littérature, n’a pas de frontière. Ainsi, Jean Claude Bologne parle de Flaubert, Zola et Proust dans un chapitre consacré à « l’architecture pâtissière » quand Jean-Baptiste Baronian se penche sur Baudelaire et ses découvertes culinaires belges, notamment.Les liens entre les écrivains et la nourriture, c’est aussi l’appétit d’écrire de Claire Lejeune qui a dû quitter l’école à seize ans, à la mort de sa mère, pour nourrir ses frères et a eu la révélation de l’écriture comme « autogenèse » en cuisinant pour son propre foyer des années plus tard.« La relation à la cuisine n’est évidemment pas la même pour un homme ou pour une femme », remarque Danielle Bajomée qui rappelle les réflexions d’Annie Ernaux et Mona Chollet sur le sujet. « [ T ] ête » mais aussi « bouche gourmande », Claire Lejeune écrit pourtant peu sur les nourritures terrestres. Comme Marguerite Duras, elle rédige un livre de recettes, mais elle le destine à sa sphère intime. Les recettes, glanées çà et là, sont familiales surtout, et se transmettent comme la mémoire des anciens.La présence de la nourriture en littérature se mue également en « hantise du repas » chez Huysmans. Comme le rappelle André Guyaux , de Des Esseintes ( À Rebours ) qui refuse de s’alimenter à Folantin ( À vau-l’au ) pour qui se nourrir est une obsession, la cuisine est capitale dans l’œuvre huysmansienne.Omniprésente dans la littérature, belge ou française, contemporaine ou patrimoniale, la nourriture l’est aussi dans la langue. Daniel Droixhe évoque les écrivains et philologues membres de l’Académie qui se sont attardés sur l’alimentation dans les dialectes de Wallonie. Il cite, par exemple, Pierre Ruelle et son ouvrage intitulé Dites-moi d’où viennent ces mots borains ?, dans lequel il est question de « l’âte levée » et de « grogne », mais aussi la poésie de Willy Bal et sa savoureuse description des fruits de saison, comme les « frambôjes » et les « pètches ». Après avoir distingué proverbe, dicton et phrase situationnelle, Jean Klein décortique la récurrence des aliments dans ce type d’énoncés.Enfin, évoquant, entre autres, Giono, Mallarmé et Maurice des Ombiaux, en guise de mise en bouche, Yves Namur s’attarde ensuite sur Thomas Owen et Marcel Thiry. L’œuvre de Thomas Owen, Les sept péchés capitaux, retient son intérêt pour son interrogation sur la figure du gourmand, bon gros paisible, accueillant, engourdi par la digestion ou […] être primitif et sanguinaire, trouvant son plaisir à mordre, à jouer de la dent ? mais surtout pour son portrait élogieux du personnage d’Igor bien bel homme […] qui ne vivait que pour manger. Chez Marcel Thiry, c’est le personnage d’Octave et son repas au Béfour (référence au restaurant parisien, Le Grand Véfour), décrit dans Comme si , qui fait l’objet de l’attention de l’Académicien.Et c’est avec une incitation à la gourmandise qu’Yves Namur clôture les actes d’un colloque qui ouvriront incontestablement l’appétit aux découvertes littéraires, sociologiques et linguistiques. Laura Delaye Plus d’information Le présent livre rassemble les actes d’un colloque organisé sur le thème de la cuisine de nos écrivains. Y ont contribué avec brio plusieurs membres de l’Académie qui ont tour à tour évoqué l’œuvre de quelques-uns de leurs prédécesseurs – Willy Bal , Maurice Delbouille , Jean Haust, Claire Lejeune , Thomas Owen , Maurice Piron , Pierre Ruelle , Marcel Thiry … – ainsi que les écrits de Joris-Karl Huysmans ou Charles Baudelaire. Quelques proverbes savoureux et l’«architecture pâtissière», envisagée…

Le Voyage en Oïlie XX . Une initiative très originale , à la base de laquelle on trouve Annie Rak et Roland Thibeau. Une écriture collective itinérante: qu’est-ce donc à…

Bourses d'aide à la création en littérature de jeunesse
Appel complémentaire dans le cadre des mesures de renforcement des soutiens aux projets en littérature de jeunesse…
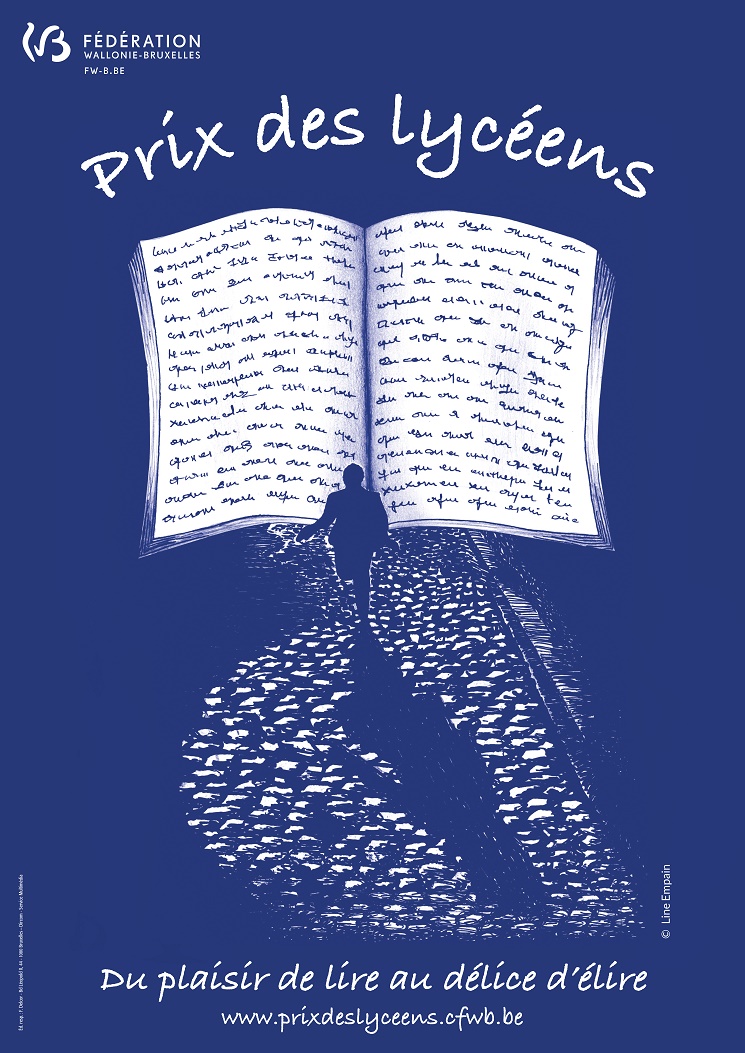
Prix des lycéens 2022-2023 : les cinq finalistes
Les cinq finalistes du Prix des lycéens de littérature 2022-2023 sont connus. Les élèves participants vont à présent avoir le plaisir…

Résidences d’écriture au Québec : appel à candidatures
Dans le cadre d’un accord d’échanges entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI et le CALQ, deux auteurs…
- Page précédente
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 29
- Page suivante
