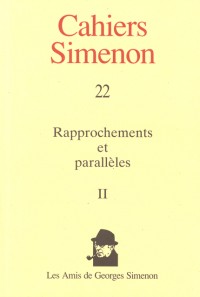La critique à l’ère numérique (in Dossier)
Écrire sans contraintes avec autant de photos ou de documents possibles, ne pas être assujettis à un nombre de caractères ou à un format, c’est possiblement une promesse de la presse numérique et des revues web. Comment ces revues ont-elles vu le jour ? Comment fonctionnent-elles ? Qui les font ? Y a-t-il un revers de la médaille, le web est-il vraiment un paradis ? Blogs, sites, agendas en ligne, sites d’artistes, l’information web est protéiforme. Alors comment se repérer sur la toile et trouver le chemin qui mène à l’information ? Puisque, paradoxalement, ce n’est pas parce qu’elle est en ligne, qu’elle est accessible. * La filiation papier et web La corrélation directe entre le web et le papier permet de s’orienter plus facilement. Les journaux, généralistes comme Le Soir, La Libre Belgique, ou spécialisés tels que Mouvement, Inferno, développent un format web en lien avec la version papier. Dans ce cas, l’accès parait simple, bien que la subtilité des « tags » (étiquettes) et dénomina- tions complexifie la recherche (sous le mot « scène » se retrouvent des articles que l’on ne trouve pas sous le mot « danse » et vice versa). Là s’ouvre la boîte complexe de la terminologie. De plus, écrire pour le web ne garantit en rien que l’on est lu. Les moteurs de recherche fonctionnent de telle façon que plus un site est consulté plus il va appa- raître en tête de liste lorsque l’on fait une recherche. La boucle est bouclée qui rend parfois complexe l’accès à des initiatives plus inventives et spécifiques. En 2013, Agnès Izrine décide de faire une version web du magazine Danser. La fin de 30 ans de parution avait été si abrupte et difficile que, selon sa rédactrice en chef, « cela ne pouvait pas finir comme ça ». En créant « Dansercanalhistorique », elle pense alors développer un magazine web plus ou moins éphémère. L’expérience est un succès : le site est au- jourd’hui encore actif et enregistre jusqu’à 7 000 consultations par mois. Les lecteurs du magazine papier se sont déplacés vers le site, animé par l’équipe originale de la version papier. « Dansercanalhistorique » est le prolongement numérique de ce que fut le magazine Danser, une référence en termes de magazine spécialisé traitant de toutes les danses. La ligne éditoriale est de même facture, avec la possibilité d’augmenter l’espace des photos et d’ajouter des liens vidéo, et la liberté de sortir des contraintes du nombre de caractères. En- thousiaste, Agnès Izrine voit dans le numé- rique des possibilités pour l’avenir. Le numérique, c’est l’indépendance... Pour Marie-Christine Vernay, l’aventure commence quand elle claque la porte de Libération pour fonder le site « Delibere.fr » avec Édouard Laumet et René Solis. « L’essentiel était de préserver un espace d’écriture et un espace critique qui, pour nous, n’existaient plus. L’intérêt du web réside dans le fait qu’il n’y a pas de limite, on n’est pas cadré par des pages, des ultimatums autres que nos propres envies. J’ai inventé – ce que l’écrit papier ne me permettait pas auparavant – une chronique intitulée Chanson de gestes, où je décrypte les gestes quotidiens des gens, les gestes qui apparaissent, ceux qui disparaissent. Le web élargit le champ et permet de traiter de la danse de différentes façons. » Pour « Radio Bellevue Web », Marie-Christine Vernay ouvre de nouveaux espaces, imagine une rubrique où elle pose une simple question – « Est-ce que vous dansez ? » – à des politiques, des chorégraphes, et, ce faisant, éclaire la danse en creux. Le web peut s’avérer un champ d’investigation, d’inventions, une création de nouveaux espaces pour une pen- sée personnelle, une façon de se libérer de la contrainte du papier. ... mais c’est aussi le bénévolat Quelle est la différence entre un site et un blog ? La frontière est très poreuse. Le blog a priori s’apparente au journal intime ou au carnet de notes, souvent tenu par une seule personne, contrairement au site qui serait réalisé par une équipe. Cependant, nous pourrions citer une dizaine de contre-exemples avec des blogs menés à plusieurs. D’un point de vue technique, un site et un blog n’ont pas la même sorte d’interface et d’arborescence, mais la frontière n’est pas si tranchée, des blogs pouvant ressembler à des sites et vice versa. Blog ou site, ce qu’offre l’internet à la critique se résume à du bénévolat et à des personnes qui s’essaient à la quadrature du cercle pour trouver des moyens de financement. Ainsi, si Agnès Izrine bénéficie d’une subvention du ministère de la Culture, qui lui permet tant bien que mal de payer ses collaborateurs, elle trouve les annonceurs encore trop frileux et n’est pas encore parvenue à trouver un équilibre financier. À « Radio Bellevue » et à « Delibere.fr », tous les collaborateurs sont bénévoles. Selon Marie-Christine Vernay, les moyens financiers restent encore à inventer. Un espace pour l’émergence ? Le projet du blog « Un soir ou un autre » mené par Guy Degeorges emprunte des voies bien différentes. Son auteur a commencé il y a une dizaine d’années. Animé par le désir d’écrire, il s’est tourné vers la critique de théâtre et a rencontré la danse après coup, un peu par hasard. L’aventure est modeste : Guy Degeorges travaille seul, il revendique un non professionnalisme et affirme une subjectivité. Il est curieux et, à force d’écrire sur les formes émergentes et la jeune danse, il a peu à peu intégré le monde professionnel de la danse parisienne. Les jeunes chorégraphes l’invitent à voir leur premier spectacle, pour lequel ils espèrent en retour un article. Depuis 10 ans, Guy Degeorges est le témoin privilégié de l’émergence parisienne, avant lui peu relayée par la presse, par manque de temps, par manque de place. Car la presse web sert aussi à cela : ouvrir des espaces et faire découvrir de nouvelles démarches. Sarma, espace de ressources pour artistes et théoriciens Ouvrir des espaces pour les pratiques discursives a été un des moteurs de la création de l’association flamande Sarma en 2000. La première impulsion de Jeroen Peeters et Myriam Van Imschoot, critiques et fondateurs du projet, était de collecter articles et écrits sur la danse et la performance, de créer des archives qui puissent être consultées en ligne, et devenir vivantes au service des artistes aussi bien que des théoriciens. Sarma est devenue au fur et à mesure de son développement une véritable plateforme de recherche où pratique et théorie dialoguent, où critiques, artistes, dramaturges et théoriciens se rencontrent et collaborent, où les frontières entre chercher et faire deviennent poreuses. L’association élargit ses activités en organisant des col- loques, invite des artistes à partager leurs pratiques et leurs questionnements, interroge les pratiques en lien avec la dramaturgie, crée des événements avec des universités comme celle de Stockholm ou encore la formation EXERCE à Montpellier. Tout en gardant le fil ténu de la relation théorie, pratique discursive et création, Sarma se déploie avec une inventi- vité infinie. En 2012, elle crée « Oral site », une plateforme consacrée à l’oralité, considérant que la création de discours, les traces et les archives ne sont pas uniquement le fait de l’écrit et qu’il serait temps d’embrasser le travail du son et du dessin dans cette réflexion. Ainsi, depuis plus de dix ans maintenant, la presse web a totalement intégré le circuit de production du spectacle vivant. Elle écrit des ar- ticles qui sont relayés par les institutions culturelles, les compagnies de danse, leur donnant, littéralement, une visibilité ; elle nourrit le travail et la réflexion des artistes et ce faisant offre une plus-value, pour utiliser le champ sémantique de l’économie. Les compteurs…