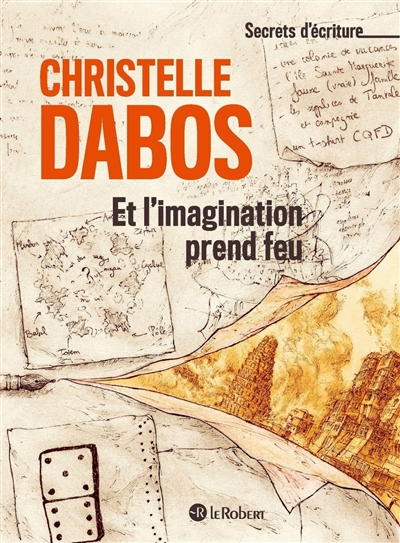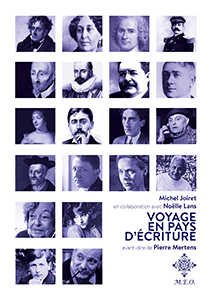
Il existe entre un livre et son auteur un espace d’exploration littéraire que Michel Joiret appelle en collaboration avec Noëlle Lans, « Voyage en pays d’écriture ». Le principe en est cristallin : partir sur les traces des écrivains, là où ils ont commis leur œuvre et y découvrir ce que les sens de la présence sur place peuvent offrir. C’est-à-dire les non-dits des auteurs et l’esprit des lieux d’écriture. Depuis 1995, la revue Le Non-Dit , entreprise compagnonique , guide ses lecteurs-voyageurs dans l’environnement des écrivains et fait « parler les pierres qui leur ont servi de refuge ». Il en est ainsi du premier colloque à Epineuil-Le-Fleuriel où est située l’école d’Alain-Fournier, auteur du Grand-Meaulnes. Plusieurs convives s’y sont réunis pour mesurer le livre aux lieux mais aussi aux grammairiens belges.De même en 1999 au Grand-Hôtel de Cabourg, « en front de mer, avec piano-bar et musique d’époque ! » pour diverses lectures de l’œuvre-cathédrale de Marcel Proust. À lire toutes les interventions d’alors, le verbe se lève et souffle tant que la plume se montre absolue : on se demande si l’écriture de Proust émane de lui ou bien si c’est Proust qui émane de l’écriture ?En 2000 aux refuges de Pierre de Ronsard et de Pierre Loti, il est question d’un fil rouge reliant les roses sur les lieux des cimes amoureuses du premier à « la lourde et odorante végétation de Nagasaki » du second. Soit à l’instar de tout l’ouvrage, un fil de textes courts et autonomes ; érudits sans assommer.Quelle somme justement ! de témoignages, de recherches, de lectures, d’extraits, de citations et d’anecdotes pour fonder ce livre de voyages qui se fondent en une déclaration de passion pour la littérature. Nous glissons la tête derrière des rideaux vers les coulisses de temps perdus, dont seuls l’air et la lettre peuvent encore témoigner.Voyager en pays d’écriture donne faim et soif de tout lire des auteurs visités, tant les frontières entre les livres deviennent aussi précaires voire absurdes qu’entre les pays, une fois que l’on est sur place. Un genre cependant ressort de l’ouvrage, celui du romantisme, destination en 2002 via Chateaubriand et George Sand.Michel Joiret y fait l’aveu de son propre romantisme : « Drôle de question pour une curieuse époque, la nôtre, où beaucoup se sait, où peu se sent, où tant d’émotions sont en jachères et où le non-dit des échanges gagne le terrain perdu des années… Déçus par les philosophes (anciens et nouveaux), beaucoup se tournent vers des cultures et des religions « éprouvées » et sûres. »« En 2003, Le Non-Dit propose une rencontre avec quelques écrivains belges établis dans la capitale française, un projet qui séduit une quarantaine de personnes, principalement des enseignants. » En effet, le projet en association avec l’Enseignement du Hainaut ne veut pas seulement interroger des frontières géographiques, mais aussi celles des élèves avec la lecture, à l’aide de leurs professeurs. Historique, culturel, romantique, pédagogique, tel est-ce de voyager en pays d’écriture.Et ainsi de suite jusqu’en 2017 avec Aragon et Cocteau entre Milly-la-Forêt et Saint-Arnoult-en-Yvelines. L’index du livre compte 228 auteurs interpellés par une écriture soignée. Michel Joiret est manifestement un grand amoureux, compulsif et pas jaloux, qui aime comme un fou et invite avec ses collaborateurs et intervenants à admirer, adorer la littérature. Tito Dupret Les écrivains du passé n’ont jamais cessé de nous parler. Il nous appartient de les écouter, même si l’écoulement du temps a pu érailler leurs voix, même si les relais de lecture intergénérationnels sont aujourd’hui moins assidus, même si la primauté de l’image a pu dérouter les chemins d’écriture. L’œuvre des Illustres est l’ADN de chacun de nous. Quand l’oreille intérieure et l’œil se font moins vifs et sortent du champ de lecture, il nous reste le trésor des pierres, des lieux signifiants – comme les aubépines de Marcel au Pré Catelan –, l’intimité d’une table, d’une plume et d’un encrier – comme l’écritoire de Jean-Jacques à Montmorency. Comme l’écrit Pierre Mertens dans son avant-dire : « Allons ! Comment se lasserait-on de ces retours aux sources sur les lieux du crime – ce crime fameusement “impuni” : la lecture ? » Ou la relecture ?… Au fil de ses voyages, ses rencontres et ses chemins d’écriture, la revue « Le Non-Dit » nous emmène sur les traces d’Alain-Fournier, Marcel Proust, Pierre de Ronsard, Pierre Loti, François-René de Chateaubriand, George Sand, Maurice Leblanc, Madame de Sévigné, Alexandre Dumas, François Rabelais, Michel de Montaigne, Erasme, Colette, Blaise Cendrars, Pierre Mac Orlan, Francis Carco, Georges Brassens, Jean-Jacques Rousseau, Maurice Maeterlinck, Marguerite Duras, Jean Cocteau,…
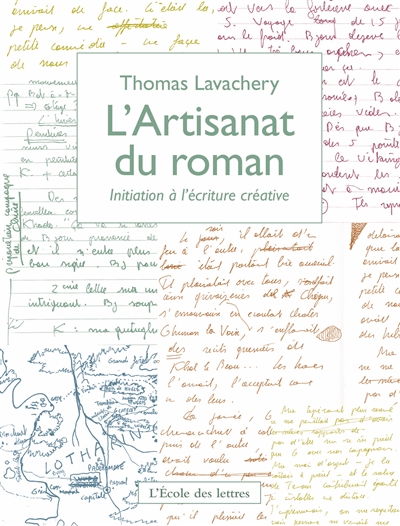
L’artisanat du roman : Initiation à l’écriture créative
Destiné à ceux et celles qui écrivent ou que l’écriture de fiction tenterait, cet essai est nourri de la demande faite un jour à Thomas Lavachery d’animer un séminaire autour des « Pratique de l’écriture pour la jeunesse » dans le cadre d’un master consacré aux métiers du livre jeunesse créé par l’Université Charles de Gaulle, Lille 3 . Auteur jeunesse prolixe et reconnu, notamment pour sa saga Bjorn le Morphir parue à L’école des loisirs où l’essentiel de son œuvre est publié, Thomas Lavachery s’appuie sur son expérience, et il n’hésite pas à l’écrire, sur certaines de ses erreurs pour prodiguer ses conseils aux candidatꞏeꞏs écrivainꞏeꞏs, et on sait qu’ils et elles sont nombreuxꞏes tant la littérature fait (encore) rêver certainꞏeꞏs.S’il s’est appuyé sur son propre travail pour écrire cet essai de creative writing comme on dit du côté anglo-saxon où les formations sont nettement plus répandues qu’en littérature francophone, Thomas Lavachery cite aussi de multiples confrères et consœurs, parfois en comparant leurs pratiques. Citons Tolkien, J.K. Rowling, Simenon, Marguerite Yourcenar, Paul Auster, George Orwell, Elena Ferrante, Stendhal, Proust, Flaubert, Dostoïevski, mais surtout Jules Verne et Alexandre Dumas, le plus cité dans le livre. Notons que Thomas Lavachery rend une autre forme d’hommage à ces aînéꞏeꞏs en les portraiturant lui-même dans cet essai. Il ne manque pas de faire référence à Stephen King pour son livre Écriture, mémoires d’un métier , ou Robert-Louis Stevenson pour ses Essais sur l’art de la fiction , mais également La dramaturgie, les mécanismes du récit , d’Yves Lavandier et Le roman d’aventures de Jean-Yves Tadié. Thomas Lavachery propose d’ailleurs en fin de volume la bibliographie du parfait apprenti écrivain.Sur ces bases pratiques et théoriques, il passe en revue divers éléments de l’écriture créative comme le plan de départ, le synopsis, l’intrigue, le schéma narratif, l’ironie dramatique, la crédibilité, les personnages, les descriptions et les dialogues qui sont d’authentiques créations, le temps romanesque avec ses rythmes et ses ellipses, pour n’en citer que quelques-uns. Précisons que chaque chapitre se termine par des exercices pratiques d’écriture pour ceux et celles qui voudraient passer à l’action sur écran ou sur papier. Là aussi les pratiques varient.Si Thomas Lavachery aborde les genres littéraires comme le roman d’aventure et le roman historique auxquels on le sent attaché, tout comme la littérature jeunesse avec un chapitre consacré aux illustrations et aux interactions avec le texte, il passe sous silence d’autres approches scripturaires comme celles du Nouveau Roman.Écrire est une chose, éditer en est une autre. L’ouvrage se termine sur cette autre réalité en évoquant les liens particuliers qui se nouent entre les auteurs et autrices avec leurs éditeurs ou éditrices, lecteurs et lectrices, correcteurs ou correctrices, voire les sensitivity readers , apparus dans le sillage du politiquement correct et du wokisme pour veiller à ne choquer aucune sensibilité au risque d’édulcorer les textes.Si vous souhaitez deux conseils d’écriture pour terminer, nous avons épinglé ceux-ci cités dans L’artisanat du roman : « Il n’y a qu’un seul art : l’art d’omettre ! », de Stevenson et « La bonne prose est comme une vitre transparente », d’Orwell. Il n’y a plus qu’à… Michel Torrekens Plus d’information Les académies existent pour la peinture, la sculpture, la musique… S’agissant du roman, l’inspiration serait seule à l’oeuvre. Tout viendrait des Muses et rien de la technique. C’est du moins l’idée qui a longtemps prévalu dans les milieux littéraires francophones. Une évolution se dessine cependant, et les cours d’écriture créative, ateliers et autres workshops commencent à fleurir en France et en Belgique. Thomas Lavachery, romancier, chargé d’un cours de pratique de l’écriture pour la jeunesse à l’Université de Lille, livre ici ses idées sur l’art de la fiction. Ses réflexions sur les grands ressorts du roman – l’intrigue, les personnages, les descriptions, les dialogues… – sont illustrées de maints exemples et prolongées par des exercices d’écriture. L’Artisanat du roman propose une initiation personnelle et passionnée à ce métier si beau : romancier. « Écrire n’est pas différent des autres activités humaines, assure l’auteur. La maîtrise technique est source…