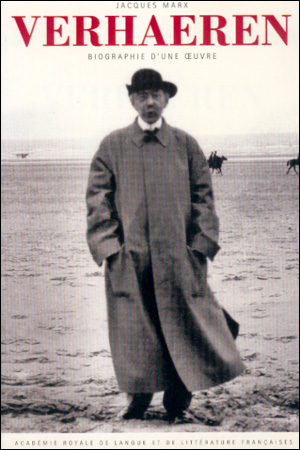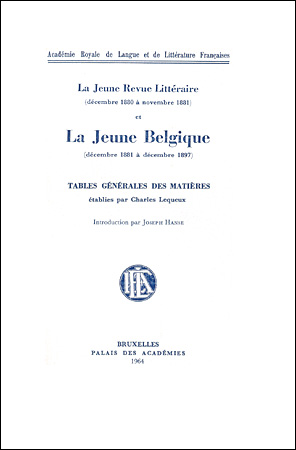Auteur de Uwe Johnson, le scripteur de mur
Toujours soucieuse de gratifier les œuvres d'un projet cohérent, la critique a souvent choisi celle de Mertens comme celle d'un observateur impitoyable de notre temps. Comme l'écrivait Paul Émond, «il constitue un point de repère symbolique pour toute une génération». Avec Mertens, c'est, en effet, différentes régions de l'esprit qui sont traversées : littérature et philosophie, critique littéraire et politique, droit international, cinéma, musique, opéra, théâtre.
Sa passion de l'art n'a d'égale qu'un souci rigoureux du politique. Une même tension l'anime, dans son combat pour la modernité et contre les maquignonnages culturels lorsqu'il s'attache à faire entendre Semprun, Kundera ou Cortazar, ou quand il constitue, en 1976, le dossier spécial des Nouvelles littéraires, intitulé «L'Autre Belgique», et dans lequel apparaît le concept de belgitude.
Pierre Mertens naît à Boitsfort, le 9 octobre 1939, date, se plaît-il à rappeler, qui est aussi celle de la décision prise par Hitler d'envahir la Belgique… Son père, journaliste, et sa mère, biologiste, se séparent pendant l'enfance du petit Pierre qui prétendra avoir eu l'avantage de pouvoir, dès lors, puiser à deux bibliothèques : celle plus spiritualiste et catholique de son père, celle plutôt laïque et de gauche, de sa mère.
Lecteur boulimique, passionné dès l'école primaire, Pierre Mertens naît vraiment à la littérature lorsqu'il découvre, à l'âge de quinze ans, le journal de Kafka. Il dira plus tard : «Cette page tournée, une page de ma vie s'était tournée aussi : c'est la page qui m'a fait écrivain. L'homme qui avait pu écrire cela m'apportait la seule consolation écrire. C'était à la fois la maladie et le remède… On pouvait en mourir, donc en vivre.»
Il entre en philologie romane à l'Université libre de Bruxelles, pour en sortir quelques semaines plus tard, de crainte de se dessécher et opte pour des études de droit. Cela ne l'empêche nullement d'écrire, pendant ses trois premières années universitaires, un manuscrit de deux mille pages intitulé Paysage avec la chute d'Icare qu'il retravaille et rebrasse : ses deux premiers romans, L'Inde ou l'Amérique et La Fête des anciens, ainsi que son premier recueil de nouvelles, Le Niveau de la mer, reprendront à leur manière des éléments de Paysage… Ils sont l'aboutissement d'un questionnement autobiographique détourné à propos de l'enfance et de ses blessures. Les romans qui suivent ne quitteront pas les thématiques individuelles, mais y associeront de plus en plus l'espace de l'Histoire : l'année de publication des Bons Offices (qui narre les rendez-vous ratés de Paul Sanchotte avec les grands événements de son temps et le dérisoire de ses médiations d'observateur international) sera aussi celle de L'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité, un essai juridique.
Menant de front son activité littéraire et ses exigences de juriste-citoyen, Mertens continue à s'intéresser au droit international et à la sociologie (il est docteur en droit et licencié en droit international de l'Université libre de Bruxelles). Professeur de littérature comparée à l'Institut national supérieur des arts du spectacle (I.N.S.A.S.) et chroniqueur littéraire au Soir depuis 1971, critique dans diverses revues françaises et étrangères, chargé de nombreuses missions d'observateur au Proche-Orient, en Europe de l'Est et dans le bassin méditerranéen, Pierre Mertens ne renonce ni à ses activités dans le siècle, ni à l'écriture. Il serait plutôt de ceux – très rares – qui parviennent à alimenter l'écriture à l'histoire et à nourrir cette dernière d'une vision politique et morale. C'est à cette veine étonnante qu'appartiendront Terre d'asile, roman intimiste sur le laminage de l'individu par le politique, Les Éblouissements, qui retrace le cheminement spirituel, les angoisses et les fragilités du poète et médecin allemand Gottfried Benn, Uwe Johnson, le scripteur de mur et Lettres clandestines. Son dernier roman, Une paix royale, concilie, dans son baroque chatoyant, d'une part, l'interrogation sur l'Histoire, de l'autre, les confidences très intimes dont Perdre, roman d'amour fou, théâtral, figure la tentative-limite. Par son insertion directe dans les événements qui ont entraîné l'abdication de Léopold III, Une paix royale a connu un large retentissement et suscité une action en justice qui lui a valu le soutien de plusieurs écrivains célèbres. Mertens semble donc bien, comme on l'écrivait dans Pierre Mertens, l'arpenteur, un écrivain de l'entrelacement de l'autobiographique et du mondial, du quotidien et des apocalypses toujours fiancés.
Les ouvres critiques comme L'Agent double, les recueils de nouvelles, le livret d'opéra La Passion de Gilles, ainsi que les pièces Collision et Flammes rejoignent cette coulée d'écriture qui dessine l'épaisseur d'un imaginaire personnel hanté par l'éclatement et la dispersion, par la violence fondamentale du monde, les déchirements et les maladies du corps social et de l'histoire.
Œuvre tragique que celle de Mertens, mais que le combat habite comme sa condition. Lutte incessante contre toutes les formes d'oppression et d'humiliation, contre l'exil extérieur ou intime. Et si ses personnages sont, on le sait, des êtres déchirés, en position essentiellement transitive, des dépossédés, le plus souvent, les textes leur font accomplir une curieuse dérive au-delà de la détresse, comme si la perte offrait aussi l'obscure possibilité d'un lointain dans une passion de l'ouvert, absolue. Jouant tantôt dans le registre de la simplicité nue, tantôt sur la causticité des dialogues, tantôt sur la gravité ou la sophistication raffinée, l'écriture de Mertens est aussi contestation esthétique et idéologique du récit classique comme des structures élémentaires d'un certain Nouveau Roman.
L'Inde ou l'Amérique a obtenu le prix Rossel, tandis que le Prix triennal de la Communauté française récompensait les nouvelles d'Ombres au tableau (1982) et le prix Médicis 1987 Les Éblouissements. Traduite en plusieurs langues, l'œuvre de Pierre Mertens est largement reconnue au niveau international. Il a été élu à l'Académie royale de langue et de littérature françaises le 11 février 1989.