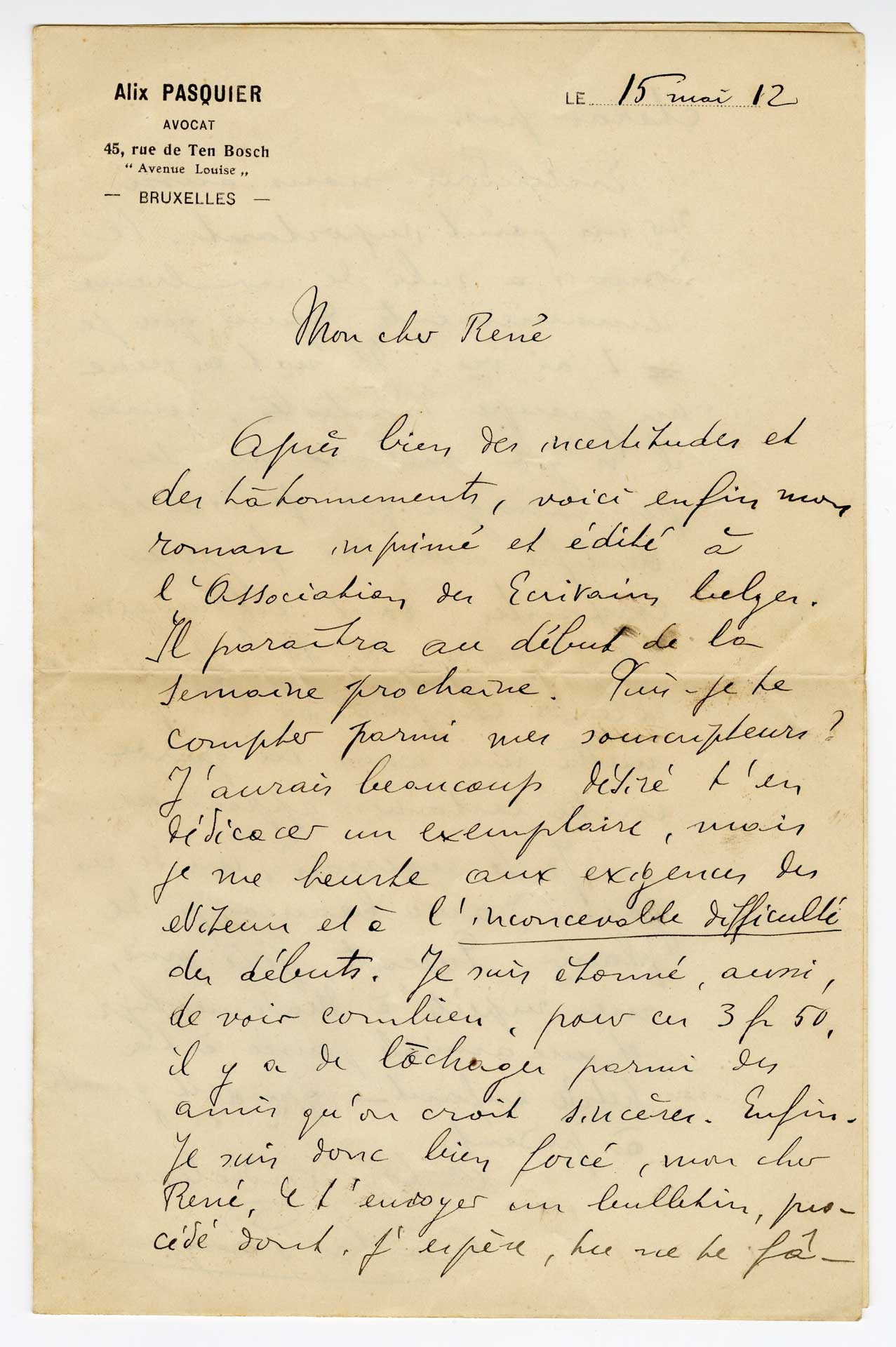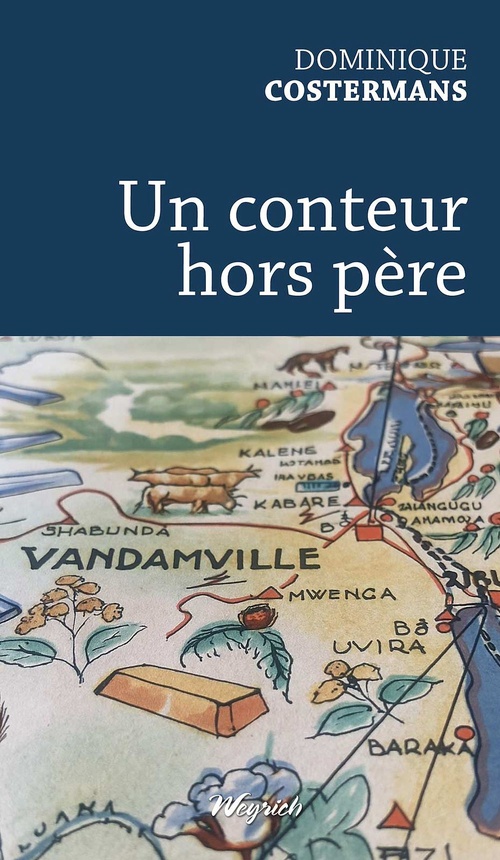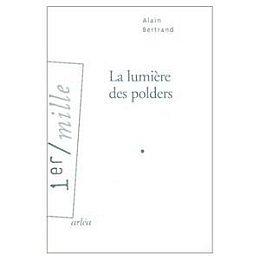Jean Scutenaire (1905-1987), dit Louis Scutenaire est considéré comme l’un des principaux écrivains du groupe surréaliste bruxellois. Pourtant, poète « anti-littéraire » surréaliste bien peu proche de l’orthodoxie parisienne d’André Breton, Belge picard aux origines diverses, il aimait se décrire comme n’étant « ni poète, ni surréaliste, ni Belge », échappant ainsi aux classements trop faciles des anthologies littéraires.
L’écrivain est né le 29 juin 1905 à Ollignies, près de Lessines, en Picardie hennuyère. Fils unique d’un couple de petits employés, il passe une enfance tranquille dans cette région wallonne de la frontière française. Il évoquera souvent avec nostalgie cette période de sa vie et aimera souligner ses origines picardes, en employant par exemple certaines expressions venant de ce dialecte dans ses œuvres, comme dans
Les Vacances d’un Enfant.
Scutenaire apprend à lire dès ses quatre ans, et dévore tout ce qui lui tombe sur la main. Il apprécie les livres illustrés, comme
Bécassine ou
Les pieds nickelés, la littérature populaire d’Eugène Sue ou d’Alexandre Dumas, et plus tard la poésie d’Arthur Rimbaud, de François Villon ou de Stéphane Mallarmé sortie de la bibliothèque paternelle. Ce goût éclectique et cette passion du livre le suivront sa vie durant et lui confèrent très tôt un certain attrait pour l’écriture. Son professeur l’encourage à rédiger ses premiers poèmes dès l’âge de 10 ans. Scutenaire entame par la suite des humanités gréco-latines, mais, élève indiscipliné, il préfère la boxe et le vagabondage aux versions. À Ollignies, il aime passer du temps aux côtés des gens du peuple. Les grèves qui éclatent souvent à Lessines lui ouvrent les yeux sur les réalités sociales du début du XX
e siècle. Il en développera une aspiration constante à la justice sociale, lui qui se déclarera encore staliniste lors des heures les plus sombres de l’URSS, par « provocation, fidélité, et conservatisme ».
De 1919 à 1923, une longue pleurésie le cloue au lit et le laisse profondément affaibli. Il en conservera une santé fragile à vie. En 1924, sa famille s’installe à Bruxelles au 20 rue de la Luzerne, dans une maison que Scutenaire ne quittera jamais. Il entreprend alors des études de droit à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) qu’il termine tant bien que mal en 1929.
C’est à cette époque que sa destinée se mêle à celle des surréalistes bruxellois. Attiré par ce mouvement littéraire tonitruant qui vient d’émerger entre Paris et Bruxelles, il contacte
Paul Nougé en 1926 et le rencontre ainsi que
Camille Goemans,
René Magritte,
E.L.T Mesens, et
Marcel Lecomte. Par cet intermède Scutenaire croise le chemin de l’écrivaine
Irène Hamoir, qui, séduite par sa prose, devient son épouse en 1930. Complice, ce couple d’écrivains reste uni jusqu’au décès de Scutenaire, et rédige parfois des œuvres à quatre mains. L’année de ses noces, le jeune homme entame son barreau et devient avocat pénaliste, il aime alors s’occuper des voyous et éprouvera toujours une certaine attirance pour les milieux de la pègre, qu’il mettra parfois en scène dans ses œuvres littéraires.
L’auteur écrit déjà sans relâche des poèmes, tracts, notes de lectures, mais publie peu avant la seconde guerre mondiale. Scutenaire est l’un des écrivains les plus prolifiques du groupe surréaliste, son écriture est spontanée, fleurie, pleine d’imagination. À l’époque cependant, il reste réfractaire à l’édition. Le surréaliste se décrit alors comme « conduisant poétiquement des entreprises anti-littéraires ». Un iconoclaste donc, qui réalise notamment des pastiches et détournements de romans d’autres écrivains afin de désacraliser les grands noms de la littérature.
Durant leurs voyages en France, le couple Hamoir-Scutenaire fréquente les surréalistes français, notamment Paul Eluard et René Char. Ces relations vont s’enrichir encore lors de leur exode durant la débâcle de 1940, ils font alors la rencontre de nombreuses personnalités littéraires dont André Gide ou Gaston Gallimard. Scutenaire connait alors une période très productive. Il rédige le roman l
es Vacances d’un enfant, un premier essai sur son ami Magritte, ainsi que le premier tome de ses
Inscriptions (1943-1944). Suite à une menace de rupture, Hamoir parvient à le convaincre de publier ces écrits. Les
Inscriptions paraissent donc aux éditions Gallimard grâce à l’entremise d’Eluard, de Paulhan et de Queneau en 1947.
C’est à cette époque qu’il troque son prénom Jean contre celui de Louis. Mensonge ou vérité, il explique que dans son village, les enfants de bourgeois l’appelaient Jean, ceux du peuple Louis, ce changement serait donc un symbole de la lutte des classes. C’est aussi une manière malhabile de protéger son anonymat face aux supérieurs de sa toute nouvelle fonction. Dès 1941, il devient de fait fonctionnaire à Bruxelles au Ministère de l’Intérieur, emploi qu’il conserve jusqu’à sa retraite, en 1970.
Après 1947, l’écrivain signe surtout des tracts, des préfaces d’expositions ou d’ouvrages. Il collabore à de nombreuses revues surréalistes comme
La Carte d’après nature,
Les Temps mêlés, l
es Lèvres nues. Ami indéfectible de
René Magritte, et ce, quarante années durant, il le soutient dans ses aventures artistiques les plus scandaleuses, comme lorsqu’il rédige la préface à l’exposition
Vache du peintre en 1948. Il sera par ailleurs l’auteur d’une centaine de titres de tableaux de Magritte, comme
Golconde (1953).
En 1963, le second volume des
Inscriptions est terminé, il ne paraîtra qu’en 1976 à Bruxelles. Deux autres volumes suivront, l’un en 1984 et l’autre posthume en 1990. Ces recueils de maximes amassées pêle-mêle durant quarante ans constituent l’essentiel de son œuvre littéraire. En 1984, son œuvre
La cinquième saison, en fait un fragment des
Inscriptions, se voit décerner le Grand Prix Spécial de l’Humour noir à Paris.
Louis Scutenaire décède le 15 août 1987, 20 ans jour pour jour après son ami Magritte, dans sa maison rue de la Luzerne.
Irène Hamoir lègue ses archives et sa précieuse bibliothèque de bibliophile à la Bibliothèque Royale.