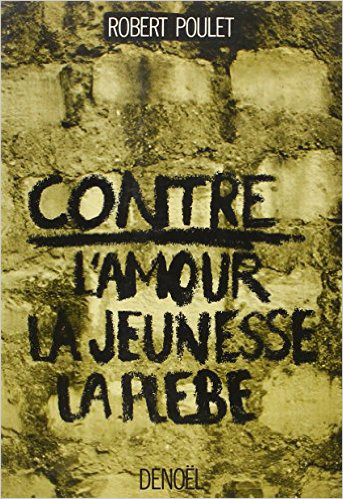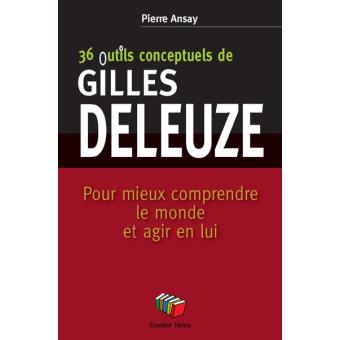
36 outils conceptuels de Gilles Deleuze. Pour mieux comprendre le monde et agir en lui
Gilles Deleuze ! Qui voudrait encore le lire ? Se perdre puis se retrouver, un peu, puis se reperdre, beaucoup, dans les méandres d’une des pensées les plus vagabondes et les plus libres du siècle dernier ? Qui ?Pas les tenants du statu-quo, les cyniques à-quoi-bonistes ou les sempiternels râleurs et découragés de la vie, en tout cas ! Pas ceux et celles, non plus, qui se contentent des livraisons expresses de la pensée, du prêt-à-penser. C’est que pour lire Deleuze, il ne faut pas avoir peur de perdre pied. De se laisser couler. De remonter les moindres petites flaches, petits cours d’eau. La pensée de Deleuze est un milieu. Un territoire. On n’explore pas un milieu de façon « logique ». On y va au petit bonheur. De façon nomade. Allant de découverte en découverte. Soulevant les cailloux. Goûtant, par curiosité, aux plantes. Au risque, parfois, d’en avoir l’estomac retourné. De n’en tirer rien de bon. Au risque, parfois, de découvrir, au détour d’une page, une phrase, un paragraphe, subitement lumineux. Éclairant tout à coup quelque chose. Un point jusqu’alors obscur de nos vies ou du monde. Quelque chose qui nous échappait.Pensées vitales et vitalistes.Pierre Ansay navigue, quant à lui, dans ces belles eaux philosophiques depuis pas mal de temps. Après avoir commis deux livres sur Spinoza, cet autre « penseur de la vie », un ouvrage nous présentant Gaston Lagaffe en philosophe deleuzien et spinozien qui s’ignore, voici donc qu’il aborde en pédagogue l’œuvre de Deleuze – et, par la bande, celle de son comparse, Félix Guattari.A priori, il pourrait sembler étrange, et tout à fait anti-deleuzien, de présenter cette œuvre en « 36 outils conceptuels ». Pensée éminemment fluide, pensée toujours fuyante, sautant allègrement d’une matière à l’autre, créant des ponts inattendus et réjouissants entre, entre autres, la politique, la psychanalyse, l’anthropologie, la sociologie, la littérature, le cinéma, etc., on pourrait craindre que la réduire ainsi en simples outils pratiques en tuerait tout le sel, toute la singularité. Mais non ! Ô joie ! C’est tout le contraire qui se passe. Le livre de Pierre Ansay est une splendide invitation à lire ou à relire ces œuvres philosophiques majeures que sont Mille plateaux ou L’Anti-Oedipe . Le livre de Pierre Ansay est une magnifique introduction à cette philosophie anarchiste, toujours prompte à débusquer les rapports de force et de pouvoir. À nous donner des balises, des outils de pensée, pour sortir de nos routines, de nos points de vue trop étriqués. Non pas que Deleuze et Guattari nous auraient fait le coup, mille fois éculé, de « ceux qui savent » ou de « ceux qui ont compris », le coup des penseurs « gourouisants » à la petite semaine. Lire Deleuze – et Guattari –, nous rappelle Pierre Ansay, c’est se plonger dans une pensée en action. Une pensée qui, littéralement, se crée, se cherche, devant nous, en se disant, en s’écrivant, n’arrête pas de faire des retours en arrière, ou des projections dans le futur. Lire Deleuze, nous rappelle Pierre Ansay, c’est faire l’expérience d’une pensée vive, toujours en mouvement, ne démontrant rien si ce n’est l’importance qu’il y a à penser. À laisser libre cours à nos intuitions. Nos capacités d’inventions. De fuites ou de résistances aux idées toutes faites. Lire Deleuze, nous rappelle Pierre Ansay, c’est dire un énorme « oui » à la vie, à nos propensions à ne pas nous laisser encadrer. Mettre en boîte. À ne pas prendre pour argent comptant les rôles et les identités qu’on nous assigne. Lire Deleuze, ce serait, en somme, comme apprendre à devenir poreux. À trouver une formidable puissance à nous laisser pénétrer par le monde, par ce qui n’est pas nous. À reconnaître dans ce qui n’est pas nous des frères, des sœurs, des appuis pour nous faire grandir. Augmenter ainsi notre puissance de vie. Persister ainsi dans ce qui est bon pour nous. Pour nos êtres. Fuir ce qui tend à nous réduire. À diminuer notre puissance, notre capacité d’invention.Lire Pierre Ansay, tous les livres de Pierre Ansay, c’est redécouvrir ces philosophes de la vie. Ne plus les juger, a priori, difficiles d’accès. Les rendre, en tout cas, éminemment pratiques. Éminemment urgents de lire et de relire, si l’on veut, de temps à autre, un peu, résister aux sirènes totalitaires, aux embrigadements de toute sorte, ou bien agir, tout simplement, agir, penser autrement l’action dans le monde. Comme l’œuvre de Deleuze, ces 36 outils conceptuels sont à lire dans n’importe quel sens, selon ses envies, ses désirs, ses préoccupations du moment. Pas de hiérarchie entre les concepts. Pas de hiérarchie entre les êtres. Laisser juste l’intuition nous guider : d’abord ceci, puis cela. Ou inversement. Peu importe.Bien sûr, comme l’œuvre de Deleuze, impossible de faire le tour de ces « outils conceptuels » en 4000 ou 5000 signes ! Tout juste peut-on inviter chacun et chacune…