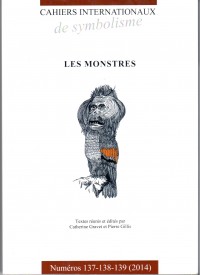
Introduction [page 37 de la version papier] Dans son essai Fiction : l’impossible nécessité, Vincent Engel XX signale que « le discours sur la littérature de la Shoah est dominé par une insistance sur l’incapacité de ce discours et plus particulièrement sa déclination artistique » XX . De fait, le judéocide fut une expérience d’une monstruosité telle qu’elle paraît se situer au-delà de tout ce qui est humainement imaginable, dicible et transmissible. Cependant, ces trois concepts, Engel les qualifie comme des mots qui ne trahissent que notre incapacité à imaginer, dire et transmettre, « des mots qui ne disent rien sur ce qu’on entend qualifier à travers eux » XX . Méditant sur le caractère toujours inédit et unique de l’expression de l’indicible, Engel montre comment le parcours du narrateur imaginé par Jean Mattern dans Les Bains de Kiraly XX (2008) atteste que, s’il est possible de surmonter la détresse en construisant un discours sur un événement apparemment inimaginable, indicible et intransmissible, le dépassement de cet inénarrable passe nécessairement par l’élaboration d’un récit personnel. Dans cette étude, nous nous proposons de nous faire l’écho des témoignages de deux voix majeures des lettres belges actuelles, deux romanciers [page 38 de la version papier] appartenant à des générations différentes mais dont les familles, juives, éprouvèrent dans leur chair et leur âme les atrocités nazies : Vincent Engel (°1963) et Françoise Lalande-Keil (°1941). Vincent Engel: Respecter le silence des survivants – Vous pourriez le laisser en prison, l’envoyer en Allemagne, dans un camp... – Vous ne connaissez pas les camps, monsieur de Vinelles ; sans quoi, je crois que vous me supplieriez de le fusiller sur-le-champ plutôt que de l’y envoyer XX ... Cette réplique de Jurg Engelmeyer, un officier allemand qui a ordonné l’exécution d’un jeune garçon en représailles aux actes commis par son père résistant, ne montre-t-elle pas que la monstruosité du nazisme hante le parcours romanesque de notre auteur pratiquement depuis son début ? Dans son article intitulé « Oubliez le Dieu d’Adam » XX , Engel relate qu’au cours de ses études de philologie romane à l’Université catholique de Louvain, son père lui offrit Paroles d’étranger d’Élie Wiesel, une lecture qui le bouleversa : Par le silence de mon père, par son indifférence à la chose religieuse, je redécouvre le judaïsme. Dans les livres, d’abord, au CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif) ensuite. Et Dieu se voile d’un drap sombre : celui de la souffrance à la puissance infinie d’Auschwitz. Toutes les souffrances se mêlent : celle de ma mère [décédée d’un cancer quelques années plus tôt], celle de la famille de mon père disparue dans les camps. (Idem, p. 72) Pourquoi parler d’Auschwitz ? Cette question, Engel s’astreindra à y répondre dès que cette réalité s’imposera à lui comme une « expérience marquante » bien que non vécue personnellement. La lecture et l’étude approfondie de l’œuvre de Wiesel imprimeront sur sa vision de la Shoah « un vocabulaire et des évidences : un monde était mort à Auschwitz, une société y avait fait faillite, et plus rien ne pouvait être comme avant » XX . D’où la nécessité, poursuit Engel, de « repenser le monde, refonder la morale, instaurer des conditions nouvelles pour la création artistique – pour autant qu’elle fût encore possible XX –, forger des mots neufs pour prononcer l’imprononçable [page 39 de la version papier] [...] » (idem, p. 18-19). D’autres évidences surgiront progressivement dans l’esprit de celui pour qui Auschwitz deviendra vite « une obsession » : celles de constater que la masse des documents publiés « n’ont guère servi à éduquer les gens » (idem, p. 20-21) et que les descendants des survivants, qui ont pour tâche de reprendre le flambeau du témoignage, doivent « trouver d’autres moyens d’expression, car ils n’ont pas vécu l’épreuve » (idem, p. 19). Si ses travaux scientifiques XX lui permirent d’« épuiser » la question « épuisante » de la responsabilité de Dieu devant le génocide juif ou, en tout cas, de tourner une page (ODA, p. 72), par après, c’est principalement à travers la fiction qu’Engel poursuivra cette interrogation sur la Shoah. Une interrogation qui trouve donc sa source directe dans la tragique histoire familiale et dans une identité juive ashkénaze fort ancienne. Comme il le détaille dans quelques interviews et articles XX , ses ancêtres paternels, polonais, étaient des juifs religieux appartenant à la bourgeoisie aisée. Bien que la situation dût se dégrader après la Première Guerre mondiale au cours de laquelle la famille se réfugia à Budapest où son père naquit en 1916, ils sont une famille juive inscrite dans le processus d’assimilation propre à cette période et à leur classe sociale ; les enfants fréquentent des écoles où ils côtoient la bourgeoisie polonaise catholique. Une intégration donc plutôt réussie mais qui n’empêchera pas leur déportation au début des années quarante. De toute la famille paternelle survivront un seul oncle, communiste avant la guerre et rescapé des camps, qui s’en ira faire sa vie à Los Angeles et y deviendra religieux orthodoxe, ainsi que le père de Vincent Engel, parti poursuivre ses études en Belgique vers 1938 et qui, après avoir passé la guerre dans les forces belges de la R.A.F, décidera de s’y installer définitivement : « Plus tard, il me dirait : “N’oublie pas que, pendant la guerre, des Juifs se sont battus”. » (Idem, p. 70.) Quand, à quarante ans, il rencontre son épouse, celle-ci, bien qu’appartenant à une bourgeoisie catholique bruxelloise imbue de solides préjugés, propose de se convertir au judaïsme. Une proposition qui sera rejetée par l’intéressé pour des raisons sur lesquelles l’écrivain ne peut que conjecturer : [page 40 de la version papier] Son athéisme s’était certainement renforcé à l’épreuve de la guerre et des camps. Ou bien, comme d’autres, refusait-il d’inscrire dans une telle tradition de martyre des enfants à venir. Ou bien, plus pragmatiquement, avait-il jugé que les meilleures écoles, à son avis, étaient catholiques. Hypothèse que conforte non seulement le refus de la conversion de sa femme, mais aussi le fait que ses enfants seraient baptisés, inscrits dans des écoles catholiques et feraient leur profession de foi. (Idem, p. 70-71) Une profession de foi qui, chez l’adolescent Engel, ne va pas de soi ! La découverte de l’œuvre de Wiesel et la relecture de Camus lui permettront de régler progressivement le conflit qu’il entretient avec ce christianisme qui prône la soumission, ferme les yeux sur les injustices les plus flagrantes – « Questionner Dieu sur la souffrance, celle d’Auschwitz ou celle de ma mère, accroît l’obscénité de la souffrance, puisque Dieu n’intervient pas et ne répond pas » (idem, p. 74) – et transmet à tous un goût certain pour la culpabilité. Ce qu’Engel (re)découvre dans Camus, la fausseté de la question de Dieu tout comme le devoir pour tout un chacun de suivre un cheminement éthique exigeant, n’est-ce pas en définitive ce que son père lui a transmis ? Évoquant ailleurs la figure paternelle, Engel insiste d’une part sur la certitude de celui-ci « qu’il n’y a pas de droits de l’homme sans le respect de devoirs, et de liberté sans responsabilité » ; d’autre part, sur « [son] impossibilité de dire à ses proches qu’il les aimait ». Et, ajoute-t-il, « pour ce qui est du judaïsme, un silence réduit à l’essentiel. [...] Mais un silence capable de faire passer le judaïsme, le sien, auquel son cadet au moins adhérera pleinement après ses vingt ans » XX . Car ce qui séduit Engel dans le judaïsme, c’est le fait qu’il représente « un rapport à…

Traduction littéraire pour enfants: Emmanuèle Sandron, Maurice Lomré
La traduction littéraire est un champ vaste et trop peu connu. Si nous avons la chance d’avoir accès à la pensée et à la sensibilité de Mark Twain, Léon Tolstoï, Toni Morrison, Gabriel García Márquez, Karen Blixen, Virginia Woolf, Italo Calvino, Elsa Morante…, c’est grâce à une profession qui reste trop souvent dans l’ombre. Il est essentiel que les œuvres voyagent, et il en est de même en littérature jeunesse. La traduction de livres pour enfants et adolescents présente des spécificités propres à son lectorat. Si, à première vue, l’exercice pourrait paraitre plus facile (phrases plus courtes, syntaxe plus simple…), il n’en est rien. L’écriture destinée à la jeunesse ne demande pas moins de précision et de maitrise. Nous avons rencontré une traductrice et un traducteur belges aux parcours très différents. Emmanuèle Sandron est traductrice de formation, autrice et psychanalyste. Elle traduit de l’anglais, du néerlandais, de l’allemand, du letton et de l’italien. Maurice Lomré est bibliothécaire de formation et autodidacte. Il travaille pour la maison d’édition L’école des loisirs dont il assure la diffusion et la promotion en Belgique. Il traduit du néerlandais et de l’anglais. Tous deux ont en commun le goût de la lecture et la passion des langues. * Chemins vers la traduction. Comment devient-on traductrice, traducteur? Parfois on y arrive plus ou moins par hasard, parfois par détermination. «Au départ, je voulais être autrice, explique Emmanuèle Sandron, qui a d’ailleurs écrit et publié plusieurs livres. J’ai souhaité devenir écrivaine à l’âge d’onze ans, et à seize ans je me suis rendu compte que je n’en vivrais pas. Le moyen que j’entrevoyais pour vivre de ma plume était de devenir traductrice littéraire. Les langues sont apparues très tôt dans ma vie et m’ont tout de suite intéressée. J’ai choisi de suivre un master en traduction à l’école d’interprètes internationaux à Mons, et j’ai commencé par un boulot de traductrice commerciale. J’ai ensuite suivi un troisième cycle en traduction littéraire au CETL [Centre Européen de Traduction Littéraire (Bruxelles), ndlr]. Plus tard, j’y ai d’ailleurs enseigné la traduction littéraire, ainsi qu’à l’Université de Liège. Après mes études, j’ai écrit mon premier roman, et puis tout s’est enchainé: la publication de mon livre et mon premier contrat de traduction avec Luce Wilquin, puis avec Albin Michel.» Par la suite, Emmanuèle Sandron a écrit des articles pour la revue de traduction littéraire TransLittérature, avant d’en devenir la rédactrice en chef pendant six ans. «Dans ce cadre-là, j’ai écrit quantité d’articles, de portraits de traducteurs, dont certains qui écrivent aussi. Ma pratique est toujours nourrie d’une réflexion sur la traduction: comment traduit-on? Comment font les autres?» Maurice Lomré, lui, ne se prédestinait pas à la traduction. «Cela a commencé dès la création de Pastel [l’antenne belge de L’école des loisirs, ndlr] en 1988. Christiane Germain, l’éditrice fondatrice de Pastel, a senti que j’avais envie de travailler sur les textes. Elle m’a très vite proposé de relire les textes qu’elle publiait (créations et traductions). Puis elle m’a confié des traductions. D’abord depuis l’anglais, puis depuis le néerlandais.» N’ayant suivi aucun cursus en traduction, Maurice Lomré a beaucoup étudié les langues par lui-même. «Il y a chez moi des centaines de dictionnaires et de grammaires anglais et néerlandais… des plus pointus aux plus ordinaires. Cela me rassure de les avoir autour de moi. Bien entendu, je regrette de n’avoir jamais vécu dans un pays anglophone ou néerlandophone. Ma connaissance est donc plus livresque et littéraire que quotidienne. En revanche, avant de me lancer dans la traduction, j’avais déjà énormément lu de littérature pour la jeunesse ainsi que de littérature pour adultes. Et je lis toujours beaucoup aujourd’hui. J’ai dans la tête une armoire remplie de tiroirs dans lesquels je puise pour trouver la voix, le ton ou le registre de langue qui, à mes yeux, serviront le mieux le texte que j’envisage de traduire.» * Spécificité de la traduction en littérature jeunesse La traduction exige une double maitrise: celle de la langue d’origine et celle de la langue d’arrivée. La maitrise de cette dernière est essentielle. De plus, alors qu’un auteur développe souvent un style qui lui est propre, le traducteur doit s’adapter à celui du livre qu’il traduit. Austérité ou fantaisie, phrases longues ou courtes, alambiquées ou fluides: il s’agit de maitriser tous les registres. Et ce point est particulièrement pertinent en littérature jeunesse lorsqu’on traduit pour des tranches d’âges différentes. L’exercice n’est pas simple. «Au départ, mon rêve était de traduire du roman pour adultes, explique Emmanuèle Sandron. J’ai commencé par des polars chez Luce Wilquin, et Albin Michel m’a confié la traduction des romans policiers de Pieter Aspe. Cela m’a appris le métier. Puis, à la naissance de mes enfants, j’ai découvert la littérature jeunesse. Je racontais des albums chaque soir à mes enfants et j’ai découvert des trésors d’inventivité. Progressivement, j’ai traduit de plus en plus d’albums et de romans pour jeunes lecteurs. Quand j’ai reçu le prix Scam de la traduction pour mon travail en jeunesse, ça a été un moment de bascule: je me suis spécialisée en livres pour enfants et adolescents. Je les trouve beaucoup plus complexes à traduire que les livres destinés à un lectorat adulte. Peut-être que la littérature jeunesse mobilise une autre case du cerveau. Quand je traduis pour les adultes, c’est mon moi d’adulte et de chercheuse qui travaille. Quand je traduis pour les enfants, c’est mon moi poète. Et là, c’est plutôt une question d’inspiration, de fulgurance… C’est aussi un travail extrêmement précis sur la langue, il s’agit d’opérer des choix lexicaux très fins, de trouver le mot juste, de jouer avec les sonorités. Mon moi psy s’allume aussi et surveille ce qui se passe. Il faut faire attention quand on s’adresse aux enfants, on ne peut pas commettre d’impair. Et puis, il y a mon moi enfant: je suis aussi une petite fille quand je traduis.» Cette proximité avec l’enfance caractérise aussi le rapport de Maurice Lomré à la traduction: «J’aime particulièrement traduire pour les enfants de 10-12 ans. Je pense que la raison en est que je me souviens extrêmement bien de moi à cet âge-là. Nous sommes tous habités par les différents âges que nous avons eus, et le garçon de cet âge-là est particulièrement vivant en moi.» * Un penchant pour la traduction de l’album illustré Tous deux font une comparaison similaire. «Je traduis les albums plus joyeusement que les romans, explique Maurice Lomré. Traduire un roman, c’est un peu comme escalader un col à vélo: c’est souvent difficile. J’aime surtout le moment où j’arrive en haut, pour reprendre la métaphore cycliste. Disons que j’aime le résultat. Les albums, je les traduis avec une espèce de joie. Je compare l’album à la chanson en raison de l’articulation de deux langages: la musique et les mots dans le cas de la chanson, les images et les mots dans le cas de l’album. L’un ne va pas sans l’autre. J’aime ce genre littéraire qui se réinvente sans cesse. Le livre le plus amusant que j’ai traduit est un album anglais, Orange Pear Apple Bear, d’Emily Gravett. Il ne comporte que quatre mots et semblait intraduisible, car l’album combine ces quatre mots en jouant sur les sonorités. Je me suis assis à mon bureau et j’ai décidé que je ne le quitterais pas avant d’avoir trouvé une solution satisfaisante en français. Et j’ai trouvé! Hourra! Ce jour-là, je me suis dit que j’étais peut-être devenu traducteur (rires).» «Ce que je préfère, ce sont les albums, confie également Emmanuèle…
