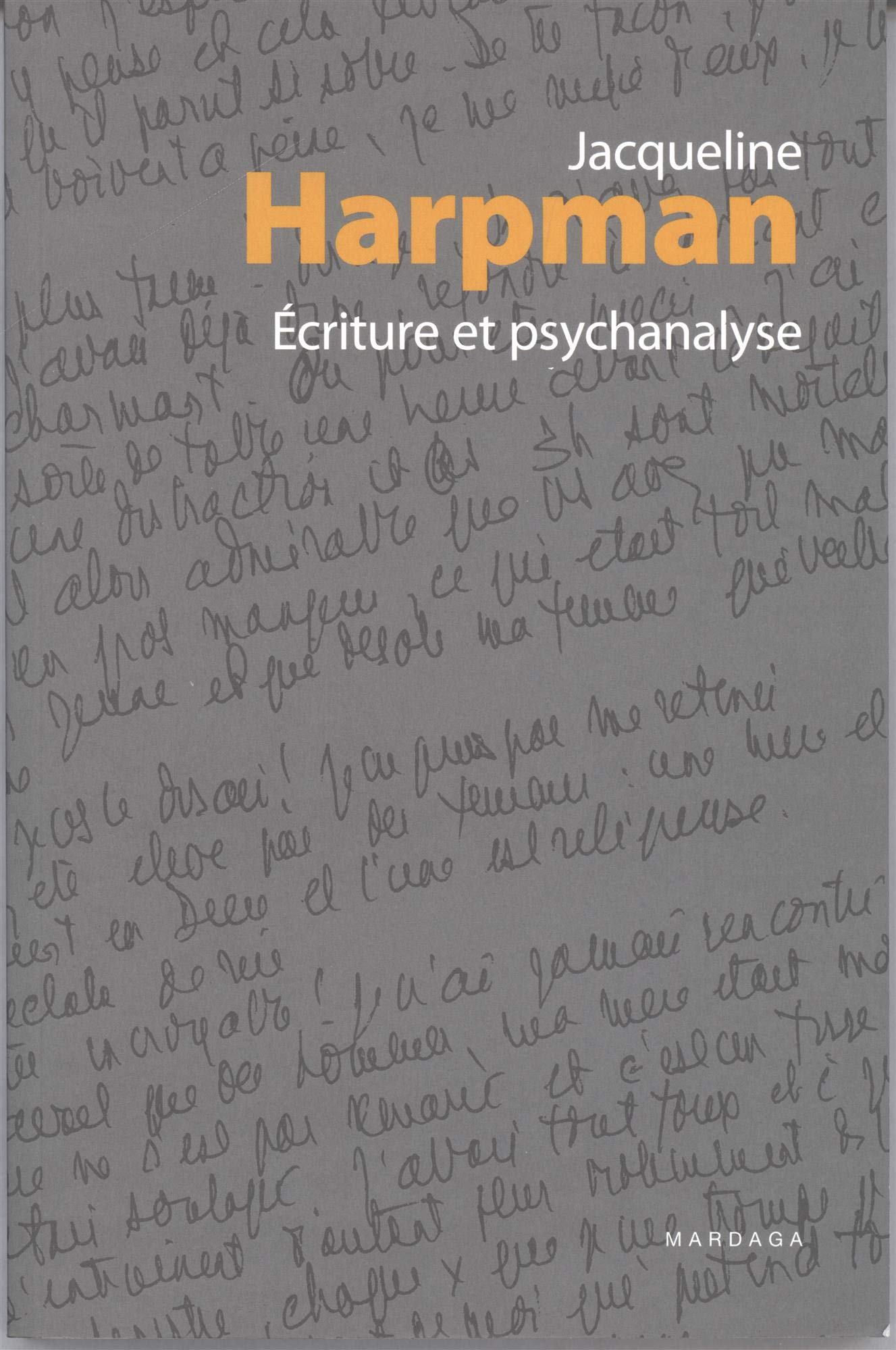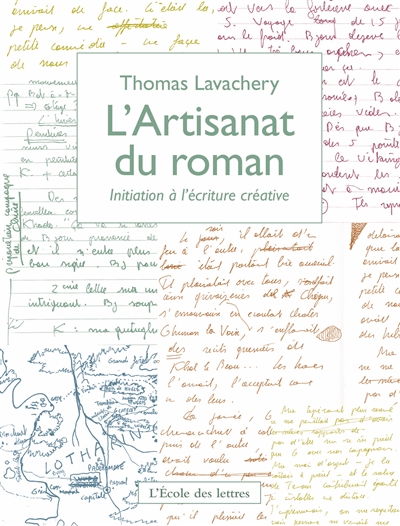
L’artisanat du roman : Initiation à l’écriture créative
Destiné à ceux et celles qui écrivent ou que l’écriture de fiction tenterait, cet essai est nourri de la demande faite un jour à Thomas Lavachery d’animer un séminaire autour des « Pratique de l’écriture pour la jeunesse » dans le cadre d’un master consacré aux métiers du livre jeunesse créé par l’Université Charles de Gaulle, Lille 3 . Auteur jeunesse prolixe et reconnu, notamment pour sa saga Bjorn le Morphir parue à L’école des loisirs où l’essentiel de son œuvre est publié, Thomas Lavachery s’appuie sur son expérience, et il n’hésite pas à l’écrire, sur certaines de ses erreurs pour prodiguer ses conseils aux candidatꞏeꞏs écrivainꞏeꞏs, et on sait qu’ils et elles sont nombreuxꞏes tant la littérature fait (encore) rêver certainꞏeꞏs.S’il s’est appuyé sur son propre travail pour écrire cet essai de creative writing comme on dit du côté anglo-saxon où les formations sont nettement plus répandues qu’en littérature francophone, Thomas Lavachery cite aussi de multiples confrères et consœurs, parfois en comparant leurs pratiques. Citons Tolkien, J.K. Rowling, Simenon, Marguerite Yourcenar, Paul Auster, George Orwell, Elena Ferrante, Stendhal, Proust, Flaubert, Dostoïevski, mais surtout Jules Verne et Alexandre Dumas, le plus cité dans le livre. Notons que Thomas Lavachery rend une autre forme d’hommage à ces aînéꞏeꞏs en les portraiturant lui-même dans cet essai. Il ne manque pas de faire référence à Stephen King pour son livre Écriture, mémoires d’un métier , ou Robert-Louis Stevenson pour ses Essais sur l’art de la fiction , mais également La dramaturgie, les mécanismes du récit , d’Yves Lavandier et Le roman d’aventures de Jean-Yves Tadié. Thomas Lavachery propose d’ailleurs en fin de volume la bibliographie du parfait apprenti écrivain.Sur ces bases pratiques et théoriques, il passe en revue divers éléments de l’écriture créative comme le plan de départ, le synopsis, l’intrigue, le schéma narratif, l’ironie dramatique, la crédibilité, les personnages, les descriptions et les dialogues qui sont d’authentiques créations, le temps romanesque avec ses rythmes et ses ellipses, pour n’en citer que quelques-uns. Précisons que chaque chapitre se termine par des exercices pratiques d’écriture pour ceux et celles qui voudraient passer à l’action sur écran ou sur papier. Là aussi les pratiques varient.Si Thomas Lavachery aborde les genres littéraires comme le roman d’aventure et le roman historique auxquels on le sent attaché, tout comme la littérature jeunesse avec un chapitre consacré aux illustrations et aux interactions avec le texte, il passe sous silence d’autres approches scripturaires comme celles du Nouveau Roman.Écrire est une chose, éditer en est une autre. L’ouvrage se termine sur cette autre réalité en évoquant les liens particuliers qui se nouent entre les auteurs et autrices avec leurs éditeurs ou éditrices, lecteurs et lectrices, correcteurs ou correctrices, voire les sensitivity readers , apparus dans le sillage du politiquement correct et du wokisme pour veiller à ne choquer aucune sensibilité au risque d’édulcorer les textes.Si vous souhaitez deux conseils d’écriture pour terminer, nous avons épinglé ceux-ci cités dans L’artisanat du roman : « Il n’y a qu’un seul art : l’art d’omettre ! », de Stevenson et « La bonne prose est comme une vitre transparente », d’Orwell. Il n’y a plus qu’à… Michel Torrekens Plus d’information Les académies existent pour la peinture, la sculpture, la musique… S’agissant du roman, l’inspiration serait seule à l’oeuvre. Tout viendrait des Muses et rien de la technique. C’est du moins l’idée qui a longtemps prévalu dans les milieux littéraires francophones. Une évolution se dessine cependant, et les cours d’écriture créative, ateliers et autres workshops commencent à fleurir en France et en Belgique. Thomas Lavachery, romancier, chargé d’un cours de pratique de l’écriture pour la jeunesse à l’Université de Lille, livre ici ses idées sur l’art de la fiction. Ses réflexions sur les grands ressorts du roman – l’intrigue, les personnages, les descriptions, les dialogues… – sont illustrées de maints exemples et prolongées par des exercices d’écriture. L’Artisanat du roman propose une initiation personnelle et passionnée à ce métier si beau : romancier. « Écrire n’est pas différent des autres activités humaines, assure l’auteur. La maîtrise technique est source…
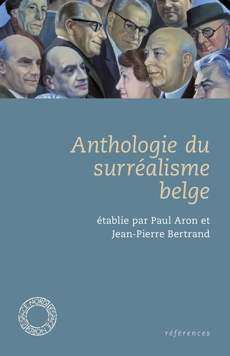
Anthologie du surréalisme belge
« Le mot “surréalisme” ne signifie rien pour moi », déclarait Magritte, alors que son ami Nougé acceptait l’étiquette « pour les commodités de la conversation ».…