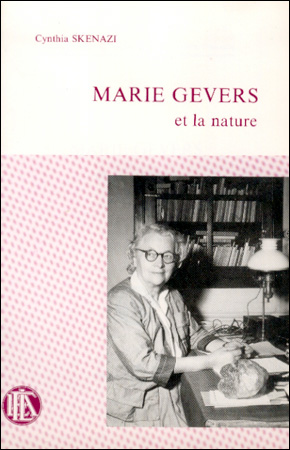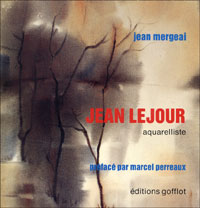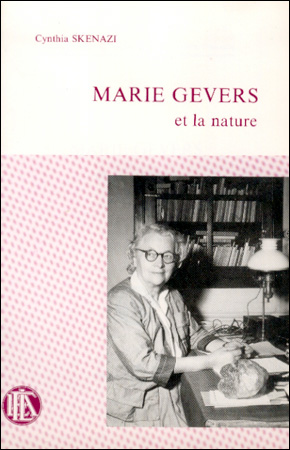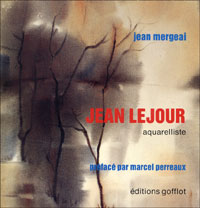Auteur de Thomas Owen : Les pièges du Grand Malicieux
Frédéric Kiesel est né à Arlon le 24 février 1923, au n°4 de l'Avenue Nothomb. Son père, Max Kiesel, Arlonais de souche, était commissaire d'arrondissement, sa mère appartenait à la bourgeoisie gantoise.Après un doctorat en droit à l'Université de Louvain, le jeune homme s'engagea comme volontaire de guerre en 1944-45 dans les bataillons d'Irlande du Nord. La paix revenue, il fit ses débuts littéraires en collaborant au Jeune Faune, plus tard, il devait compter parmi les fondateurs de La Dryade. Dès 1946, il créa un des plus anciens ciné-clubs de Belgique, le Club de l'Écran, et en assura la présidence jusqu'en 1956. Tout en donnant des cours de vulgarisation juridique - notamment aux Aumôniers du travail à Arlon - il fut avocat au barreau de cette ville jusqu'en 1956. Cette même année, il épousa une Athusienne et devint journaliste à La Métropole d'Anvers.Très vite, son goût des voyages l'amena à se spécialiser dans la politique internationale. C'est pourquoi, en 1963, La Cité lui ouvrait les portes du monde (il y resta jusqu'en 1979). Frédéric Kiesel a eu la chance de faire des reportages un peu partout avec, cependant, une prédilection pour le Proche-Orient et les pays de l'Est; c'est ainsi qu'il a parcouru entre autres l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la bande de Gaza, l'Égypte, l'Algérie, l'Irak, la Tunisie, l'Inde, la Thaïlande, le Bangladesh, la Lybie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et l'U.R.S.S. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce grand voyageur devant l'Éternel n'a jamais mis les pieds aux États-Unis.De 1979 à 1988, grand reporter pour le magazine Pourquoi pas?, Frédéric Kiesel fait aussi œuvre de critique littéraire, artistique et musical (sous le pseudonyme de Guillaume Dufays depuis 1978). Depuis 1988, il était journaliste indépendant. Parallèlement à ce métier passionnant, son activité de poète et d'écrivain lui a valu nombre de prix et récompenses: le Borée (1962), le prix des Scriptores catholici (1974), le prix Polak (1954), le prix Georges Garnir de l'Académie Royale de Langue et Littérature Françaises de Belgique (1975), le prix de l'Office allemand du tourisme (1977), le prix Adrien de Prémorel (1987). Notons aussi que pendant de nombreuses années, il entretenait des relations amicales avec le mouvement catholique polonais Pax. Il était membre et administrateur de l'Académie luxembourgeoise (depuis 1963). Enfin, on peut ajouter qu'il était père de deux filles qui ont également embrassé la carrière de journaliste et que, vivant à Bruxelles, il passait cependant une partie de son temps à Rachecourt, en Gaume, et sur la côte bretonne.Il est décédé en février 2007.