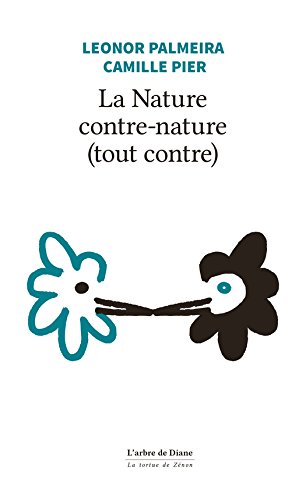
La Nature contre-nature (tout contre)
Les humains prétendent que certains individus, certains comportements et certaines pratiques sexuelles seraient « contre- nature » Et si nous allions voir dans la nature ce qui se passe de si « contre-naturel » ? Josie, éminente scientifique experto-spécialiste en sexualité animale nous invite à rencontrer et visiter l’intimité naturelle. Dans cette conférence scientificomique, Josie nous raconte les ébats en tous genres et les genres dans tous leurs états chez nos amis les animaux. La Nature contre-nature (tout contre) est un projet multi-facette de vulgarisation scientifique et d’éducation populaire autour des thématiques LGBTQI dans la nature qui nous entoure. La conférence-spectacle en est un des volets. Il s’en passe des choses dans la nature. Des choses que l’on n’imagine pas, que l’on ne veut pas voir, ou que l’on nous cache parce qu’elles rendraient chèvre l’ordre établi. Celui, par exemple, de la différence entre les hommes et les femmes, cette fameuse différenciation sexuelle qui serait le dernier rempart contre la confusion identitaire, l’ultime argument pour défendre la famille traditionnelle. Que n’a-t-il pas fallu entendre, en France, au moment des débats pour le mariage pour tous – et toutes ! Quelles couleuvres n’a-t-il pas fallu avaler ! Même si, au fond, on peut être d’accord avec Juliette Gréco quand elle chante « La nature complique jamais inutilement / Y’a que les hommes pour s’épouser ». Mais la nature est plus égalitaire que la société humaine ; dans le règne animal c’est : le non -mariage pour toutes et tous.Les humains prétendent que certains individus, certains comportements et certaines pratiques sexuelles seraient « contre nature »… Et si nous allions voir dans la nature ce qui se passe de si « contre-naturel » ? Josie, éminente scientifique experto-spécialiste en sexualité animale, nous invite à rencontrer et visiter l’intimité naturelle. Dans cette conférence scientificomique, elle nous raconte les ébats en tous genres et les genres dans tous leurs états chez nos amis les animaux. La Nature contre-nature (tout contre) est un projet multi-facettes de vulgarisation scientifique et d’éducation populaire autour des thématiques…
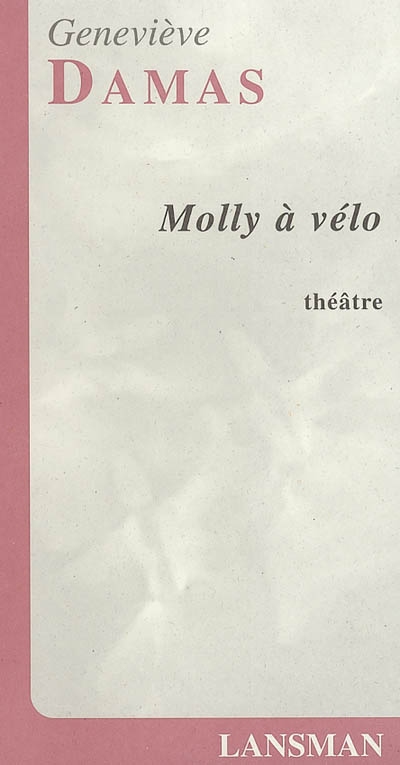
Molly est une fille qui découvre par hasard qu'elle sait faire du vélo, et plutôt bien. Dans…
