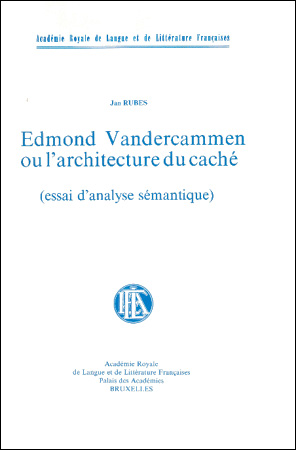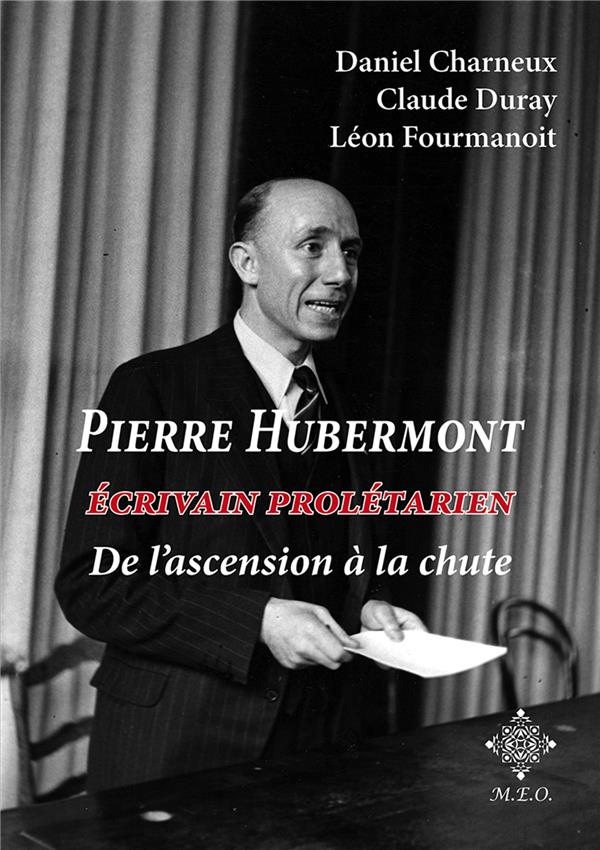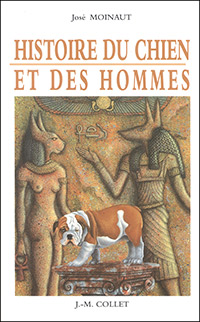Extrait du Chapitre 2 : Le livret de pèlerinage à Saint-Hubert, la rage et la raison
Le pèlerinage à l'abbaye de Saint-Hubert en Ardenne, l'opération de la taille, par laquelle on insérait au front du visiteur un morceau de l'étole-relique du saint, et la «neuvaine» qui suivait étaient autrefois censés préserver de la rage. Il s'agissait d'écarter un «mal physique», rage ou folie, qui «n'est que le reflet d'un mal moral plus profond» incombant à Satan. Dans son
Histoire du monastère, le moine Hancart expose les
Miracles opérés par les mérites de saint Hubert sous la prélature de l'abbé Jean de Masbourg. L'intervention du patron des Ardennes y est réclamée tantôt pour une Tournaisienne possédée des démons Ariel et Alep, tantôt pour un prévôt qui vient d'être mordu. Celui-ci s'était rendu coupable d'un grave péché qu'il dissimulait, le diable lui ayant «fermé la bouche». On l'amena, écumant, au monastère de Troisfontaines, où il mourut. Mais on reconnut un miracle en ceci qu'il contint « les mouvements furieux de la rage sous les rênes de la raison, afin de n'envelopper en son malheur ceux qui l'environnaient ». Une gravure de Jean Valdor l'aîné illustre également ce qui unit l'exorcisme et la taille à la grande époque de la chasse au diable (fin XVIe - début XVIIe siècle).
Dès le XVe siècle, le chancelier Gerson avait ouvert l'offensive contre une pratique jugée indignement superstitieuse. Trop d'aspects de la neuvaine qui accompagne nécessairement l'incision avaient un air de mystère ou de pratique occulte. La personne incisée se voyait interdire de «peigner ses cheveux pendant quarante jours». Elle ne pouvait «baisser sa tête pour boire aux fontaines et rivières». Elle devait «coucher seule en draps blancs et nets, ou bien toute vêtue». Il était prescrit de manger froides des viandes provenant d'animaux «d'un an ou plus». Le bandeau qui avait fermé la plaie devait être brûlé, et les cendres étaient mises dans la piscine de l'abbaye.
Ces «cérémonies» provoquèrent un feu continu de protestations ou d'explications qui réduisaient l'action de la neuvaine à un phénomène naturel. Ainsi, Van Helmont et son magnétisme animal rendirent un compte impie des guérisons miraculeuses. La Sorbonne condamna le pèlerinage en 1671, relayée en 1701 par le chanoine Gilot, dont la virulence fut telle, à l'égard de la neuvaine, qu'il donna son nom à la faction des « Gilotins ». Contre ces attaques, les autorités religieuses liégeoises et les abbés de Saint-Hubert, appuyés par la Faculté de Médecine de Louvain, firent bloc. En 1690, le prince-évêque Jean-Louis d'Elderen donne un acte justifiant pleinement la neuvaine. L'approbation eut une belle carrière. Reproduite dans tous les livrets dont il va être question, elle figure encore au XIXe siècle sur le certificat remis au pèlerin pour attester l'incision.
Inutile de dire que le scepticisme du XVIIIe siècle radicalisa les hostilités. Après le baron de Pöllnitz, le Français Jolivet, ne voulant pas être en reste d'une indignation et considérant par ailleurs le pays liégeois comme peuplé d'arriérés, a décrit une coutume qu'il range parmi «les plus fanatiques et les plus révoltantes». Les superlatifs sont accumulés sur un «spectacle pieusement horrible», au cours duquel le trésorier de l'abbaye, «après des prières et des exorcismes, ouvre, d'un coup de rasoir, le front des victimes et leur incruste le diabolique chiffon». On imagine le cortège que forment celles-ci : «L'œil abattu, le teint livide, le corps couvert de poussière et incrusté de houille, chantant dévotieusement, le bandeau encore sur le front et tenant la compresse sur la plaie.»
Dans quelle mesure les commentaires de la neuvaine procurés, sous l'ancien régime, par une littérature pieuse de large diffusion reflètent-ils quelque chose du climat critique ainsi schématisé? On a considéré deux séries d'ouvrages vulgarisant le culte de saint Hubert. La première se présente sous le titre :
Abrégé de la vie de S. Hubert, prince du sang de France, duc d'Aquitaine, etc. D'après l'avertissement, le texte remonterait à un original daté de 1645, ainsi qu'en fait foi une permission d'imprimer signée de Jean de Chokier. Celui-ci fut un des plus vigilants défenseurs de l'orthodoxie et d'un pouvoir ecclésiastique rigides, car sa combativité lui valut d'être cité par Pascal dans la cinquième
Provinciale. L'ouvrage connut de nombreuses éditions liégeoises : 1725, 1733, 1737, 1744. Cette édition originale, dont aucun exemplaire ne paraît localisé, fut réalisée à l'occasion de l'établissement de la confrérie de Saint-Hubert à Liège. Elle contenait «les indulgences, prières et règles de ladite confrérie», avec un abrégé de la vie du saint. Après la permission d'imprimer viennent, dans les éditions du XVIIIe siècle, le formulaire de la neuvaine et une
Explication des conditions requises pour l'accomplir de façon correcte.
Une seconde tradition textuelle est constituée de livrets générale-ment intitulés
Abrégé de la vie et miracles de S. Hubert, patron des Ardennes, par un religieux de l'abbaye dudit S. Hubert. Elle remonterait à une édition de 1697 dont la permission d'imprimer date de l'année précédente. Elle se présente sous deux formes. En réponse aux «inquiétudes» qu'ont suscitées certaines «observances» de la taille, un premier type d'ouvrage propose une
Manière de faire la neuvaine, avec l'
Explication ou réflexion sur chaque article. C'est le texte sur lequel va porter principalement l'examen. Un second type d'ouvrage n'offre pas ces éclaircissements.
En effet, rapporte la tradition textuelle que l'on appellera l'
Abrégé-Ardennes, «des incrédules (…) ne font pas difficulté de blâmer ladite neuvaine de superstition tout ouverte, mesurant toutes choses à la portée de leurs esprits et censurant trop librement ce qui les surpasse». Ces «rêveries» vont «inquiétant beaucoup de personnes». On serait tenté de mettre ce témoignage en rapport avec le «nombre élevé des blasphémateurs poursuivis à Saint-Hubert» (Dupont-Bouchat). Qui sont ces violents qui battent ou insultent leur curé, comme Jean d' Awenne, de Hatrival, ou Adam Lhoste, de Freux? Qui sont ces Jean Maistre, d'Arville, ou Jean l'Écossais, qui renient Dieu «de bon cœur » et «au grand scandale du peuple»? On aimerait en savoir plus. L'
Abrégé-Ardennes dut en tout cas propager largement l'idée d'une mise en cause du pèlerinage, car il fut réimprimé à Rouen par le libraire irrégulier Besongne (1704), à Luxembourg par Ferry (1734) et Kléber (1785), à Namur par Flahuteaux (1802), Legros (1827), etc. Le jugement de l'ancien évêque, celui des théologiens et médecins de Louvain, la déclaration des examinateurs synodaux, l'approbation donnée en 1696 par le curé de S Saint-Adalbert, et jusqu'à l'orthographe traditionnelle des imparfaits en
-oit, tout cela traverse allègrement le XVIIIe siècle! L'édition Flahuteaux, imperturbable, continue d'écrire «par mégard» au lieu de «mégarde», comme sous Louis XIV.
Table des matières
Avant-propos
1. L'étrenne des Lumières dans l'
Almanach de Mathieu Laensbergh
1.1. Les crises inaugurales : jansénisme et éducation (1734-35)
1.2. Lexique du désordre
1.3. Apparition de l'homme
éclairé (1741)
1.4.
Inhumanité et bataille des
lettres (1745-49)
1.5. Le paradigme du «commerce»
1 6. «Comment arrêter le torrent?»
2. Le livret de pèlerinage à Saint-Hubert, la rage et la raison
2.1. Le système tautologique
2.2. L'avènement du contrat marchand
3. Autour du Journal encyclopédique : «perfectionner l'espèce humaine»
3.1. Le débat sur l'inoculation
3.2. Alimentation et culture du corps : Brouzet et Rousseau
3.3. Races et classes : Vandermonde contre Voltaire
4. L'abbé Raynal : la propagande involontaire
4.1.
L'Analyse de François Bernard
4.2. Du
Réquisitoire de Séguier au
Dialogue entre Cadet et le paysan
4.3. La
Censure de la Faculté de Théologie et la chanson wallonne
4.4. La Révolution américaine dans la
Gazette de Liège
4.5. La Révolution américaine dans le
Journal historique et littéraire
4.6. Dialogue de la violence
5. Le langage des procès
5.1. De Looz-Corswarem : un récit voltairien du déclin nobililiaire
5.2. De Villenfagne, de Greiffenclau et les «beaux droits» de la noblesse
5.3. Leratz de Lanthenée, de Heusy : deux plaideurs-philosophes
5.4. Florennes :
Plaintes d'un peuple désolé et opprimé (1773)
5.5. Les Lumières entre humanitarisme et industrialisation (1771-72)
5.6. Institutions sensibles : l'
hôpital général, l'
Émulation, Léonard et Grétry
5.7. Noblesse éclairée, bourgeoisie tendre, clergé égalitaire?
6.La chanson pré-révolutionnaire en dialecte verviétois (1787-88)
6.1.
Capons,
pouilleux et
vauriens
6.2. L'orgueil des parvenus
6.3.
L' mèzâre s'implit : «La mesure est comble»
7. Bassenge dans la chanson révolutionnaire
7.1. «L'élève du grand Raynal»
7.2. Mesures de la popularité
7.3. Le temps des militaires
7.4. Place aux «citoyens paisibles»
7.5. La «Bassengerie» à la bibliothèque!
8. Wallon et français à la Révolution
8.1. La politique générale des langues en Belgique à la Révolution
8.2. La répression du dialecte : mythe ou réalité?
8.3. Une idéologie du wallon?
8.4. Wallons et Flamands : sympathie française et «haine nationale»
9. Continuités et ruptures de la lecture romantique
9.1. La reconquête catholique
9.2. Le palmarès de la lecture : Lamartine, Scott, Cooper
9.3. Un aspect de la continuité : «une littérature dégoûtante»
9.4. Pour une autre littérature populaire
9.5. Le cabinet de lecture Castiaux-Massait : vers la culture de 1848?
10. La
Gazette de Liège, le théâtre, les femmes et la Révolution de 1848
10.1. La contamination révolutionnaire : une apparente apathie liégeoise
10.2.
Un bas-bleu de Villeneuve et Langlé
10.3. Retour sur la condition ménagère
10.4. Le
Code des femmes de Dumanoir et la question du divorce
10.5. Les clubs de femmes
10.6. George Sand, les femmes et la politique
11. La chanson wallonne de conscrit au XIXe siècle
11.1. Les rites de l'adieu
11.2. Complaintes de la fille-mère
11.3. L'invention de la patrie
11.4. Discipline et antimilitarisme : typographie, illustration, mise en page
Bibliographie
Index