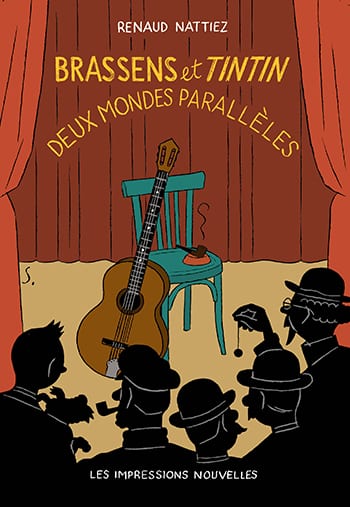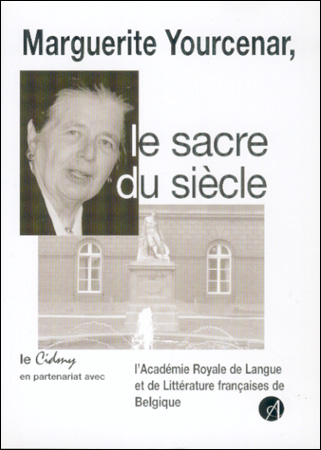
Marguerite Yourcenar, le sacre du siècle
Introduction de Jacques De Decker À propos du livre (texte de l'Introduction) Deux mille trois : Yourcenar atteignait le siècle. Elle aurait été, comme…
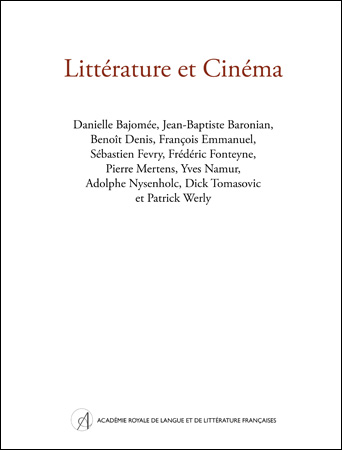
De Rimbaud à Duras, de Simenon à Bourdouxhe, de Steeman à Aymé, rares sont les écrivains qui n’ont…