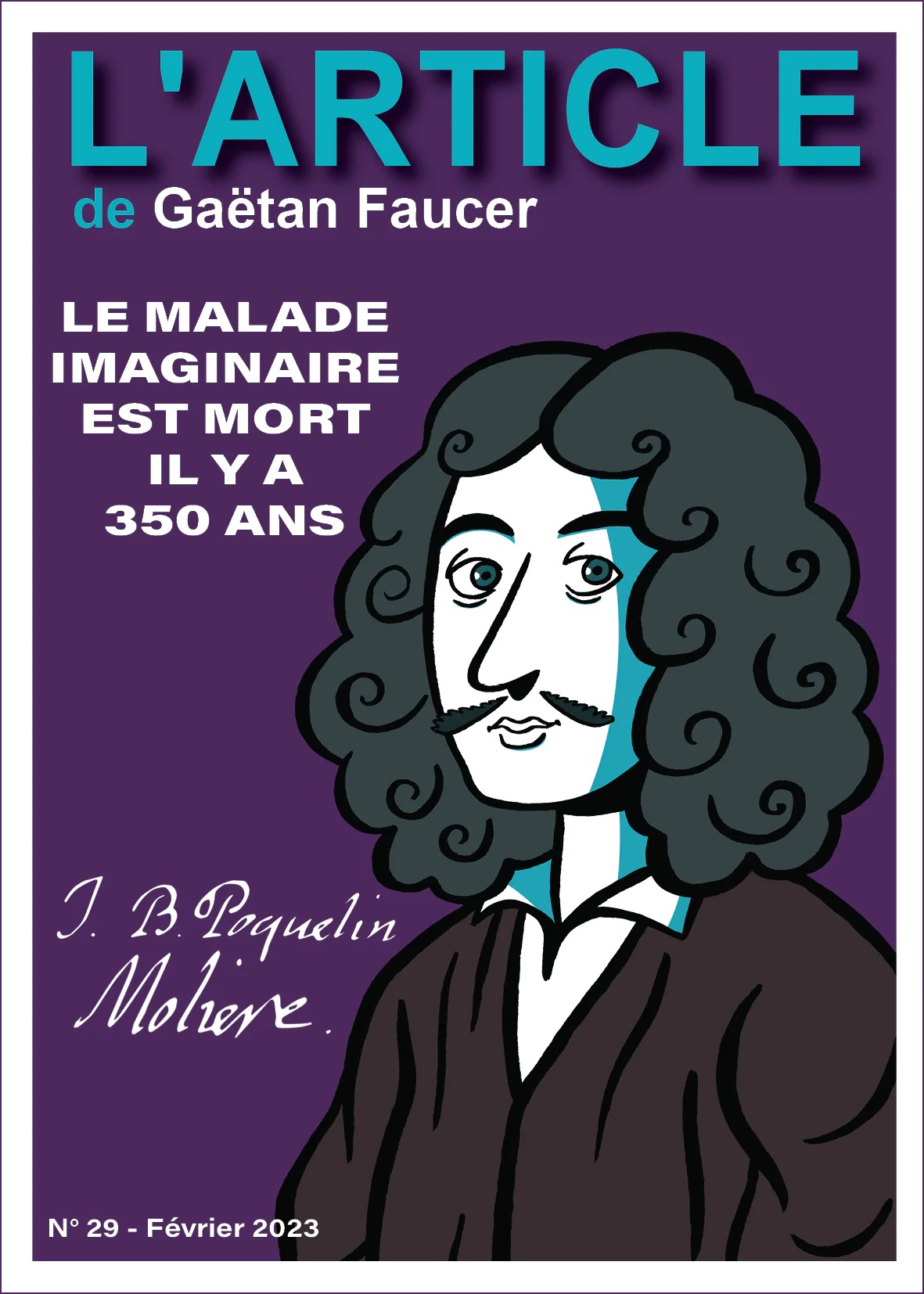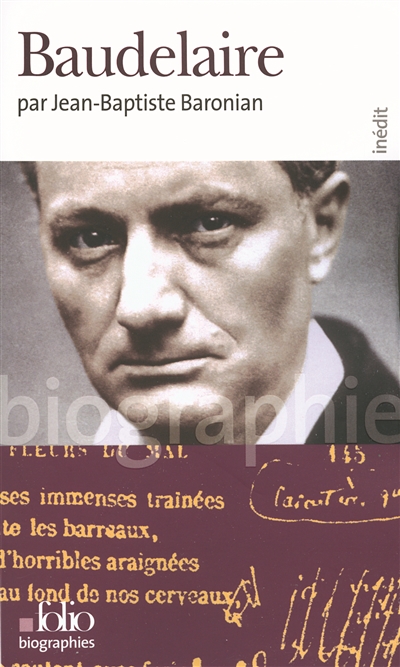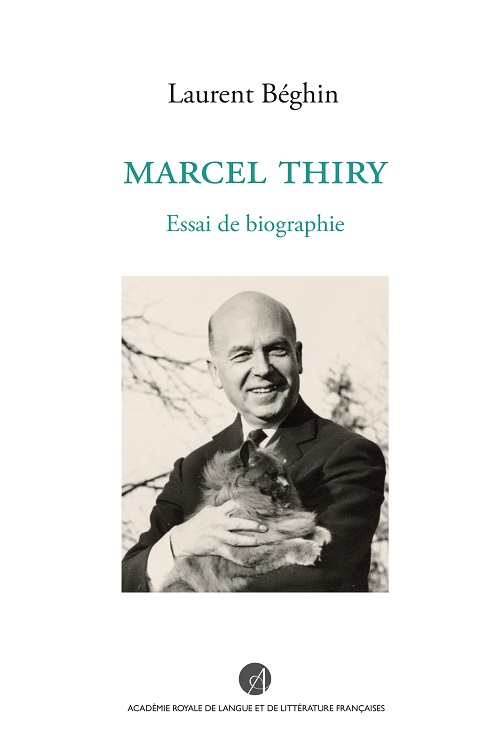Auteur de Gallus : lettres wallonnes et culture
Maurice Piron naît à Liège le 23 mars 1914. Au terme de ses études de philologie romane, il défend une thèse sur L'œuvre poétique et dramatique d'Henri Simon, qui le consacre d'emblée comme principal connaisseur de la littérature wallonne. Commence alors une carrière de chercheur, que Piron complètera vite par une vie d'enseignant : chargé de cours puis professeur à l'Université de Gand, on le retrouve à l'Université du Congo. En 1963, Piron rejoint enfin sa ville natale. Il y meurt le 24 février 1986. Il était membre de l'Académie de langue et de littérature françaises depuis le 12 mars 1960.
Piron laisse une œuvre protéiforme, à l'image de sa personnalité optimiste et gourmande : travaux sur l'épopée des quatre fils Aymon, recherches étymologiques, notices sur les poètes wallons de l'Ancien Régime, intérêt pour les français régionaux ou marginaux, études sur les poètes français du XIXe siècle, synthèses sur les littératures francophones, mais aussi essais politico-culturels ou réflexions sur l'enseignement de la langue maternelle.
Il n'est pas malaisé de trouver le fil qui tisse l'unité de ce vaste ensemble de plus de trois cents titres. Toute l'œuvre imposante de Piron vibre d'une fidélité à son pays, la Wallonie. Ce pays, le philologue amoureux des mots l'aborde d'abord par ce qu'il a de plus intime : son dialecte. À l'heure où la littérature wallonne semblait devoir rester aux mains des rimailleurs du dimanche, Piron se lance dans ce qui peut apparaître comme une croisade. D'un côté, il offre à un vaste public plusieurs ouvrages qui lui permettent d'entrer dans une des littératures dialectales parmi les plus vivantes d'Europe : un impertinent essai sur les Lettres wallonnes contemporaines, où pour la première fois la littérature locale est jugée à l'aune de la création internationale (1944), est suivi d'une anthologie bilingue de Poètes wallons d'aujourd'hui (1961), que Raymond Queneau accueille chez Gallimard. De l'autre, le chercheur dresse un Inventaire de la littérature wallonne des origines (vers 1600) à la fin du XVIIIe siècle (1962), et mène une série de recherches pointues sur les poètes wallons de l'Ancien Régime, dont il édite certains textes. Ces deux voies convergent vers une œuvre longtemps méditée : une monumentale Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie (1979).
Homme de racines, Piron sait ne jamais s'enfermer, comme le montrent les articles recueillis dans ses Aspects et profils de la culture romane en Belgique (1978) : nul n'est plus grand contempteur que lui de la médiocrité régionaliste. Non seulement il aura toujours à cœur de montrer que toute culture est brassage (on songe par exemple à sa thèse sur l'origine italienne des marionnettes liégeoises), mais il saura toujours accéder à l'universel à partir de ses sujets de prédilection. Ad augusta per angusta : nombre de travaux partant d'un fait régional, d'un intérêt en apparence limité, aboutissent chez lui à des conclusions qui transcendent ce cadre. On peut ainsi penser à son grand article sur le mot ramponô, si riche en observations sur le dynamisme étymologique en général qu'un anthropologue ne rougirait pas de le signer. Anthropologique encore est le regard qu'il jette sur l'art populaire de la marionnette dans Tchantchès et son évolution dans la tradition liégeoise (1950). Piron est aussi le premier à fournir un modèle explicatif — qu'il expose pour le public international dans l'Encyclopédie de la Pléiade — des synchronismes entre les littératures dialectales d'oïl, et à montrer que leur essor est un contrecoup de celui du français. Cette méthode consistant à débusquer des structures institutionnelles et des constantes historiques, il l'appliquera plus tard à l'ensemble des littératures de langue française vivant hors de France, sur lesquelles il sera le premier à jeter un regard sociologique. Anthropologie, sociologie : Piron est bien un théoricien, dont l'œuvre est encore riche en suggestions méthodologiques. Mais sans doute sa causticité, son ironie, et un sens tout fraternel de la mesure lui ont-ils imposé de professer un certain scepticisme pour les théories, douteuses à force de tout expliquer.
Pourtant, le pyrrhonisme s'accompagne chez Piron d'un robuste penchant à l'adhésion. Ceci fait de lui un maître aimé de nombreux disciples qu'il a de par la francophonie internationale, mais aussi un homme d'action et de projets. Voire un homme de combat : avec Rénovation wallonne, l'intellectuel sait s'engager dans les voies progressistes qui s'ouvrent après la deuxième guerre mondiale, ou dans les débats qui mèneront à la fédéralisation de la Belgique. Et Piron est aussi, sans qu'on le sache trop, un des principaux artisans de l'avènement de la francophonie. Sans doute est-ce à cette passion, alimentée par les nombreux contacts qu'il sut entretenir de par le monde, que l'on doit la création à l'Université de Liège d'un Centre d'études québécoises, qui a fait de sa ville natale la capitale européenne du Québec.
Passionné, Maurice Piron sut toujours rester attentif et rigoureux, mariage de qualités se traduisant souvent par la causticité. C'est ce mariage que le professeur de lettres a mis au service de la connaissance d'auteurs comme Nerval, Molière, Verhaeren ou Apollinaire. Ici encore, nous retrouvons l'alternance du local et de l'universel : parti de recherches sur Apollinaire en Ardennes (1975), Piron débouche sur une sagace lecture, portée de longues années durant, de la Chanson du mal aimé (1987). Parmi les auteurs de prédilection du philologue, on détachera Simenon. Figure emblématique que celle-ci : comme Piron, fondateur d'un Centre d'études Georges Simenon où l'on vient travailler du monde entier, ce Liégeois illustre sut être d'un lieu sans cesser d'être de partout. Si la dialectique de l'enracinement et du cosmopolitisme chez Simenon a fasciné Piron, cette dialectique débouche bien sur une synthèse, comme le montre son Univers de Simenon, qui constitue un guide sûr de toute l'œuvre.