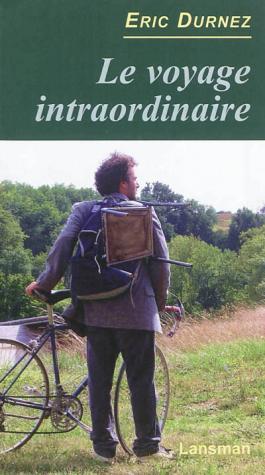Entretien avec Eduardo Halfón (3) – Genèses d’une œuvre
En mars 2015, Maxime Hanchir a rencontré à plusieurs reprises l’auteur guatémaltèque Eduardo Halfón (prix Roger Caillois 2015) dans le cadre du festival de littérature Passa Porta. Au cours de ces entretiens, l’auteur a accepté d’expliciter certains aspects de son parcours et de son œuvre.
En mars 2015, Maxime Hanchir a rencontré à plusieurs reprises l’auteur guatémaltèque Eduardo Halfón (prix Roger Caillois 2015) dans le cadre du festival de littérature Passa Porta. Au cours de ces entretiens, l’auteur a accepté d’expliciter certains aspects de son parcours et de son œuvre.

Parlons maintenant plus spécifiquement de tes livres. Le Boxeur polonais et Signor Hoffman viennent de sortir presque simultanément en France aux éditions de La Table ronde. Ces livres ne sont pas sortis dans le même ordre en France qu’en Espagne : c’est à dire que le Boxeur polonais est sorti en 2008 chez Pre-Textos, tandis qu’en France, on te connaît surtout par la Pirouette (2013) et Monastère (2014).
Oui, il s’agit d’une décision éditoriale de La Table ronde. Ils voulaient commencer avec deux petits romans : la Pirouette et Monastère. Et ensuite retrouver le livre d’où tout est parti. Car le Boxeur polonais est en fait la matrice à partir de laquelle tous mes livres sont nés. C’est la base. Je parle ici de l’édition de Pre-Textos. L’édition de Pre-Textos de 2008 est un livre qui contient six nouvelles. La version française n’en contient que deux, parce que les autres nouvelles ont déjà été publiées ailleurs en France. Une des nouvelles du Boxeur polonais (dans la version espagnole de 2008) s’appelait Epístrofe (« Épistrophe »). En 2010, j’ai continué cette nouvelle pour en faire un chapitre du roman la Pirouette. La même chose s’est passé avec la nouvelle intitulée Fumata blanca (« Fumée blanche ») qui est ensuite devenue un chapitre de Monastère. C’est-à-dire que j’ai écrit de petites nouvelles pour le Boxeur polonais, qui par la suite ont grandi pour devenir d’autres choses. Mais ce n’était pas planifié. Et l’histoire qui traverse tout, y compris Signor Hoffman, c’est l’histoire du Boxeur polonais. C’est l’histoire de mon grand-père, c’est la Pologne, le cœur, ou comme un journaliste l’a dit, « Rosebud1 ». La petite histoire d’où tous les livres, toute l’œuvre part. La clé de tout.
En parlant de cette discussion que tu as eue un jour avec ton grand-père [concernant son internement dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau] et qui est devenue par la suite le sujet de la nouvelle le Boxeur polonais : est-ce à partir de ce moment-là que tu t’es mis à écrire ?
Non, cette discussion avec mon grand-père, nous l’avons eue en 1999 ou en 2000. Je n’écrivais pas encore. J’ai commencé à publier en 2003 [Esto no es una pipa, Saturno, Alfaguara] et en 2004 [El ángel literario, Anagrama], et cette histoire du Boxeur polonais, je ne l’ai ressortie qu’en 2008. Mais c’est important de le souligner : l’histoire de mon grand-père est dans tous les livres que je suis en train de créer. Je la mentionne toujours d’une façon ou d’une autre, je la garde ! La version espagnole du Boxeur polonais, je l’ai écrite comme ça. Les cinq premières nouvelles dévoilent au lecteur un peu de l’histoire de mon grand-père. Puis, en dernier lieu, vient la nouvelle qui révèle l’entièreté de l’histoire du Boxeur polonais. Et je l’ai écrite comme ça parce que je n’avais pas l’envie, je n’avais pas le courage d’écrire l’histoire de mon grand-père. Quand j’ai donné la première version du Boxeur polonais à Pre-Textos, je n’avais pas encore écrit la nouvelle éponyme. Et l’éditeur me l’a renvoyée et m’a dit : « Rentre chez toi, assieds-toi et écris l’histoire de ton grand-père. » Et je l’ai écrite.
L’éditeur avait senti que tu avais contourné le problème...
Oui, c’est ce que j’avais fait. J’avais tourné autour de cette histoire, sans oser entrer dedans. Je n’avais pas eu le courage de rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi. Était-ce le thème? Une question de respect pour mon grand-père ? Beaucoup de raisons.
D’une certaine manière, tous tes romans traitent du passé. De ta famille bien sûr, mais aussi du passé. Est-ce que tu imagines écrire un jour un roman ancré dans le quotidien ou l’actualité ?
Je crois que tous mes romans parlent de l’actualité, mais sans quitter le passé. Je parle par exemple de l’Israël d’aujourd’hui, mais en le voyant du passé. Tous mes livres sont réellement ancrés dans le présent. Sans occulter le passé. C’est une manière d’écrire. La seule manière que j’aie de comprendre le présent, c’est de retourner dans le passé. De regarder dans le passé. Enfin, plus ou moins. Dans Monastère, par exemple, l’histoire se déroule en Israël. Pour comprendre ce qu’il voit, le narrateur fait des voyages continuels dans son enfance, les histoires de ses grands-parents. Pour moi, quand je veux parler de quelque chose de très profond, de très présent aujourd’hui, il faut que je regarde dans le passé. Je ne sais pas ce que je vais écrire plus tard, mais pour l’instant, c’est la seule manière que je connais d’écrire. C’est un mélange d’aujourd’hui et d’hier.

Ce mélange d’aujourd’hui et d’hier on le retrouve aussi dans les nouvelles de Signor Hoffman. Dans les nouvelles Bambou ou Les oiseaux sont revenus, tu confrontes vraiment le Guatemala d’aujourd’hui avec son passé. Était-ce volontaire ?
Il y a une troisième nouvelle qui vient ensuite, qui s’appelle Sable blanc, pierre noire. Ce sont trois petites nouvelles qui se passent au Guatemala. C’est un petit voyage guatémaltèque. Le livre Signor Hoffman commence avec un voyage italien, qui est suivi d’un voyage guatémaltèque, puis d’un voyage polonais. Trois voyages. Le deuxième, le voyage au Guatemala, est une confrontation avec la réalité sociale guatémaltèque. Cela commence avec Bambou, avec une image très forte : celle du bambou comme métaphore de la prison.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement une métaphore : c’est une réalité très concrète dans cette nouvelle.
Oui, mais ça fonctionne comme une métaphore de la réalité sociale guatémaltèque. Du pauvre emprisonné dans quelque chose. La nouvelle suivante, Les oiseaux sont revenus, se passe dans une coopérative de café. C’est quelque chose de plus profond...
Oui, je l’ai trouvée incroyable, parce qu’en quelques dizaines de pages, tu parviens à évoquer l’histoire du Guatemala des trente dernières années, mais aussi la réalité sociale actuelle, les syndicats, etc.
Oui, et la guerre civile, les effets de cette guerre civile sur les communautés indigènes pauvres. Pour moi, ce voyage était important. Je devais me confronter à cette facette de mon pays. C’était aussi une partie de mon pays que je ne connaissais pas. Peu de Guatémaltèques la connaissent. C’est difficile d’y parvenir, même littéralement, physiquement !
Parce que ce sont des régions montagneuses.
Exactement, des régions difficiles d’accès. Et il fallait aussi que le caféiculteur m’accepte, me montre les caféiers et la coopérative, les bureaux... C’était quelque chose de très fort.
Et en même temps c’est un élément central, car le café représente une part très importante de l’économie guatémaltèque.
La plus importante. Mais la vérité, ce n’est pas ça : quand tu bois une tasse de café guatémaltèque ici, tu ne penses pas aux indigènes pauvres qui reçoivent si peu d’argent pour autant de travail. C’est toute la problématique de la soumission et de l’assujettissement des travailleurs par le pouvoir guatémaltèque.
Mais tu n’y parles pas seulement de jeux de pouvoir, n’est-ce pas ? Il me semble cette nouvelle a peu à voir avec une démonstration politique. Tu y racontes plutôt une histoire humaine.
La politique et l’histoire ne sont là qu’en toile de fond, c’est vrai. Pour moi, la clé de cette nouvelle est le personnage du père.
Ce père dont le fils a été tué, sans qu’on sache pourquoi.
Oui, c’est un mystère. Comme tout au Guatemala. Mais en fait, tout le monde sait qui a tué qui, même si personne ne le dit. Et personne ne fait rien. L’impunité est totale. Le silence est total. C’est comme l’image à la fin de cette nouvelle. L’image du père qui « entre » dans son caféier : il se fond dans l’arbre. Ça en dit long...
Pour revenir à la « genèse » de ton œuvre : ton premier livre s’appelait Esto no es una pipa (« Ceci n’est pas une pipe »). Il s’agit donc une référence à l’œuvre de René Magritte, qui est d’ailleurs un personnage du livre. Y a-t-il un lien avec la Belgique ou apprécies-tu seulement la peinture de Magritte ?
Magritte est un personnage du livre. C’est un petit roman, très petit. C’est un livre composé de deux petits romans. Le premier s’appelle donc Esto no es una pipa et le deuxième Saturno (« Saturne »). La deuxième partie est publiée en France par la MEET [Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire], qui a publié une version bilingue de ce petit roman. Mais la première partie, qui s’intitule « Ceci n’est pas un pipe », n’existait pas encore. Esto no es una pipa est un roman très particulier qui recrée la mort par suicide d’un peintre guatémaltèque, Carlos Valenti, à Paris en 1912. Il avait vingt-trois ans, c’était un élève de Picasso, ami de tous les grands artistes de l’époque. Il s’est tiré deux balles. J’ai reconstruit le suicide raconté par quatorze personnes de son entourage. Ce sont quatorze chapitres très courts, d’une ou deux pages chacun, écrits à la première personne : Picasso, Debussy, Diego Rivera, toutes les personnes qui l’ont connu. Magritte est le dernier d’entre eux. Chacun des quatorze chapitres est basé sur l’une des œuvres de Carlos Valenti et l’édition originale du livre contient la reproduction des quatorze tableaux. C’est magnifique. Mais il s’agit d’un artiste presque inconnu au Guatemala. En effet, il est mort à vingt-trois ans en laissant une œuvre presque inexistante – d’autant plus que tous ses tableaux [environ soixante] ont été achetés par le même collectionneur ! Et je crois que la première exposition n’a eu lieu qu’en 2002 au Guatemala !
Parlons un peu de ton séjour en résidence à Bruxelles [au moment de l’entretien, Eduardo Halfón effectuait une résidence d’un mois à la Maison internationale des littératures Passa Porta]. Est-ce que la ville t’inspire quelque chose pour l’instant ?
Toutes les villes que je visite m’inspirent. Je suis sûr que je vais écrire quelque chose à propos de Bruxelles et peut-être à propos de la Belgique. Mais je ne sais pas si je le ferai demain ou dans vingt ans. Monastère, par exemple, est le récit d’un voyage que j’ai fait en 1998. Et je l’ai écrit quinze ans plus tard ! Je ne sais pas, je n’avais jamais eu l’idée d’écrire à propos de ce voyage, du mariage de ma sœur, etc. Mais j’ai eu l’intuition que je pouvais dire quelque chose en me servant du mariage. Le mariage était une excuse, la toile de fond, pas la raison d’être du livre. Mais le vrai voyage, ce n’était pas ça.
Une dernière question, qui concerne la traduction de tes livres en français, c’est-à-dire, au fond, la « naissance » de ton œuvre en France. En France, tes livres ont été traduit par Albert Bensoussan [traducteur très renommé ayant entre autres traduit de nombreux auteurs du « boom latino-américain »]. Quelle est ta relation avec lui ? Avez-vous parfois travaillé ensemble ?
Albert, c’est comme un grand-père pour moi. Nous nous aimons (rires). Nous sommes régulièrement en contact. Nous avons communiqué avant qu’il ne me traduise : il m’avait lu, puis il m’a écrit. Et je venais juste de signer le contrat avec La Table ronde, alors je lui ai dit que La Table ronde cherchait un traducteur... Mais notre relation est plus personnelle que professionnelle : il ne me pose presque aucune question. J’ai fait très peu de corrections, c’est une relation très affectueuse, nous nous voyons chaque fois que je viens en France, une à deux fois par an. Albert est quelqu’un de bien.
Merci, Eduardo Halfón.