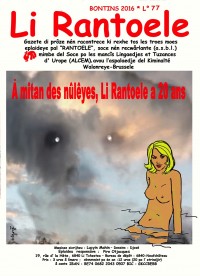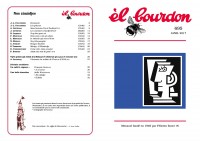
(walon d’ Coûrcèle Lîtchamp - Courcelles) Ç’ASTEUT an 1968, dj’aveu adon ène pètite…
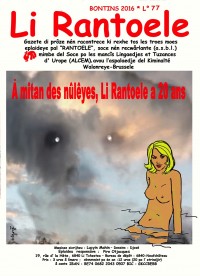
Dispûs a pô près deûs mwès asteûre, tos lès londis, dj’ a sovint scrît dins cès mèssadjes-ci dès novèles qui n’ èstin.n’ nin fwârt plêjantes. Audjoûrdu, dji v’ voreûve causer d’ saquants bounès novèles.
Dj’ a lît su l’ gazète qui lès Flaminds volenut tortos vnu passer leûs condjîs en Walonîye.
Siya ! Come, cite anéye-ci, i n’ pôront nin voyadjî è l’ France oudobin è l’ Èspagne, è l’ Grèce oudobin au Maroc, ou co branmint pus lon… On nè l’s-a jamês vèyu ritnu, èmon nos-ôtes, ostant d’ maujones po leûs condjîs ou d’ tchambes a l’ ôtél.
Dîre qui sacants politicyins do nôrd di nosse payis rwêtin.n’ di crèsse, tos lès côps qui causin.n’ dès Walons. Li batch n’ èst-i nin a s’ ritoûrner su l’ pourcia ?
Èt come lès-Olandès, qu’ ont todi stî lès prumîs, zèls – il ont d’djà acheté l’ mitan dès maujones dins lès ptits amias do payis dè L’ Rotche, ça dispû vint’ ans – dji v’ l’ acèrtine, cite anéye-ci, ça va ‘flameter’…
Auteur de Dès bounès novèles...
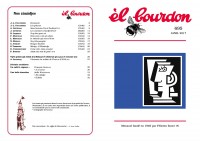
(walon d’ Coûrcèle Lîtchamp - Courcelles) Ç’ASTEUT an 1968, dj’aveu adon ène pètite…