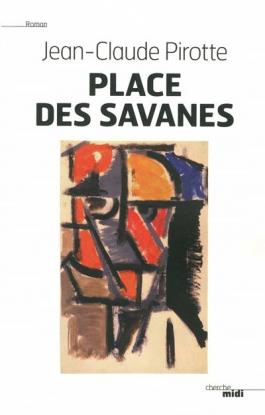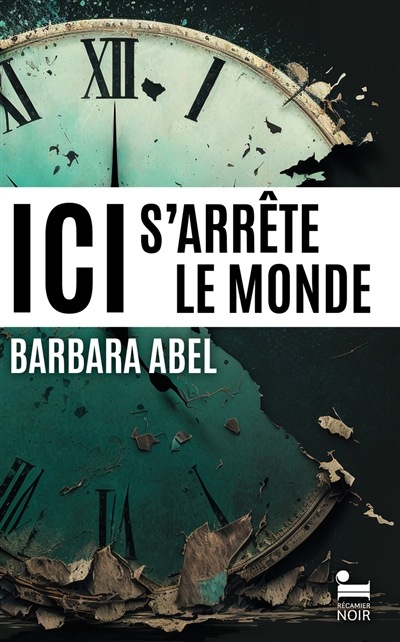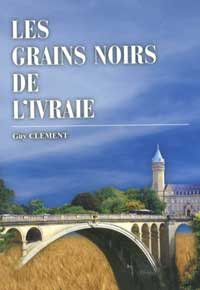Banquibazar
À PROPOS DE L'AUTEUR
Georges-Henri DUMONT
Auteur de Banquibazar
Georges-Henri Dumont naît à Zottegem le 14 septembre 1920. Il entame sa scolarité au Collège Sainte-Barbe, à Gand, et la poursuit au Collège Saint-Michel à Bruxelles, où sa famille s'est installée. Il entame des études supérieures aux Facultés Saint-Louis puis à l'Université de Louvain, où il a notamment pour professeur Léon van der Essen et pour compagnon Paul Warzée. En 1942, il est licencié en philosophie et lettres et en histoire. Il compte à son actif un ouvrage paru l'année précédente, un recueil de poèmes, La Voie rédemptrice, qui frappe par la violence de son expression. Ce sera sa seule incursion dans ce domaine, quoiqu'il ne dédaigne pas le lyrisme, auquel il consacre un essai d'une centaine de pages en 1943, À corps perdu, publié simultanément à Bruxelles et à Paris, qui s'attache à la poésie de l'entre-deux-guerres.
Georges-Henri Dumont se lance dans des travaux historiques, qui lui permettront d'obtenir l'agrégation en 1952. Marie de Bourgogne, en 1941, est son premier livre qui s'attache à notre histoire nationale, le premier d'une longue série. Quarante ans plus tard, en 1982, Dumont se penchera encore une fois, après Fernand Desonay et Luc Hommel, sur la figure de cette princesse de légende, dans un important ouvrage publié à Paris.
Les cinq années qui suivent sont une période de grande productivité. En 1942, après s'être penché sur la destinée de Louis Hennepin, explorateur du Mississipi, Dumont s'attache à La Compagnie d'Ostende, puis à Banquibazar, épisode de la colonisation belge au Bengale au temps de la Compagnie d'Ostende. Ce dernier volume sera réédité en 1982. Un Léopold III s'ajoute à la liste en 1944. Dans le même temps il collabore à la mise sur pied, notamment avec Georges Sion, de l'hebdomadaire Vrai. Il est pendant une courte période directeur littéraire des Éditions Dessart. En 1948, Le miracle de 1848 rappelle qu'un siècle plus tôt, la Belgique fraîchement créée commençait à se consolider.
Cette année-là, Georges-Henri Dumont se marie. Sous le nom de Viviane Dumont, son épouse écrira plusieurs romans. Après avoir passé quelque temps à l'Athénée de Florennes comme professeur, il est nommé conservateur aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Dès 1958, il est sollicité pour entrer dans le cabinet du ministre Van Hemelrijck, à l'Instruction publique d'abord, aux Colonies ensuite. Un an avant l'indépendance du Congo belge, il est rapporteur des travaux de la table ronde préparatoire à cet événement historique.
De 1965 à 1974, il est chef de cabinet de quatre ministres successifs de la Culture française : Paul de Stexhe, Pierre Wigny – sous la direction duquel il publie un «Plan quinquennal de politique culturelle» –, Albert Parisis et Charles Hanin. En 1974, il est secrétaire général de la commission belge de l'Unesco et président de la Commission du pacte culturel. Six ans plus tard, il est membre du Conseil exécutif de l'Unesco. Il occupe de multiples fonctions : président du conseil d'administration de l'Orchestre national de Belgique, membre des conseils de l'Opéra national de Belgique, de la Chapelle musicale Reine Élisabeth, de la Société philharmonique, puis des Archives et Musée de la Littérature. Professeur d'histoire économique et sociale à l'Institut catholique des hautes études commerciales (I.C.H.E.C.) à Bruxelles, il préside le Conseil supérieur de l'art dramatique.
Ces activités multiples n'ont pas ralenti la production de son œuvre consacrée essentiellement à l'histoire de la Belgique. Dès 1948, il rédige sur Léopold II un petit ouvrage de pensées et de réflexions choisies. Ce volume aura un premier prolongement en 1974 avec La vie quotidienne sous le règne de Léopold II, et un second en 1990 quand il publiera chez Fayard un Léopold II, qui lui vaudra le Prix de la biographie décerné par l'Académie française.
Mais il faut revenir en arrière pour le retrouver en 1952, année où voit le jour La vie aventureuse d'Antoine Van Bombergen, compagnon de lutte de Guillaume le Taciturne. Une Histoire des Belges en deux volumes paraît en 1954 et en 1956, prélude à une Histoire de Belgique, publiée vingt ans plus tard, en 1977 (prix Émile Bernheim). La collection «Que sais-je?» accueillera en 1991 un petit ouvrage de synthèse, traitant du même sujet, que Dumont domine avec une parfaite maîtrise.
En 1966, il écrit une biographie : Élisabeth de Belgique ou les défis d'une reine. Il y retrace avec grandeur et émotion une vie traversée par les deux guerres mondiales. Déjà, en 1959, il s'était penché sur la dynastie belge, soulignant son rôle dans l'élaboration progressive de nos institutions.
Au-delà de l'histoire, Georges-Henri Dumont s'intéresse au pays profond et à ses différents aspects. En 1958, il publie un ouvrage illustré qui sera traduit en allemand, Belgique, Bruxelles et pays wallons. Dix ans plus tôt, il avait déjà signé l'introduction d'un ouvrage illustré consacré à notre capitale. En 1960, en collaboration avec Alexis Curvers, il fait paraître Les délices du pays de Meuse. Il n'en oublie pas pour autant Bruges, à laquelle il consacre un texte en 1993 en accompagnement d'un volume d'iconographie. Auparavant, il a écrit sur Memlinc une monographie qui fait autorité et qui a été traduite en plusieurs langues. Ses collaborations à des revues ou à des périodiques sont nombreuses, sa signature se retrouve notamment dans Audace et dans la Revue générale.
Georges-Henri Dumont a été élu à l'Académie royale de langue et de littérature françaises le 13 février 1988. Il a été anobli avec le titre de baron.
Il est décédé le 6 avril 2013.