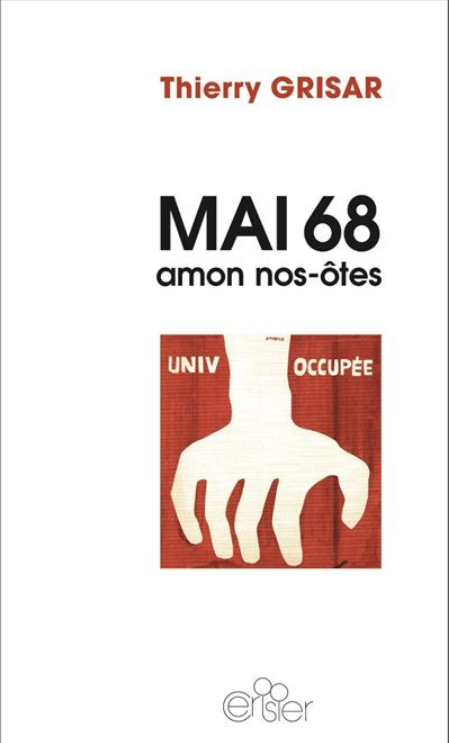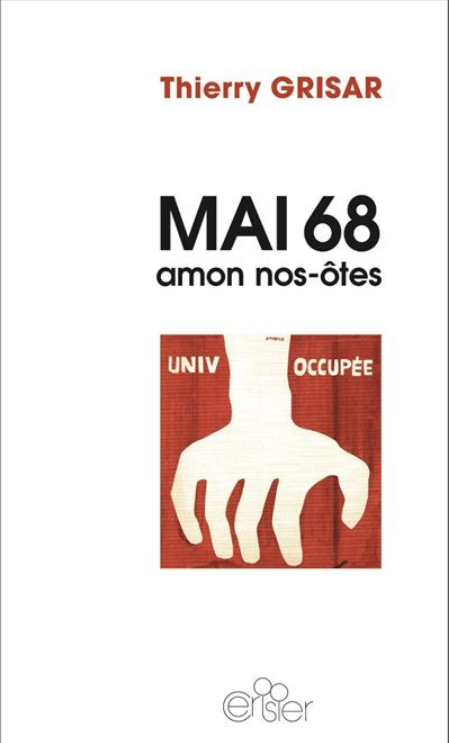
Ce livre est un dialogue. A la fois improbable et prévisible.
Improbable. Giovanni Lentini est sociologue et athée. André Antoine est ouvrier et prêtre.
Prévisible. Ils se connaissent de longue date. Ils sont militants, engagés socialement. Tous deux affiliés durant toute leur vie professionnelle à la FGTB.
Ce dialogue, sous la forme d’une conversation amicale, met en lumière la teneur de vies de prêtres engagés au service de la classe ouvrière. Pourquoi un jeune homme, décide-t-il de devenir prêtre ? Puis d’aller travailler en usine ? C’est apparemment paradoxal.
Mais pour André Antoine, devenu prêtre, il s’agit au contraire, à l’image de l’évangile, de « faire ce qu’on dit », et en conséquence de se mettre pleinement au service de ceux d’en bas, des laissés-pour-compte, des gens de peu.
Des dominés, des exploités. En vivant avec eux, et surtout, comme eux.
Une expérience humaine singulière, celle d’un être acceptant d’être le plus souvent en porte-à-faux (sauf avec lui-même…) : marginal dans l’Eglise, délégué syndical socialiste, gréviste, licencié et chômeur, puis aujourd’hui, militant associatif.
Giovanni Lentini resitue le parcours d’André Antoine dans le temps, des grèves de 60-61 à nos jours, en posant quelques repères historiques et en l’entourant de témoignages de personnes qui ont accompagné Antoine tout au long de sa vie professionnelle.
Aujourd’hui à la retraite, André Antoine est un des derniers prêtres-ouvriers de Belgique. A ce titre, il est le témoin d’une page d’histoire que certains s’ingénient à tourner, celle d’une société structurée autour du conflit capital-travail et de la défense de la classe ouvrière.
Ce livre les contredit.
Pour conclure, Giovanni Lentini émet sa réflexion sur les causes de la disparition des prêtres-ouvriers. En guise d’ouverture au débat.
Qui se souvient encore qu’il y a eu des prêtres-ouvriers ? C’est une espèce en voie de disparition au même titre que le rhinocéros blanc dont le dernier individu mâle est mort le 19 mars 2018. Deux femelles sont encore en vie, ce qui augure mal de la survie de l’espèce.D’ailleurs, les temps ont tellement changé que quand on lit la première occurrence de P-O dans le livre, on se demande ce qu’un Pouvoir Organisateur vient faire dans cette galère ! C’est donc à bon escient que Giovanni Lentini s’intéresse à cette problématique et on en sait gré aux éditions du Cerisier, toujours fidèles à leur conscience sociale. Giovanni Lentini, sociologue et animateur à la Fondation André Renard, connaît et côtoie André Antoine,…