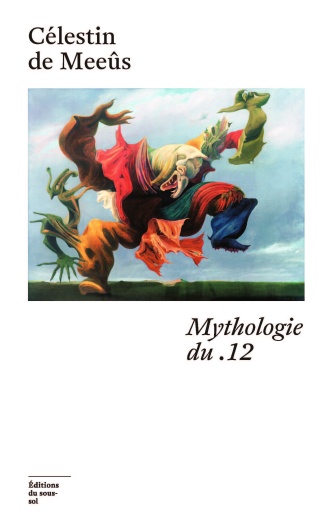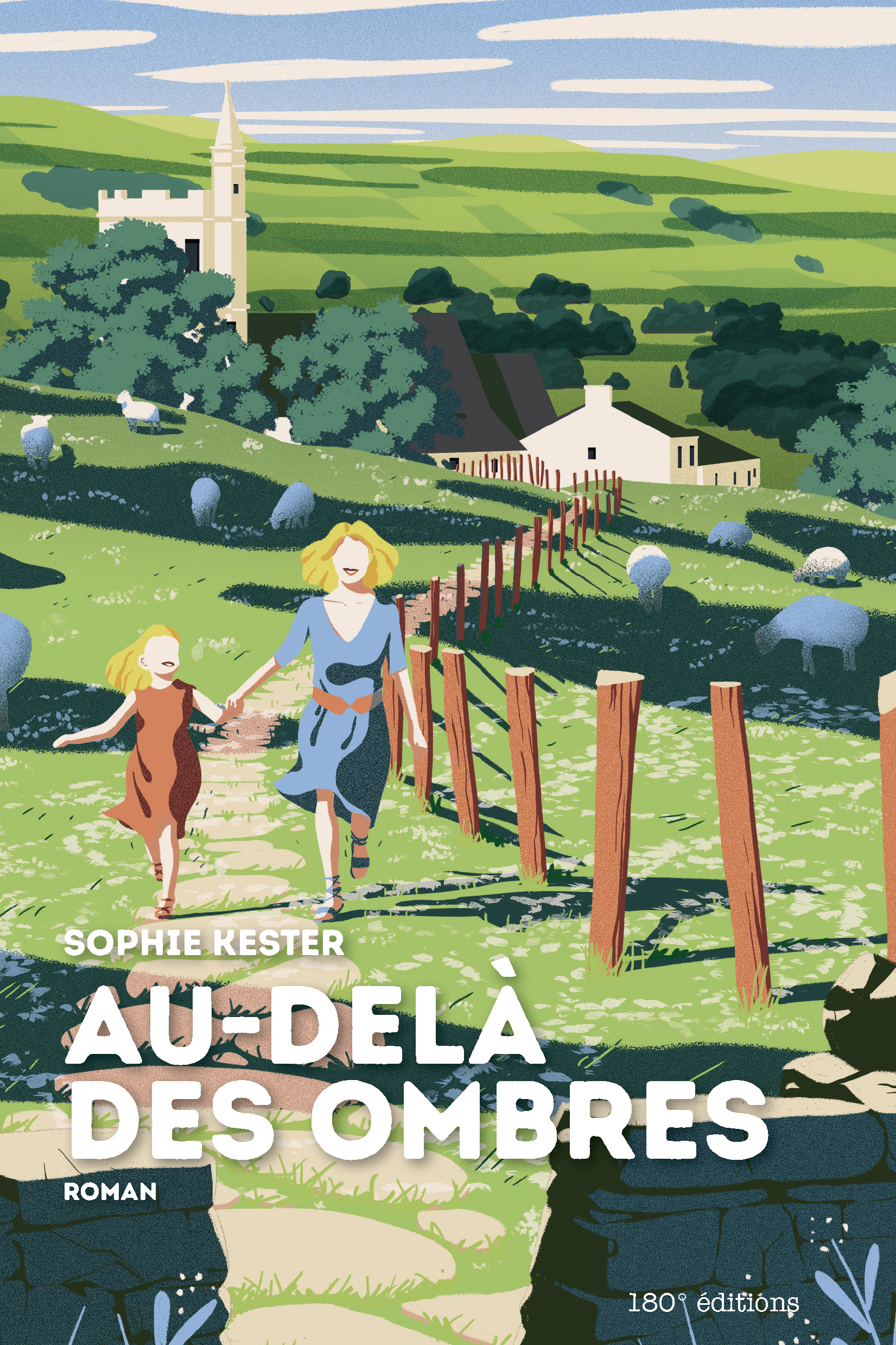Un père à soi
RÉSUMÉ
Dans quel engrenage sommes-nous entraînés lorsque les circonstances de la vie nous poussent à modifier des faits trop têtus ? Un père à soi explore avec une virtuosité époustouflante les effets, parfois terribles, de nos arrangements avec la réalité.
Une belle complicité, une entreprise paysagiste prospère, deux grands enfants à l’université : tout sourit à Alban et Lydie Jessel. Jusqu’à ce coup de téléphone d’une jeune inconnue, un soir, alors qu’Alban ferme son bureau. Sans en parler à son épouse, à qui il dit pourtant tout, Alban accepte de rencontrer la jeune femme. Elle lui explique avoir accompagné les derniers jours d’une certaine Michelle. Et exécuter sa dernière volonté : Michelle voulait qu’Alban sache, après sa mort, que sa vie durant elle n’avait jamais aimé que lui…
Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Alban n’a aucun souvenir de la moindre Michelle. Quoique… Peu à peu, presque malgré lui, il se remémore ce bref épisode amoureux de sa jeunesse qu’il pensait avoir oublié, et dont les conséquences sur sa vie, la vie de sa famille et celle de son étrange messagère vont remettre en question tout ce qu’il a, croyait-il, construit de plus solide.
AFFICHEZ LES FICHES LIÉES
Un père à soi
Première édition
Éditeur : Mijade
Date : 2023 (réédition)
Format : Livre
COUPS DE CŒUR ET SÉLECTIONS
À PROPOS DE L'AUTEUR
Armel Job
Auteur de Un père à soi
NOS EXPERTS EN PARLENT...
Le Carnet et les Instants
Armel JOB, Un père à soi, Robert Laffont, 2022, 306 p., 20 € / ePub : 13,99 €, ISBN : 978-2-22125-958-0À 45 ans, Alban Jessel est bien installé dans sa vie professionnelle et familiale. Avec sa femme Lydie (« C’est une femme très intelligente, je n’arrive pas à sa cheville », dit-il), il a créé une entreprise qui ne connaît pas la crise et est père de deux grands enfants, Sarah et Alex. Tout va bien pour lui (ce qui ne fait ni une histoire ni un roman) jusqu’à ce coup de téléphone mystérieux, d’une Virginie Lambert qu’il ne connaît pas, chargée de lui délivrer un message post mortem de la part d’une Michelle Nihoul, …qu’il ne connaît pas non plus. Et quand sa femme lui demande :…