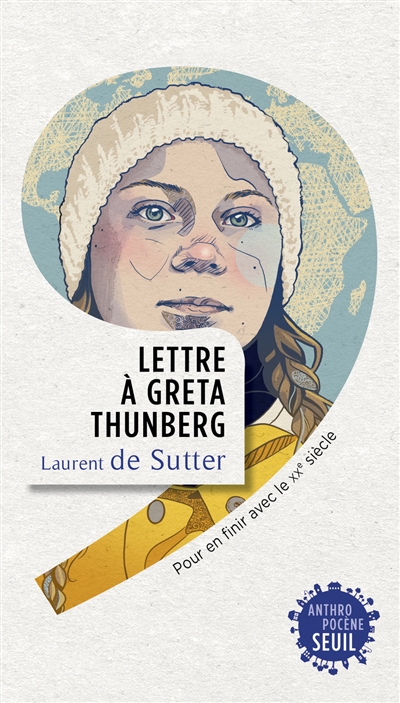
Lettre à Greta Thunberg. Pour en finir avec le XXème siècle
Laurent DE SUTTER , Changer le monde , Observatoire, coll. « Et après ?», #11, 2020, 38 p., ePub : 1.99 € , ISBN : 979-1-03-291581-3 Ô combien roboratifs en cette époque obtuse s’avèrent les deux derniers essais de Laurent de Sutter, Lettre à Greta Thunberg. Pour en finir avec le XXème siècle et Changer le monde. Sa percutante lettre à Greta Thunberg montre combien la jeune femme a réveillé nos consciences endormies, pointé notre déni, secoué notre inaction. Par son surgissement inattendu, insolite dans l’espace public, elle a introduit une nouvelle différence là où régnait une criminelle indifférence. Laurent de Sutter interroge la mobilisation planétaire sans précédent que Greta Thunberg a soulevée et la levée de boucliers qu’elle a suscitée de la part des écocidaires et des planqués, complices du système d’extermination du vivant. Elle a fait bouger les lignes en alertant sur l’urgence climatique, l’urgence à sauver les formes du vivant habitant cette Terre. Pour l’auteur, la force de ralliement, la singularité de son engagement viennent de ce qu’elle a délaissé la connaissance (qui, laissant tout en place, est complice de la dévastation écologique) au profit du savoir (savoir-pratique au sens de praxi s). Quelques salves bien décochées visent la culture d’hyperlettrés accrochés à leur trône, ceux-là mêmes qui ont conspué Greta Thunberg pour avoir transgressé les règles des discours acceptables, c’est-à-dire la police de la pensée. Or, elle est un hapax dans l’ordre discursif. On ajoutera que, souvent, les hyperlettrés sont, comme les sous-lettrés techniciens, des analphabètes de la vie. G. Thunberg se place sur le plan de la vie (mise à mort, malade, assassinée) et non sur celui des discours, de l’empire de la connaissance. Si, avant elle, il y eut de nombreux penseurs, militants, lanceurs d’alerte, son nom singularise la rencontre entre un combat et l’esprit du temps : cette cristallisation entre esprit subjectif et esprit objectif vient de la forme d’engagement qu’elle promeut mais aussi de la visibilité de la débâcle, de l’aggravation du collapsus environnemental au 21e siècle. Au 20e siècle, nombreux furent les lanceurs d’alerte, A. Naess, Yourcenar, Monod, Lévi-Strauss, R. Carlson, J. Goodall, les militants écologiques, anarchistes, les hippies qui, non seulement, ont tiré la sonnette d’alarme mais proposé des modes de penser et de vie respectueux des formes du vivant. C’est cette sagesse, cette autre manière de co-exister que l’Occident a balayées depuis les années 1980 et que les peuples autochtones que nous exterminons mettent en œuvre depuis des siècles. Dans le « pour en finir avec le XXème siècle » annoncé par le sous-titre, il faut entendre un « pour en finir » avec un paradigme bien plus ancien, hérité d’un dualisme entre l’humanité et le monde, un appel à sortir de la critique et des pièges mortifères de ce que Philippe Descola appelle le naturalisme. La différence que Greta introduit n’est pas réciprocable à la différence entre mondes, celui du 20e siècle et celui du 21e. D’une part, parce que le 20e au travers de nombreux mouvements sociaux et de pensées philosophiques a alerté sur le prix désastreux à payer pour le progrès et proposé des alternatives concrètes. D’autre part, parce que le syndrome de l’autruche, le déni du prix à payer et l’explosion du cynisme de ceux qui ont un intérêt à ce que la crise climatique s’aggrave, s’exacerbe au 21e siècle, ce que Laurent de Sutter ne manque pas de souligner. G. Thunberg met en évidence que nous vivons une crise de régime, de civilisation et que la question climatique est une guerre qui oppose gaïaphiles et gaïaphobes (Latour).Là où nombre d’essais vont jouer les pythies, vaticiner le « monde d’après », Changer le monde s’engage salutairement dans une autre voie et oppose la manière dont les Grecs concevaient les épidémies (sacrifices aux dieux) à notre perception de sa nature virale, médicale. Témoignant de la façon dont nous construisons le monde et nouons des rapports avec les règnes de la cathédrale du vivant, les épidémies sont le corrélat de notre colonisation effrénée de l’espace planétaire. L’on s’étonnera que l’auteur voie dans la pensée écologique ou anticapitaliste une volonté de s’attaquer aux seuls effets de nos choix d’être au monde alors qu’ils visent à modifier les causes, les infrastructures. La conclusion de l’essai redoublera notre étonnement : le recours à l’accélérationnisme afin de dessiner un autre monde, l’appel à « une industrie du world-building », au constructivisme d’une « industrie plus industrielle » hyperbolise une pensée prométhéenne de la maîtrise qui est précisément celle que Greta Thunberg, les penseurs écologiques congédient.…
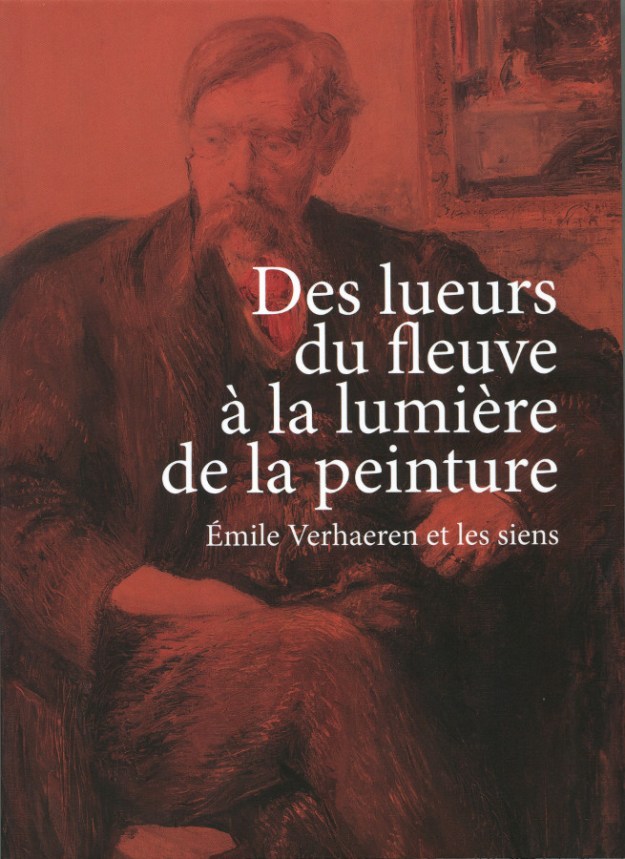
Des lueurs du fleuve à la lumière de la peinture. Émile Verhaeren et les siens
On n’imagine pas Verhaeren sans l’Escaut, qui a marqué sa sensibilité,…
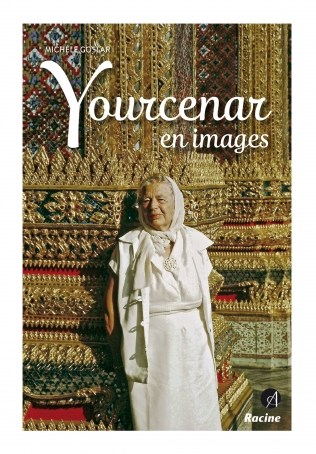
Fondatrice du Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar, auteure d’une…