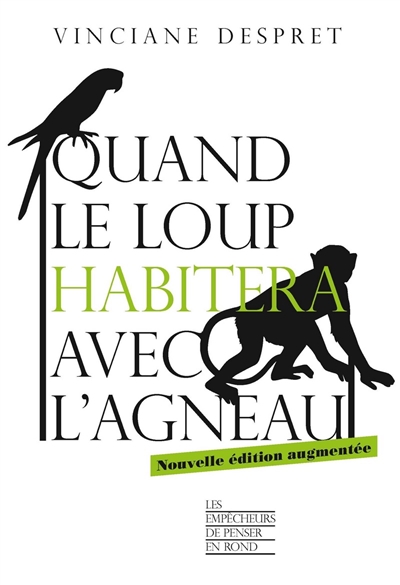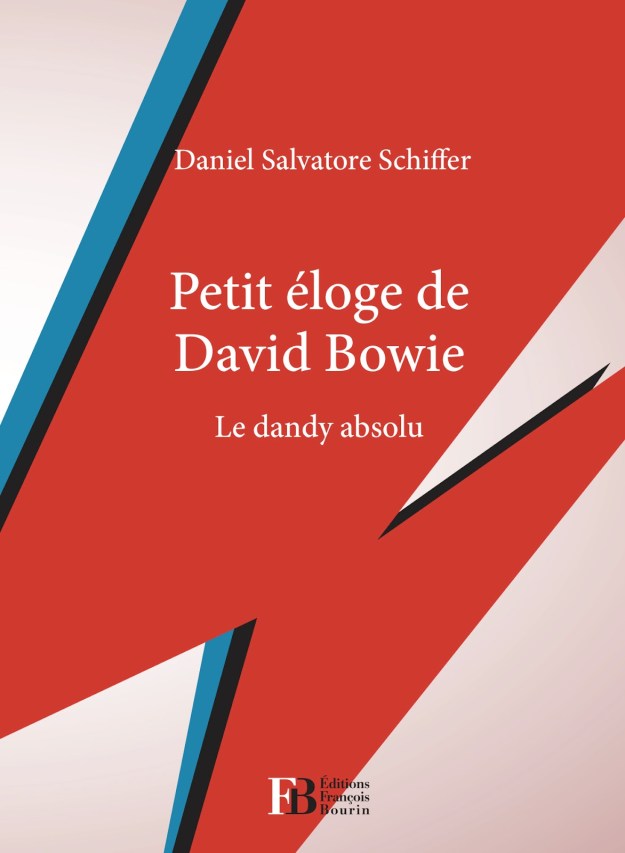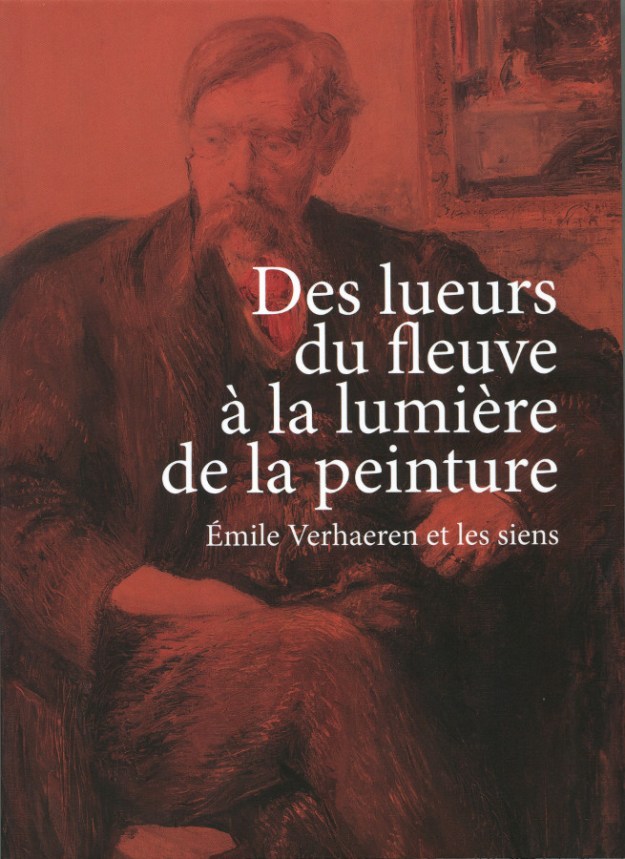Histoire d'un livre : Un mâle de Camille Lemonnier
RÉSUMÉ
À propos du livre (début du Chapitre 1)
«Est-ce que nos livres, après tout, ne sont pas toujours faits des miettes de notre vie?» En posant la question comme il le fait, Lemonnier reconnaissait l’étroit rapport qui existe entre la propre expérience de l’écrivain et la matière de son oeuvre, les mille liens qui unissent celle-ci à celui-là.
Des quelque soixante-dix volumes qu’il a publiés, aucun mieux qu’Un mâle n’aiderait à montrer cette relation;…
DOCUMENT(S) ASSOCIÉ(S)
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gustave Vanwelkenhuyzen
Auteur de Histoire d'un livre : Un mâle de Camille Lemonnier
Né à Schaerbeek le 9 avril 1900, Gustave Vanwelkenhuyzen fait ses humanités à l'athénée que sa commune natale a fondé en 1913 et qui, par suite de la fermeture des universités pendant la guerre, accueille en son sein des professeurs de l'enseignement supérieur privés de leur chaire. C'est ainsi qu'il a pour maîtres, dans les locaux vétustes de la rue des Palais, Gustave Charlier et Henri Grégoire, éminent professeur de l'Université libre de Bruxelles. Il est aussi l'élève de l'écrivain Henri Liebrecht. Signes prémonitoires? À l'université, étudiant de la section de philologie romane, il retrouve Gustave Charlier, qui l'initie à la discipline de l'histoire littéraire, oriente sa vocation de chercheur, et, certain jour de 1949, c'est par la voix d'Henri Liebrecht que l'Académie le recevra officiellement.
Issu d'une famille d'enseignants, docteur en philosophie et lettres en 1924, il opte tout naturellement pour la carrière à laquelle son milieu et sa formation l'ont préparé. Professeur au Lycée de jeunes filles de Gand de 1924 à 1929, affecté ensuite à l'Athénée royal d'Ixelles, il y enseigne pendant deux décennies. À partir de 1950, il apparaît encore dans les classes, mais en qualité d'inspecteur : inspecteur linguistique jusqu'à la suppression de cette fonction, en 1963; inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire jusqu'à l'heure de la retraite, en 1965.
Professeur tout dévoué à sa tâche, fonctionnaire impeccable, il consacre les loisirs du métier à l'édification d'une œuvre considérable, centrée sur l'histoire des lettres françaises de Belgique. Sa bibliographie (19 livres, 5 préfaces, 132 articles, 66 comptes rendus), constituée pour les cinq sixièmes durant les trente années de son activité professionnelle, indique l'ampleur du travail; l'excellence de cette production abondante atteste que la rectitude scientifique et la formulation n'ont jamais souffert de la moindre défaillance.
Son premier livre est, d'emblée, un grand livre, aujourd'hui encore un incontournable ouvrage de référence : L'influence du naturalisme français en Belgique de 1875 à 1900, mémoire de 340 pages couronné par l'Académie et publié par elle en 1930. À travers la presse quotidienne et périodique dépouillée systématiquement, le jeune essayiste observe comment le public belge accueillit un mouvement littéraire qui, en France même, son pays d'origine, n'en finissait pas d'affronter des oppositions farouches. L'époque qu'il étudie vit la Belgique sortir de son apathie intellectuelle et se donner une littérature originale. Il montre que cette mutation irréversible fut amorcée par des revues d'avant-garde, L'Actualité (1876-1877) et L'Artiste (1875-1880), acquises au naturalisme en qui elles voyaient la modernité et le ferment d'une création littéraire sans a priori, sans tabou. Examinant l'étape suivante, la période où les théories de Zola influencèrent des écrivains tels que Lemonnier et Eekhoud, et où elles interpellèrent les deux grandes revues fondées en 1881, L'Art moderne et La Jeune Belgique, organes du renouveau, il constate que les adeptes belges du naturalisme n'y souscrivirent que sous bénéfice d'inventaire, refusant d'être les pieux épigones de l'école de Médan. Son enquête abonde en éclaircissements de cette importance.
L'époque littéraire dont il n'a examiné qu'une tendance dans son opus 1, il ne cessera, par la suite, de l'interroger. L'exploration du champ naturaliste lui fait découvrir le Verviétois Francis Nautet, critique sévère du zolisme après en avoir été le champion. En 1931, il lui consacre un excellent petit livre, Francis Nautet, historien des lettres belges, où il rend hommage au pionnier qui, dès 1892, retraça la prodigieuse renaissance littéraire de la Belgique. Un grand écrivain français aiguise depuis longtemps sa curiosité; en 1935, il dépose le résultat de ses patientes recherches : J.-K. Huysmans et la Belgique, ouvrage définitif, approche subtile d'un homme et d'une œuvre complexes. Après cette publication, le chercheur cède provisoirement la plume au vulgarisateur, et ce sont, entre 1936 et 1942, six volumes de pages d'écrivains belges choisies et présentées avec soin. En 1945, paraît Verlaine en Belgique, ouvrage définitif, dont l'érudition n'occulte jamais l'objet fondamental : une grande œuvre poétique liée intimement aux tribulations d'un pauvre hère.
Le 14 février 1948, Gustave Vanwelkenhuyzen est élu à l'Académie, au siège de Maurice Wilmotte. Il ne dormira pas sur ses lauriers. Fidèle à l'époque qu'il a choisie en début de carrière, il continue à la prospecter, au fil de publications formant trois groupes : écrivains belges, écrivains français mis en contact avec la Belgique, lettres inédites introduites et annotées. Bien à regret et sauf deux exceptions, on ne mentionnera ici que les parutions sous la forme du livre. Le premier groupe comprend Vocations littéraires (1959), où il est question de Lemonnier, d'Eekhoud, de Maeterlinck, de Verhaeren, de Rodenbach et, in fine, de quatre petites revues annonciatrices du réveil tout proche; Histoire d'un livre. Un mâle de Camille Lemonnier (1961), Solyane, de Charles van Lerberghe, dans le Bulletin de l'Académie (1968). Du second groupe, on retiendra : Insurgés de lettres. Paul Verlaine, Léon Bloy, J.-K. Huysmans (1953); Mallarmé et la Belgique, dans le Bulletin de l'Académie (1968). Le troisième groupe relève d'un genre difficile et méconnu où l'érudition de l'historien, l'obstination du chercheur et le flair du limier, en se conjuguant, ont fait merveille : J.-K. Huysmans. Lettres inédites à Camille Lemonnier (1957); J.-K. Huysmans. Lettres inédites à Jules Destrée (1967); André Gide et Albert Mockel. Correspondance (1891-1938).
Publiée en 1975, la correspondance Gide-Mockel est le dernier livre de Gustave Vanwelkenhuyzen, décédé inopinément le 28 janvier 1976. Ses amis et ses confrères s'apprêtaient à le fêter en lui offrant un recueil d'essais situés dans le prolongement de son œuvre, Regards sur les lettres françaises de Belgique.