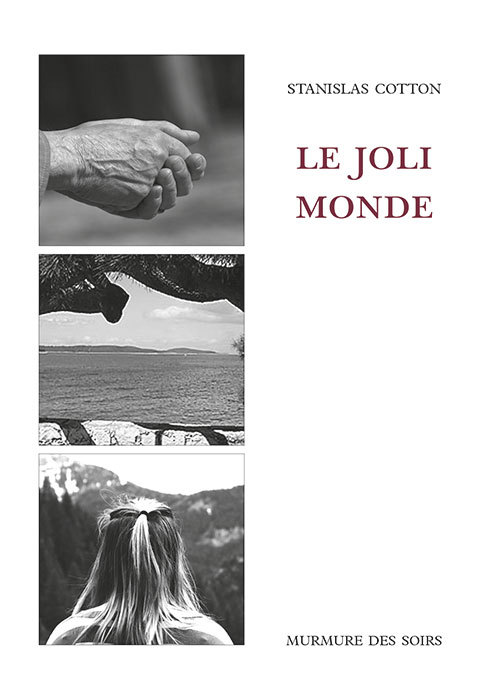
Peu avant sa mort, Ariel Bildzek, ce géant de la littérature mondiale, m'a révélé ce qu'il…
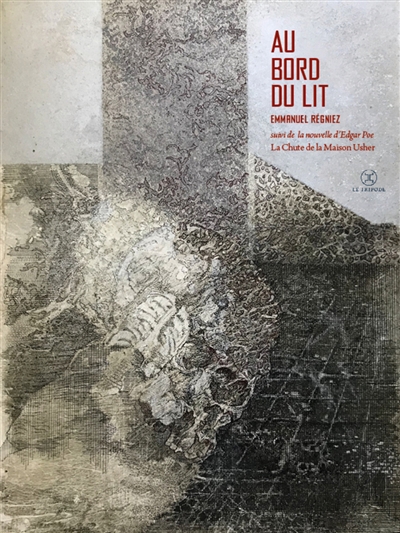
Emmanuel Régniez aime écrire la musique, la littérature, la répétition, et la mélancolie…

L’histoire commence ce matin. Elle terminera ce soir. À peine une journée pour raconter un peu de ma vie. Ce matin, je vis encore, je vous parle, je bois du café, je compte fumer une cigarette et bientôt, j’irai aux toilettes. L’effet entre la caféine et le tabac est immédiat. Ce soir, je serai mort. C’est une certitude. Je le sais, je ne vais pas le cacher, je ne vais pas étouffer cette information, je n’ai pas peur de mourir, pas peur de voir la mort approcher mon physique d’européen blanc, pas peur de quitter ce monde pour rejoindre l’espèce mystère de l’au-delà. Ce matin, le soleil brille, le ciel est bleu, le vent est doux, je vais alors éviter le sujet de la mort. Tout à l’heure, je lui consacrerai quelques pages.
Dernière journée d’une vie humaine. Le compte à rebours est lancé. Quatorze heures pour ne plus rien regretter. Quatorze heures au cours desquelles Corentin Jacobs, avec ce premier roman, nous décrit dans un style aussi caustique que lucide la vie, les attentes et les frustrations d’un looser quotidien.
Dès le début, le ton est donné. Le personnage annonce la fin et la fin est la mort. Sans équivoque. Mais peut-être pas sans surprises. Il fonce vers elle malgré l’humour (noir), la fantaisie et la légèreté du début. La mort est sa drogue : il veut sentir sa seringue lui piquer les veines. Mais ce n’est pas seulement sa propre mort qui le motive. C’est aussi la mort d’un idéal et d’un système. Dans moins d’une journée, l’Occident risque de trembler.
Ceci est le premier livre de l’auteur.
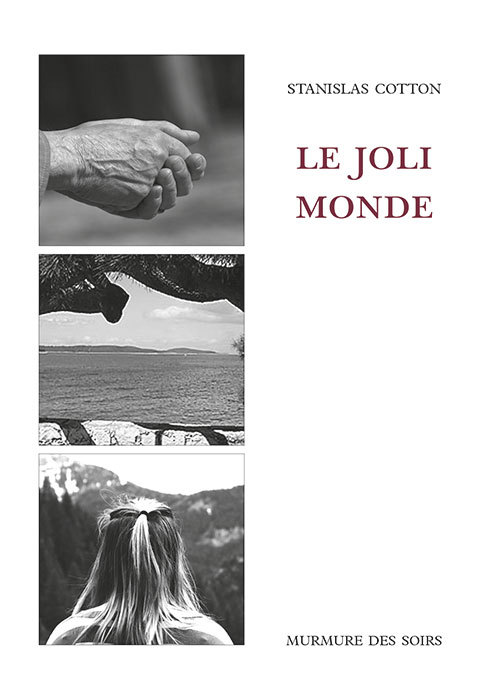
Peu avant sa mort, Ariel Bildzek, ce géant de la littérature mondiale, m'a révélé ce qu'il…
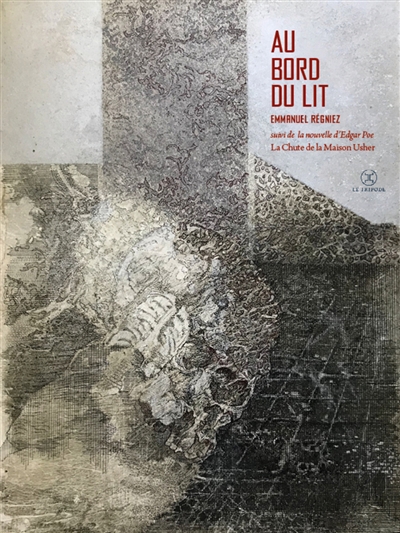
Emmanuel Régniez aime écrire la musique, la littérature, la répétition, et la mélancolie…
