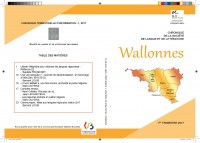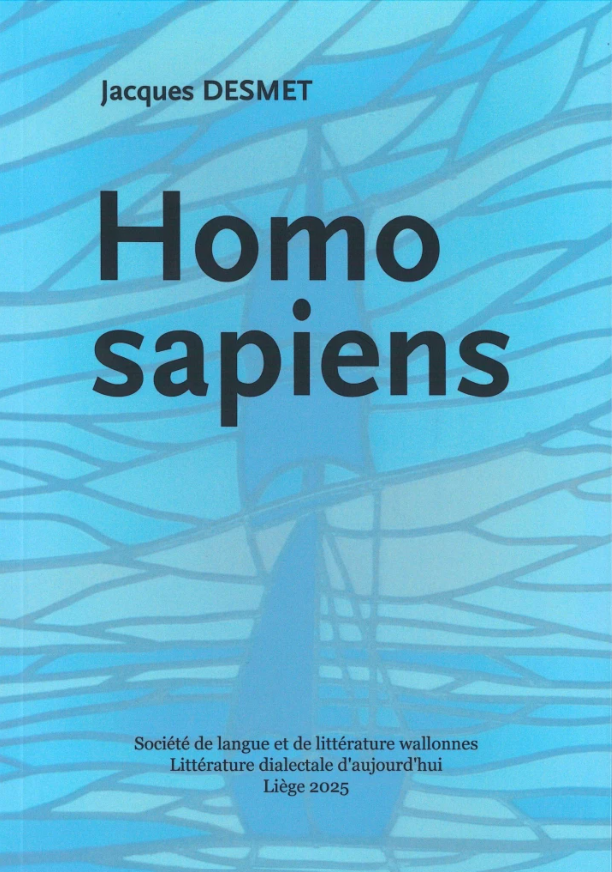
Jacques Desmet est une silhouette bien connue des « tauveléyes » (tables de conversation) et des cabarets…
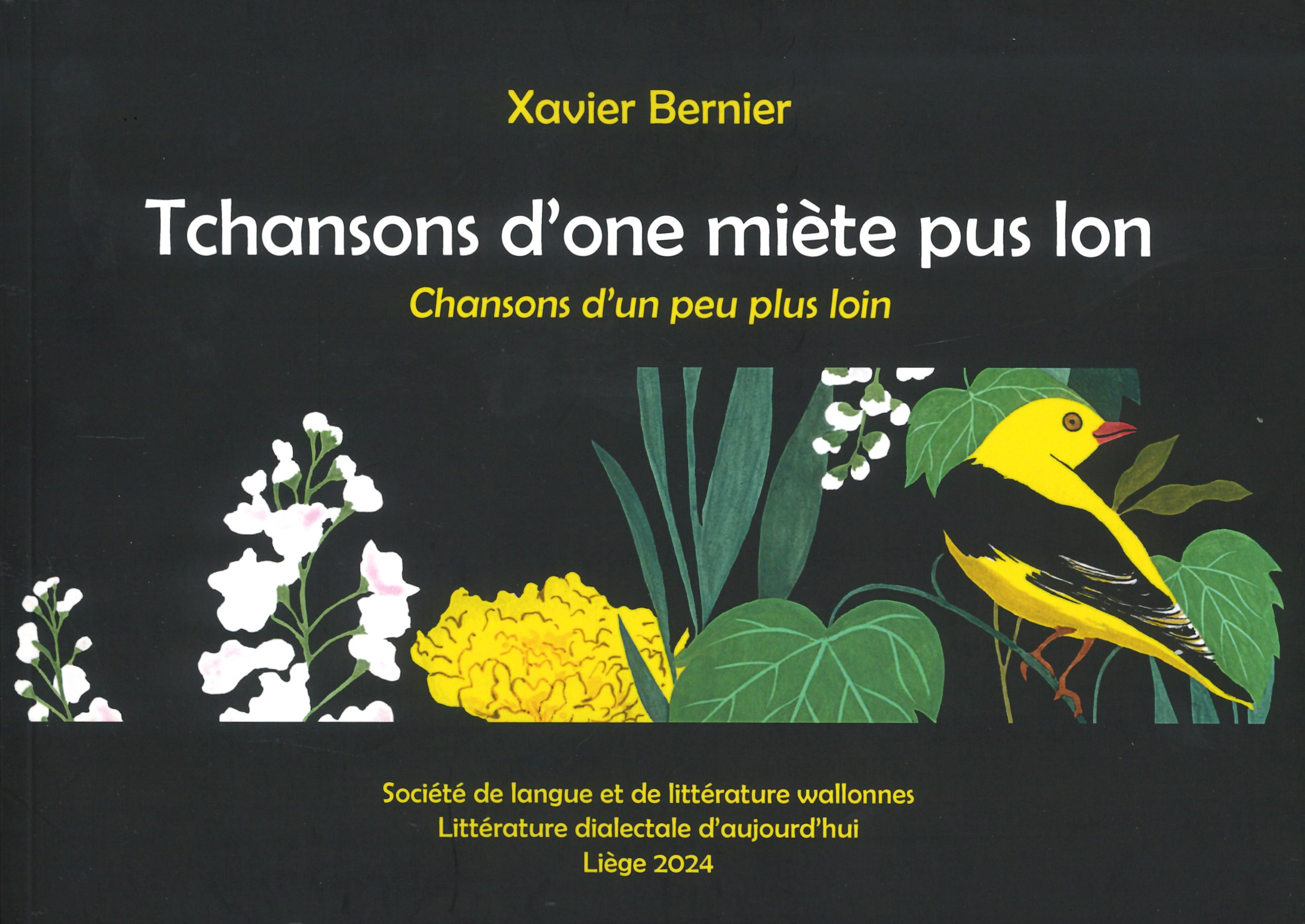
Tchansons d’one miète pus lon. Chansons d’un peu plus loin
Les membres de la Société de langue et de littérature wallonnes, qui reçoivent ses publications ordinaires avant même qu’elles n’arrivent en librairie, auront certainement remarqué l’évolution de sa plus vaste collection, « Littérature dialectale d’aujourd’hui ». Au-delà du travail innovant réalisé sur les maquettes, il convient d’observer une inflexion dans le choix des textes : alors que, depuis une bonne décennie, elle proposait des œuvres d’écrivains confirmés — et parfois même des rééditions — voilà qu’ont paru coup sur coup deux premiers recueils. Si Al cwène dès djoûs de Jean Collette , qui réunit plusieurs suites de poèmes, semblait déjà une œuvre de maturité, ces Tchansons d’one miète pus lon marquent l’entrée en littérature d’un nouveau talent, par ailleurs l’un des cadets de la Société. (Qui se souvient que la « petite collection », comme elle est souvent appelée, fut composée à l’origine de plaquettes se réjouira certainement qu’elle joue à nouveau ce rôle de vivier.) Dire que Xavier Bernier est talentueux semble un euphémisme. Il appartient à une nouvelle génération de wallonophones qui, faute de l’avoir appris de jeunesse, ont dû prendre leur idiome à bras-le-corps, en interrogeant sans relâche des parents et en disséquant les meilleurs auteurs (ces chansons sont dédiées à la mémoire de deux maitres, Émile Gilliard et Auguste Laloux). L’on a peine à le croire tant il déploie une langue riche et précise, qui puise directement aux images et aux sonorités du parler de Crupet. Leur lecture rassurera certainement les amateurs quant aux capacités de régénération des lettres wallonnes, qui vivent une période charnière.Mais en miroir — il faut le reconnaitre — la rencontre d’un texte si exigeant peut faire craindre la pénurie de lecteurs. En effet, en dépit des efforts de l’éditeur, qui propose un rappel des principes de transcription Feller, une traduction française en vis-à-vis et cinq pages ramassées de notes et de glossaire, ce type d’œuvre reste difficile d’accès pour un public qui ne possède pas entièrement son wallon. Car si la version française restitue le sens, elle perd certaines allitérations, certains enjambements : Quèwéye d’aveûles au bwârd do trau Onk qui sît l’ôte, tot fiant come s’i Crwêreut qu’i veut pus clér qui li Waîte bin l’ bèle binde di laîds bâbaus ! [File d’aveugles au bord du gouffre / L’un suit l’autre en faisant mine / De croire qu’il voit mieux que lui / Belle bande d’idiots !] Et il en va de même pour les idiotismes, généralement intraduisibles. Dire que le piche-è-l’aye est désinvolte semble trop faible : il est en fait « pisse à la haie ». De même pour le tape-à-gaye (le gauleur de noix, qui frappe au petit bonheur la chance) et le tchîye-à-pouf (le « chie au hasard »), qui perdent aussi de leur saveur. C’èst mi qu’èst piche-è-l’aye Tape-à-gaye Tchîye-à-pouf C’èst vos, m’ fi, qu’èrite do bouzouf ! [Je suis désinvolte / Imprévoyant / Foireux / C’est toi, mon gars, qui hérites du bordel !] Ces deux extraits font entrevoir un thème important du recueil, à savoir les limites planétaires et la critique de l’individualisme. Xavier Bernier est en effet un auteur engagé, qui dénonce aussi la « Forteresse Europe » et la fast-fashion . Il est intéressant d’observer que, ce faisant, il renoue avec une tradition centenaire de la littérature en langue wallonne, qui a souvent — et notamment dans ses débuts moralistes — prêché le principe de l’égalité de tous devant les drames. Comme Nicolas Defrecheux a pu dire, dans des vers réédités à l’occasion de la dernière Fureur de lire , « Qui t’ plèce so l’ monde seûye basse ou hôte, lès måleûrs todi t’ac’sûront » [« Que ta place sur le monde soit basse ou haute, les malheurs t’atteindront toujours »]. Xavier Bernier tance le consommateur irresponsable : Ti t’ pous bin mète à djok su t’ twèt Ou d’djà ataquè à couru Gn’a pus qu’ deûs maniéres di moru Si ti n’ néyes nin, ti crèverès d’ swè [Tu peux te percher sur ton toit / Ou déjà commencer à courir / Il n’y a plus que deux manières de mourir / Si tu ne te noies pas, tu crèveras de soif] Est-ce à dire qu’il se place dans l’exacte continuité d’écrivains qui, avant lui, ont exalté en wallon la vie simple et la sagesse populaire ? Du tout. Il cherche plutôt sa propre voix, entre émerveillement du quotidien et solidarité par-delà les frontières, y compris les frontières taxonomiques. Mi, dji n’è vou nin, d’ vos racènes Èt dji n’ vou nin d’meurè stitchi Tot tchantant, mès pîds dins l’ansène Ou dins l’ crausse aurzîye do pachi [Je n’en veux pas, de tes racines / Et je ne veux pas rester fixé / Chantant, les pieds dans le fumier / Ou dans l’argile grasse du verger] Le meilleur exemple est sa Tchanson po lès mouchons , qui reprend un air traditionnel quelque peu carnassier. Mais, sous sa plume, « Dj’ê stî al tchèsse aus p’tits mouchons / Dj’ènn’ ê tuwè pus d’on million » [ « J’ai été à la chasse aux petits oiseaux / J’en ai tué plus d’un million » ] devient… Avoz choûtè lès p’tits mouchons Qui tchantenut chaque si p’tite tchanson ? [ As-tu écouté les petits oiseaux / Qui chantent chacun sa petite chanson ? ]Gageons que c’est grâce à de nouveaux bardes comme lui « Qui l’ môde va d’abôrd riv’nu do tchantè è walon / Èt r’chuflè dès-aîrs do timps d’ nos ratayons » [ « Que chanter wallon reviendra à la mode / Tout comme siffler des airs anciens » ]. Julien Noël Les traductions offertes ici sont les adaptations littéraires de l’auteur. Plus d’information Aves ces Tchansons d’one miète pus lon , Xavier Bernier se sert des mots percutants et des images fortes du wallon namurois pour explorer les questions du présent. Europe-forteresse, dérèglement climatique, mais aussi émerveillement devant la beauté, attachement à l’enfance, vie amoureuse… L’auteur envisage ces thèmes universels en puisant aux sources les plus locales (La Marie Doudouye) comme les plus exotiques (Cesária Évora ou Antonio Carlos Jobim). Ce recueil captivant, qui célèbre la diversité et l’héritage, et où chaque terme est choisi pour sa sonorité ou son rythme, est un appel à résister à l’uniformisation…