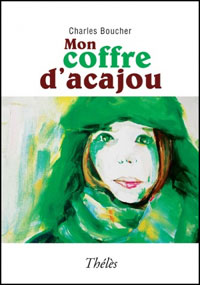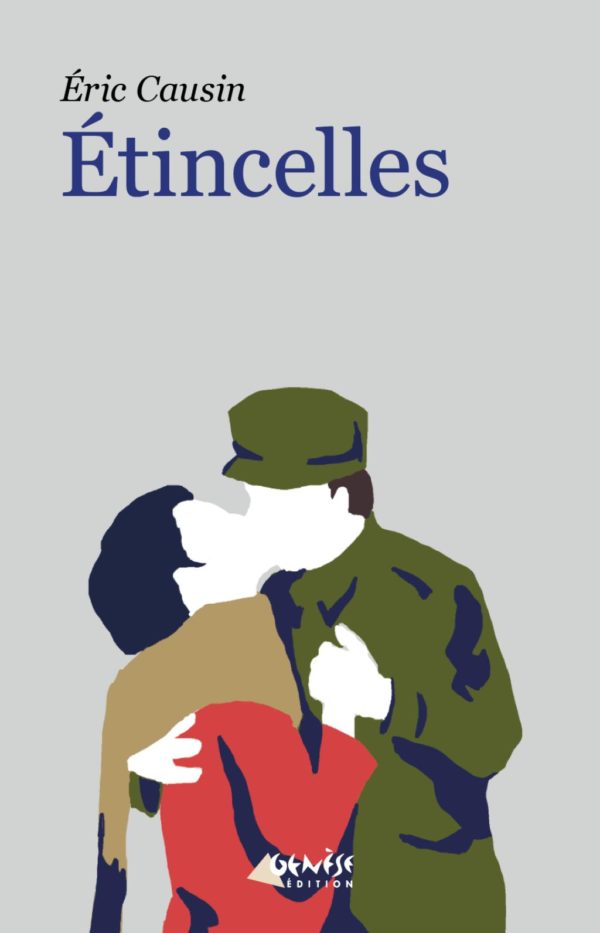Auteur de Au pays de mon père
Natif du signe du Taureau, fils de laboureur, petit-fils de sabotier, au 22 avril 1936, à Ochamps, aux sources de la Lesse dans le bassin mosan, en Ardenne belge, Léopold Omer Marchal était le cadet d'une famille de 9 enfants. Sa qualité de septième fils lui valut ce prénom de Léopold, le roi des belges Léopold III, qui régnait alors, ayant accepté d'être son parrain selon la coutume du Royaume de Belgique privilégiant les fils de ce rang. Après des études à l'école du village puis chez les frères des écoles chrétiennes à Namur, puis à l'école normale de Liège, il obtint en 1957 à l'école coloniale de Bruxelles le brevet d'agent territorial qui lui permettrait de servir dans les territoires de la belgique d'outre-mer. Comme tel il arriva au Ruanda-Urundi que ce pays administrait sous la tutelle de l'organisation des Nations unies. De 1958 à 1962 il apprit au contact des Batutsi de l'actuel Rwanda son métier d'homme. L'indépendance des colonies mit fin à cette ébauche de carrière, à la suite de quoi Omer Marchal devint journaliste, s'adonnant longtemps au reportage international, «de l'Afrique noire à la Chine rouge», selon l'expression du critique du Luxemburger Wort Julien Bestgen, un des meilleurs commentateurs de son œuvre. Sans abandonner complètement le journalisme, qu'il ne pratique plus qu'en auteur de livres, Omer Marchal, passé en 1985 avec armes et bagages à l'édition et à l'écriture, a dirigé à Bruxelles la maison belge des Editions Hatier. Il a construit sa maison, en bois, à Villance, le village de sa famille paternelle depuis 500 ans, au bord de la forêt ardennaise. A la fin de 1992, Omer Marchal a mis fin à sa tâche d'éditeur à Bruxelles. IL est retourné vivre dans le village ancestral de la Haute-Lesse, et y partage son temps entre écriture et édition. En 1994, il a en effet lancé sa propre maison indépendante, Omer Marchal Éditeur. Sa production est toute vouée à l'Ardenne. Omer Marchal s'est éteint le 6 novembre 1996.