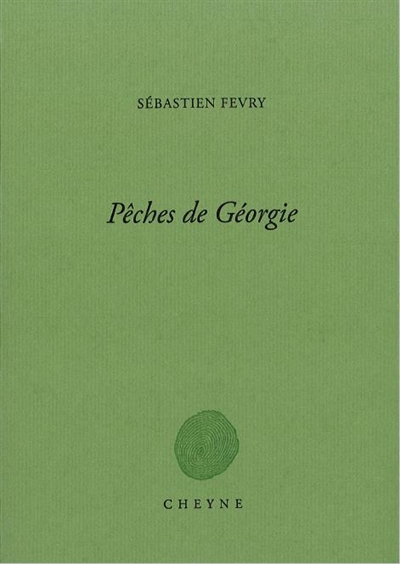
Saluée par plusieurs récompenses, dont le prix Marcel Thiry en 2021 pour Brefs déluges…
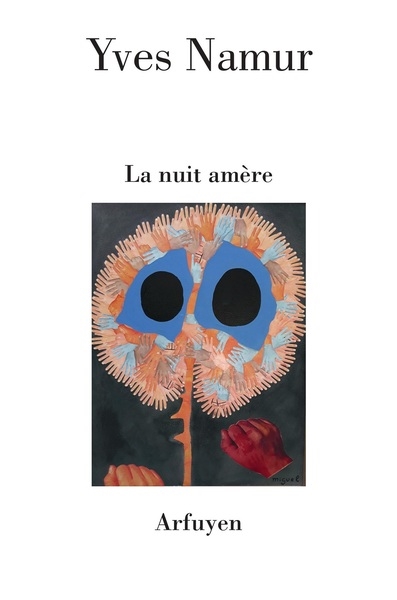
« Toutes ces traces, Les connues, les oubliées Ou les perdues Veulent-elles aussi nous porter De l’autre côté du…
Soixante-six sizains qui sont une répercussion d’une des périodes les plus pénibles de la vie de leur auteur : une confrontation avec la douleur et la beauté de l’amour, avec la beauté et la douleur de l’existence. Mais loin d’être une catharsis, ce monologue avec l’absence est un avis personnel qui s’emploie à décortiquer le quotidien d’une année, quotidien résolument lié à la réalité contemporaine et qui tente de se dépasser, de tendre vers l’universel à travers l’art complexe qu’est et demeure la poésie. Afin de maintenir malgré tout le potentiel de désir de liberté à défendre. Agrémenté par des expériences graphiques survenues parallèlement au travail sur le langage.
« j’ai l’air de fragmenter comme ça, en réalité j’unis »Ch. DotremontCeux qui ont eu l’occasion d’entendre Tom Nisse sur scène savent l’importance qu’il accorde à ce subtil dosage qui s’opère entre la forme, le propos et le corps dès lors que l’on se trouve face au public. Accompagné ou non d’un musicien, le poète sait jouer de cette alchimie particulière. Rares en effet sont les poètes qui parviennent comme lui à trouver la juste mécanique de cet engrenage dans le scandé, dans la (pro)pulsion du poème. C’est dire si la lecture d’un nouveau texte de Tom Nisse résonne de cette voix grave et fissurée dont il a le secret. Une parole poétique tendue qui rend compte des harmoniques souvent dissonantes du monde contemporain et des voix…
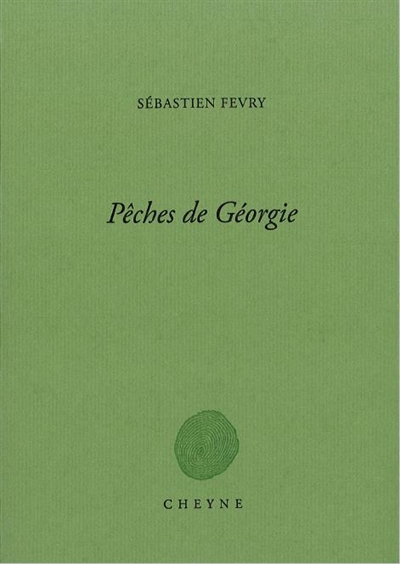
Saluée par plusieurs récompenses, dont le prix Marcel Thiry en 2021 pour Brefs déluges…
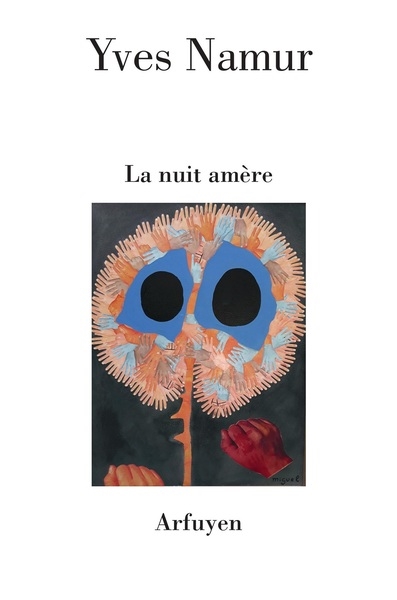
« Toutes ces traces, Les connues, les oubliées Ou les perdues Veulent-elles aussi nous porter De l’autre côté du…