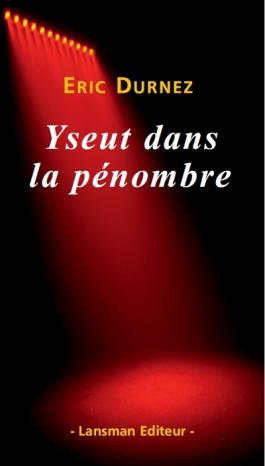
Yseut s'apprête à jouer son nouveau spectacle, réalisé à partir d'un long poème écrit par…
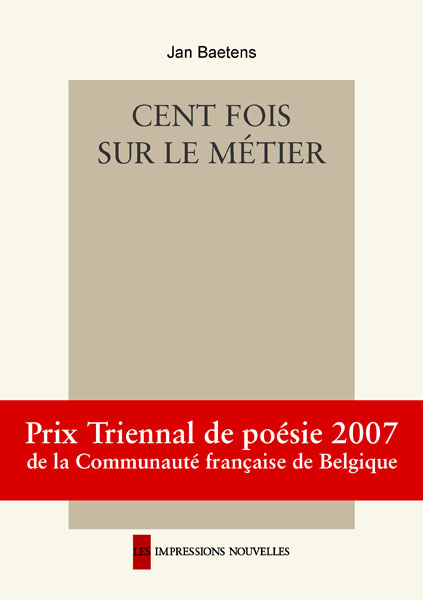
• Boileau: “Vingt fois sur le métier” (Art poétique) • Ponge: “Une rhétorique par…
Spôrts: Les tchafiaedjes do Ptit Louwis / 50.
Adon k’ on n’ sait pus cwè edvinter po diminouwer l’ CO2 et po djoker l’ restchåfmint del Daegne, les otos d’ ralî rôlnut todi e polouwant.
– Les comikes di Grene Pice eyet Ecolo s’ arindjnut po k’ èm pitite vweteure èn rôle pus dins les grandès veyes sins rovyî k’ i tapnut des takes dissu les vweteures å mazoute.
*
C’ est co todi les ptits k’ on spotche Eyet no ptit Louwis continouwer insi : « Les gros bateas (pacbots po les naivyinnes di plaijhance [croisières touristiques], et les poite-contneus mannixhnut bråmint dpus k’ nozôtes. Sins cåzer des areyoplanes et do kerozinne trop bonmartchî. Tant k’ åzès oujhenes, ele atchtêynut des droets d’ epufkiner ! Bawaite, tos les gros, on les lait fé »!
Eyet po les vweteures di ralî ? Les bastixheus d’ otos eyet l’ Federåcion djouwnut å pign-ponk e s’ dijhant k’ i fåreut prinde el vert tchimwin (come dijhnut les…
Auteur de Pign-ponk pol ralî
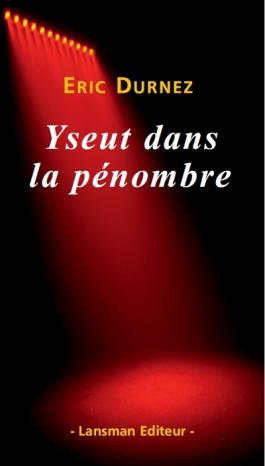
Yseut s'apprête à jouer son nouveau spectacle, réalisé à partir d'un long poème écrit par…
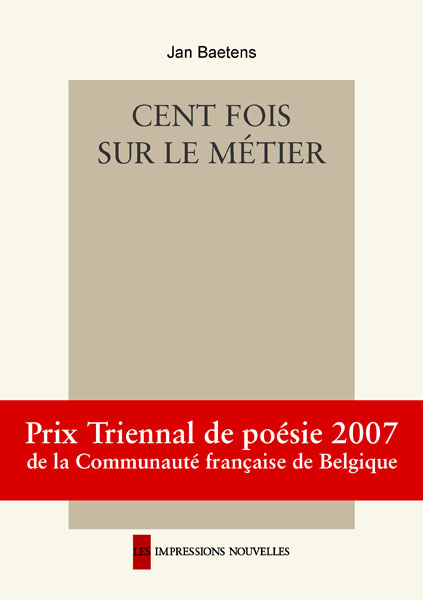
• Boileau: “Vingt fois sur le métier” (Art poétique) • Ponge: “Une rhétorique par…