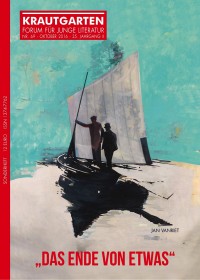
La fin de quelque chose ( Editorial )
In the old days Hortons Bay was a lumbering town. No one who lived in it was out of sound of the big saws in the…
Auteur de Marguerite Yourcenar (1903-1987)
Née le 26 février 1948, à Bruxelles, Michèle Goslar obtient le titre d’agrégée de l’enseignement secondaire inférieur en 1968. Séduite par la littérature et la linguistique françaises, malgré une formation de base de secrétariat quadrilingue, elle poursuit des études universitaires à l’ULB dans cette voie et obtient le titre de licenciée en philosophie et lettres (philologie romane) et agrégée de l’enseignement secondaire supérieur en 1973.
Son Mémoire de fin d’études portait sur la rhétorique et concernait l’analyse linguistique et stylistique de deux tropes : la métonymie et la synecdoque. Le directeur en était l’éminent professeur de linguistique et stylistique Albert Henry.
Dès 1973, elle s’engage dans une carrière de professeur qui dure 16 ans et lui permet d’enseigner à tous les niveaux : du primaire à l’universitaire, en passant par le spécial, le secondaire (tous types) et l’enseignement normal. Elle fut nommée définitivement à l’Athénée Royal de Molenbeek-St-Jean en 1984.
Quatre ans plus tard, et quelques mois après l’annonce du décès en Amérique de Marguerite Yourcenar, elle décide d’interrompre sa carrière pour se consacrer à des recherches biographiques sur l’auteur de Feux. Celles-ci lui permettent d’accumuler des documents qu’elle décide de mettre à la disposition du public en créant, à Bruxelles, le Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar. Il est créé officiellement le 16 septembre 1989 et présidé par Georges Sion, Secrétaire Perpétuel honoraire de l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises. Jacques De Decker lui succède et est l’actuel président du Cidmy.
En octobre 1990, le Centre obtient des locaux aux Archives de Bruxelles et y installe bibliothèque, vidéothèque et bureaux.
Depuis la création du C.I.D.M.Y. (dorénavant Cidmy), Michèle Goslar en assure bénévolement la permanence et en organise les activités : colloques, expositions, spectacles, conférences, visites guidées, voyages, animations scolaires...etc.
Elle a publié sur l’auteur de "Mémoires d’Hadrien", outre ses participations aux colloques internationaux, quelques livres, en plus des bulletins annuels du Cidmy, dont les principaux sont :
"Yourcenar. Biographie. « Qu’il eût été fade d’être heureux »", Bruxelles, Racine, 1998, 407p. (Epuisé), nouvelle édition revue, corrigée et augmentée à l’Age d’Homme, (février 2014) Traduit en italien et espagnol et en serbo-croate. Le livre a obtenu le prix littéraire du Cercle Gaulois en 2000.
"Marguerite Yourcenar, état civil", Bruxelles, Cidmy, 2000, 159 p.
"Le Visage secret de Marguerite Yourcenar", La Renaissance du Livre, 2001 (publication d’une conférence tenue aux Midis de la Poésie) (épuisé)
"Marguerite Yourcenar, Regards sur la Belgique", Ed. Racine, 2003 (illustré) (à l’occasion du centenaire de la naissance de l’auteur) (épuisé)
"Antinoüs, de la pierre à l’écriture de Mémoires d’Hadrien", Cidmy, 2007 (illustré) (épuisé, en cours de réédition)
"Marguerite Yourcenar en questions", Bruxelles, Cidmy, 2008, 130 p. (Réponses à des questionnaires)
"Marguerite Yourcenar. Le bris des routines", La Quinzaine littéraire/Vuitton, 2009, 322 p.
"Marguerite Yourcenar et les von Vietinghoff", Cidmy, 2012 (illustré)
"« C’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt ». Yourcenar. Aphorismes", Bruxelles, Cidmy, 2013, 109 p.
"Marguerite Yourcenar, Du Hainaut au Labyrinthe du Monde", exposition Mons 2015.
Michèle Goslar est l’auteur de l’entrée Yourcenar de la Nouvelle Biographie nationale.
En préparation :
"Réception critique de L’Œuvre au Noir", 1968-1969. (avec celle du Prix Fémina et un compte-rendu de l’adaptation cinématographique d’André Delvaux. 2017
"L’Album de Marguerite Yourcenar". 2017
Outre ces publications, Michèle Goslar a donné de nombreuses conférences sur la première académicienne, dont les plus récentes :
Les coulisses d’une élection (Saint-Jans-Cappel, 12.3.2010)
Marguerite Yourcenar et l’écologie : le combat de toute une vie (Bailleul, 17.11.2012)
Marguerite Yourcenar : écriture et philosophie (Tourette, France, 20.9. 2013)
Marguerite Yourcenar : une vie et une œuvre en dehors des sentiers battus (Fayence, 21.9. 2013)
Marguerite Yourcenar et le Japon (Bruxelles, 19.3.2014)
Marguerite Yourcenar (Cercle littéraire de Gand, 5.5.2015)
Elle organise également des visites guidées « Sur les pas de Yourcenar » à Bruxelles/Bruges (thème de L’Œuvre au Noir), au Mont-Noir (France, sur les traces de son enfance), en Hainaut et dans le namurois (la tournée des châteaux de la famille maternelle).
Prochain événement : 30e anniversaire de la disparition de Marguerite Yourcenar. Décembre 2017. Album Yourcenar, exposition à l’Atrium, journée d’étude à l’Académie, nouveau documentaire (Flagey), adaptations théâtrales (Poème 2) et soirée commémorative le 18 décembre à l’hôtel Halley de Victor Horta.
C’est à partir de 1998 que Michèle Goslar entame les recherches pour une biographie de Victor Horta, autre de ses passions.
Au cours du temps, elle élargit la recherche à l’œuvre architecturale de Victor Horta (quelque 150 réalisations, dont une trentaine de projets non réalisés et des inédits). Choquée par la destruction d’œuvres majeures de l’architecte (notamment la Maison du Peuple et l’hôtel Aubecq), elle décide d’intégrer à sa biographie le sort qui fut réservé à toutes les constructions de l’architecte jusqu’à la publication, en 2012, et qu’aucune monographie ou anthologie n’abordait jusqu’ici. Elle y cerne également la conception de l’Art Nouveau dans le chef de l’architecte gantois.
Le livre "Victor Horta. L’homme, l’architecte, l’Art Nouveau" sort au Fonds Mercator en mai 2012. 567 p et 600 illustrations. Grand livre. Il existe également en version néerlandaise : "Victor Horta. Leven, werken, Art Nouveau".
Le livre a reçu le Prix littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2015 et le Prix Arthur Merghelynck de la Classe des Arts de L’Académie royale, 2015.
Avant cette publication, elle rédige articles et monographie sur Victor Horta :
"Victor Horta, architecte de l’hôpital Brugmann. Histoire mouvementée d’une construction officielle", Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique, Tome XVI, 2005, 31 p.
"Des Amis qui firent Horta", in "Franc-maçonnerie et Beaux-Arts", La Pensée et les Hommes, n°s 62-63, 2007, 27 p.
"Hôtel Hallet, signé Horta", Bruxelles, Avant-Propos, 2011, 96 p.
Le livre a été présenté à Espace livres.be (avec Edmond Morel), à la bibliothèque des Riches Claires (Bruxelles), à l’Académie royale, Classe des Beaux-Arts (Bruxelles), à Télé Bruxelles, TV Brussel, à la RTB 1, sur Espace-Livres et lors de sa sortie, en conférence de presse, à la Rotonde du Palais des Beaux–Arts de Bruxelles.
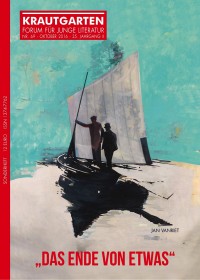
La fin de quelque chose ( Editorial )
In the old days Hortons Bay was a lumbering town. No one who lived in it was out of sound of the big saws in the…