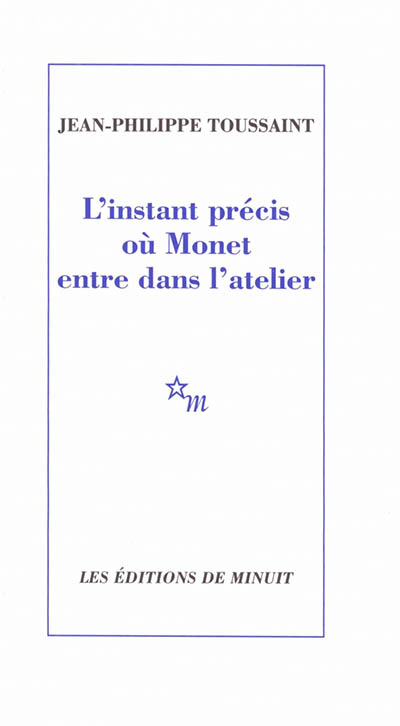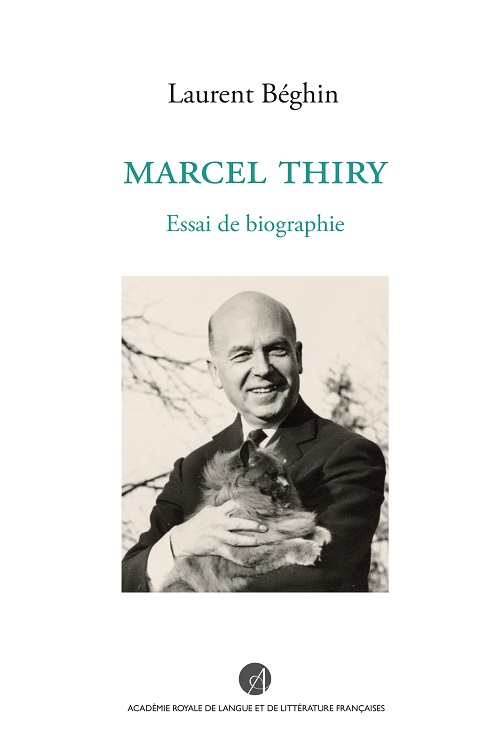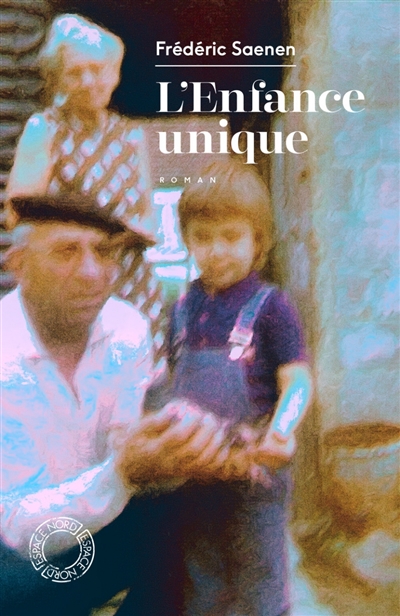Marguerite d'York ou La Duchesse Junon
À PROPOS DE L'AUTEUR
Luc Hommel
Auteur de Marguerite d'York ou La Duchesse Junon
Lucien Hommel naît à Dison le 13 juillet 1896, dans un milieu bourgeois. Il accomplit ses études chez les Frères, puis au Collège Saint-François Xavier de Verviers. C'est un élève assidu et travailleur. Il s'inscrit à l'Université de Louvain, pour y effectuer son droit, au moment où éclate la première guerre mondiale. Désireux de s'engager comme volontaire, il tente de passer les lignes, mais est arrêté par les troupes allemandes. Incarcéré à Aix-la-Chapelle, il passe seize mois en cellule. En 1917, grâce à l'intervention de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg (le père de Lucien est d'origine grand-ducale), il est libéré, mais placé en garde à vue dans un petit village, Everlange. Il en profite pour visiter la capitale du Grand-Duché à plusieurs reprises, et il écrit un récit : La Jeune Fille aux lilas, qui paraîtra dans un mensuel, la Revue luxembourgeoise. Ce texte devait être à l'origine de son mariage. Après en avoir pris connaissance, une lectrice grand-ducale voulut connaître l'auteur et épousa celui-ci peu après.
La paix revenue, Hommel obtient son diplôme de docteur en droit et entre au barreau de Bruxelles. Il est en même temps nommé commissaire aux Dommages de guerre. Attiré par la littérature, il a collaboré avant le conflit à des revues comme Le Farfadet ou La Bonne Auberge des escholiers et des poètes. En 1921, le Théâtre royal du Parc de Bruxelles joue sa pièce en un acte Le Petit Chaperon rouge (il signe maintenant Luc Hommel); suivent Le Père Serge, écrit avec Henry Soumagne et L'Amour n'est plus le maître, en 1926, pièce dans laquelle il fait œuvre de moraliste. Malgré les succès remportés, Hommel n'écrira plus pour le théâtre. En 1922 parait un ensemble de récits, La Boutique Crickboom, où il relate en une écriture fine et distinguée des souvenirs d'enfance se déroulant au pays de Verviers. En dehors d'une étude consacrée à Paul Van Zeeland, premier ministre de Belgique, parue à Paris en 1937, Luc Hommel ne livrera plus de volume à la publication avant 1944.
Sa carrière professionnelle l'absorbe complètement. En 1923, il devient secrétaire général de l'Union économique belgo-luxembourgeoise que préside Carton de Wiart. Deux ans plus tard, il est nommé chef de cabinet du ministre des Finances. Spécialisé dans les questions de droit économique, il collabore au Journal pratique du droit fiscal et financier et il y donne des articles remarqués. En 1929, il prononce le discours de rentrée à la Conférence du Jeune Barreau. Il développe dans ce texte intitulé Mesure de mon pays sa préoccupation d'une société marquée par la difficulté à se réorganiser, et il prône un État fort, sans absolutisme, qui tienne compte avant tout des droits des individus. L'influence maurrassienne y est très nette. Hommel a participé dans la même ligne à l'aventure de la fondation de deux revues. Dès 1919, il a été président de La Jeunesse nouvelle, aux côtés de Jean Teugels et de Carlo de Mey; en 1924, il est directeur-fondateur de l'hebdomadaire L'Autorité où le rejoignent entre autres Paul Struye, Étienne de la Vallée Poussin et Marcel Laloire.
En 1935, Luc Hommel, devenu maître de conférences à l'Université de Louvain, est appelé par Van Zeeland, nommé premier ministre, à occuper la fonction de chef de cabinet. C'est ce travail commun qui le poussera à écrire l'ouvrage déjà évoqué sur l'homme d'État. Pendant la seconde guerre mondiale, il subit une seconde incarcération, à la citadelle de Huy cette fois. L'occupant allemand a pris en otage des personnalités du monde intellectuel et politique. Hommel fait partie du nombre. L'emprisonnement ne dure que quelques semaines; libéré, il s'adonne à l'écriture. En 1944, paraît Chastellain 1415-1474, consacré au poète-chroniqueur de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Désormais, Hommel va s'attacher à des personnages historiques. Il travaille depuis quelques années à une importante étude qui voit le jour en 1946 : Marie de Bourgogne ou le Grand Héritage. Dans cet ouvrage, Hommel fait preuve de qualités incontestables d'historien. La documentation est précise et apporte la preuve d'une démarche rigoureuse; le souci de l'authenticité est très présent. Dans un style vivant et chaleureux, l'auteur fait revivre la jeune princesse morte à vingt-cinq ans, ainsi que l'époque où s'inscrit son tragique destin.
En 1947, Hommel confirme son nouveau talent dans l'Histoire du noble ordre de la Toison d'or, et deux ans plus tard, dans des Pages choisies de Chastellain. Il n'en continue pas moins à collaborer à diverses revues; à la Revue générale, il donne de nombreux articles dès 1925, mais sa signature figure aussi dans les sommaires du Thyrse, de la Revue nationale ou des Annales.
Il accepte en 1946 la présidence des Scriptores catholici et il est élu à l'Académie royale de langue et de littérature françaises le 30 mai 1950. L'année suivante, la compagnie le choisit comme secrétaire perpétuel pour succéder à Charles Bernard. Hommel déploie dans ses fonctions une inlassable activité. Il s'efforce d'entretenir les relations les plus étroites avec les autorités académiques d'autres pays, s'attache au lancement du Fonds national de la littérature. Soucieux du patrimoine littéraire de notre communauté, il soutient la constitution d'une association sans but lucratif, le Musée de la littérature, qui a parmi ses tâches la préservation des archives de nos lettres. C'est à son initiative que l'île de Comacina, près de Côme, léguée au roi Albert, accueille nos écrivains. Ses qualités reconnues d'historien le conduisent à travers l'Europe jusqu'au Brésil, où il donne des conférences. Il est élu membre de plusieurs académies étrangères.
En 1959, paraît Marguerite d'York ou la duchesse Junon. La vie dramatique de la veuve de Charles le Téméraire, belle-mère de Marie de Bourgogne et première éducatrice de Charles-Quint, est retracée avec ferveur dans ce dernier ouvrage de l'écrivain. Frappé d'une thrombose, Luc Hommel meurt à Bruxelles le 2 septembre 1960.