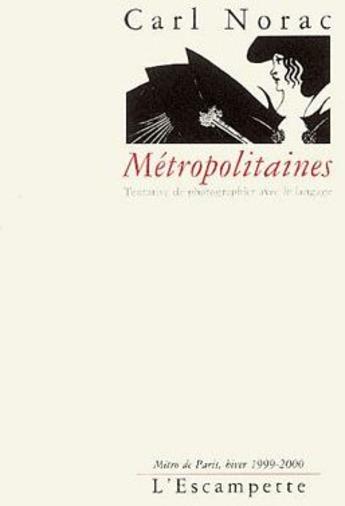
C. Norac, auteur de pièces de théâtre, poésies et contes pour enfants, offre ici une centaine de portraits de femmes…
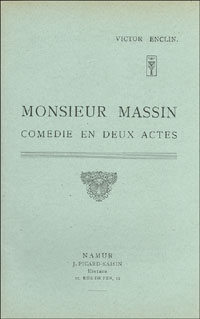
Comédie en deux actes.Cette pièce amusante au langage savoureux nous présente une petite localité ardennaise…
Reprise de « la Mélancolie des Dragons » et de « l’Effet de Serge », de Philippe Quesne, à Nanterre-Amandiers, en janvier 2018. En 2018, Nanterre-Amandiers célèbre l’anniversaire des dix ans de L’Effet de Serge (2007) et de La Mélancolie des Dragons (2008), deux spectacles pensés en diptyque, qui ont tracé les lignes de force du Vivarium Studio.
L’occasion de republier cet article paru initialement dans le #98 AT, Créer et transmettre.
* Une fois que le titre est posé, l’écriture démarre : ça a commencé avec La Démangeaison des ailes, leur premier spectacle créé en 2003, et le système s’est institué. En 2008, ils ont choisi d’évoquer La Mélancolie des dragons. Le spectacle qui vient…
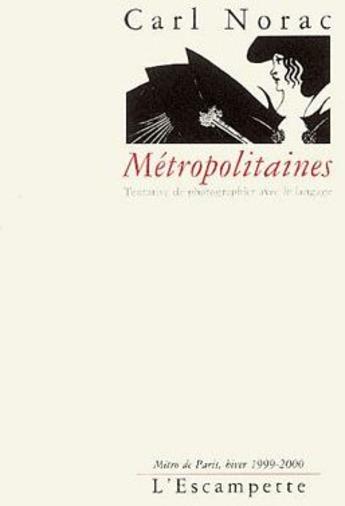
C. Norac, auteur de pièces de théâtre, poésies et contes pour enfants, offre ici une centaine de portraits de femmes…
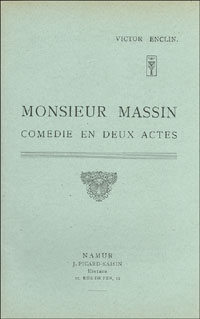
Comédie en deux actes.Cette pièce amusante au langage savoureux nous présente une petite localité ardennaise…