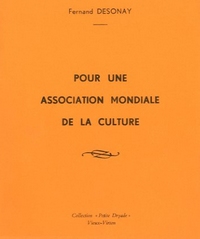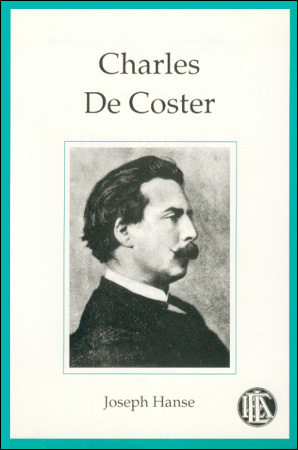
Lamartine critique de Chateaubriand dans le Cours familier de littérature
À propos du livre (4e de couverture) Les historiens contemporains des lettres françaises de Belgique tiennent avec raison que La Légende d'Ulenspiegel en est le livre fondateur. Toute fondée qu'elle soit, cette assertion a tardé à prendre forte d'évidence. Lorsque Charles De Coster fait paraître sont livre, en 1867, seuls quelques lecteurs perspicaces y prêtent attention sans parvenir à lui assurer une quelconque reconnaissance. Et c'est aussi pauvre qu'inconnu que l'écrivain meurt en 1879. Il est vrai que «La Jeune Belgique», quinze ans plus tard, reconnaît son rôle, mais le statut de son livre n'en est en rien changé : il a peu de lecteurs, il n'est pas pris au sérieux. Tel n'est pas le cas du jeune Joseph Hanse dont l'Académie royale de langue et de littérature françaises s'empresse, dès 1928, de publier la thèse de doctorat consacrée à Charles De Coster et dont Raymond Trousson écrit aujourd'hui dans sa préface : «Ce coup d'essai était un coup de maître. Soixante-deux ans après sa publication, ce livre demeure fondamental, indispensable à quiconque entreprend d'aborder l'uvre magistrale qu'il mettait en pleine lumière.» Devenu introuvable, enfin réédité aujourd'hui, le Charles De Coster de Joseph Hanse, qui a ouvert la voie à toutes les études ultérieures et internationales sur le sujet, fera figure, pour beaucoup, d'une découverte et d'une…
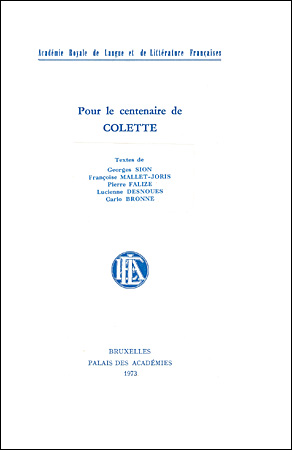
Textes de Georges Sion , Françoise Mallet-Joris , Pierre Falize, Lucienne Desnoues et Carlo Bronne À propos du livre (Texte de l'Introduction) Il était normal que l'Académie veuille…