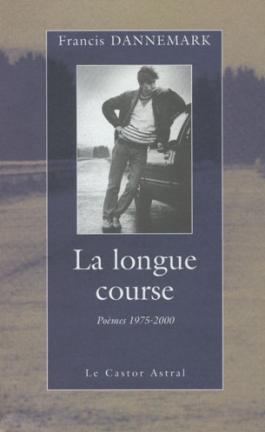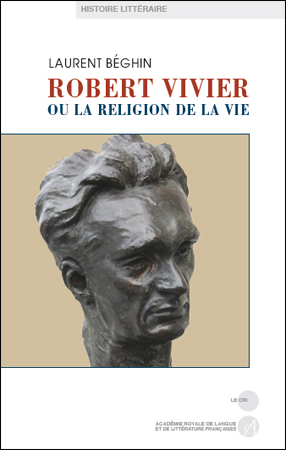Apéro Poésie Nomade – Congo Eza & Manza, Leila Duquaine et Lisette Ma Neza
Nous avons souhaité parsemer l’année de paroles de créateurs, en lien avec la programmation des Midis de la Poésie. Deuxième étape avec Joëlle Sambi, autrice, poétesse, activiste qui, en trio avec Congo Eza, interroge son lien-frontière au Congo et à la Belgique et propose avec Aru Lee pour les Midis une sélection de textes des voix emblématiques de l’afroféminisme : Maya Angelou, Angela Davis, Audre Lorde, etc.
Nous avons souhaité parsemer l’année de paroles de créateurs, en lien avec la programmation des Midis de la Poésie. Deuxième étape avec Joëlle Sambi, autrice, poétesse, activiste qui, en trio avec Congo Eza, interroge son lien-frontière au Congo et à la Belgique et propose avec Aru Lee pour les Midis une sélection de textes des voix emblématiques de l’afroféminisme : Maya Angelou, Angela Davis, Audre Lorde, etc.
Ton engagement ou ta pratique d’écriture, lequel a surgi en premier ?
Joëlle Sambi : Je ne me suis pas tout de suite définie comme écrivaine. Par contre, vers l’âge de douze ans, je rédigeais déjà plein de poèmes. J’avais ce qu’au Congo on appelle des « cahiers de plaisir », qu’on s’échange entre copines, on y note des petits mots, on y dessine. C’était avant même d’avoir conscience de ce que j’écrivais ou de la portée politique que pouvait avoir l’acte d’écriture. Mais très jeune, dans le choix de mes études, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Faire le droit c’était quelque chose d’hyper-noble, la défense du faible. Finalement je n’ai pas choisi cette voie mais la communication : peut-être que le droit représentait aussi pour moi des textes de lois, des règles, quelque chose d’assez cadenassé ou enfermant dans lequel je ne me voyais pas évoluer. J’avais besoin de la liberté, d’une certaine créativité libérée que je peux avoir en écrivant, et c’était assez compatible avec le travail de communicant ou même de journaliste.
Dans Sister Outsider, Audre Lorde rappelle : « Pour les femmes cependant, la poésie n’est pas un luxe : c’est une nécessité vitale. » À quel moment t’es-tu rendu compte de la portée que pouvait avoir le fait d’écrire ?
J.S. : Je ne connaissais pas Audre Lorde à l’époque, et je ne me rendais sans doute pas compte au départ de cette « nécessité vitale ». Ce qui est sûr, c’est que je me rappelle très bien d’une phrase que j’ai écrite très jeune : « L’écriture c’est ma drogue et je mourrai certainement d’une overdose ». Écrire a toujours été une manière pour moi de mettre le monde à distance, de questionner les violences qui l’habitent mais aussi à mesure que je plonge dans les luttes féministes, de les dénoncer. Ecrire c’est aussi un onguent. La poésie n’est pas un luxe, c’est une manière d’affirmer ma place de femme noire lesbienne dans une société qui pense pouvoir me maintenir au bas de l’échelle. Après, je suis extrêmement consciente de ma position, de mes privilèges. Je m’étais dit très jeune que je voulais publier – ça avait peut-être quelque chose d’égocentrique, cette envie d’objet et de laisser une trace. Il n’y a pas, dans mon parcours, de moment précis où je me suis rendu compte de la portée de mes écrits, d’ailleurs, je ne sais pas trop ce que cela signifie. Ce qui est certain c’est que parfois les mots voyagent, ils touchent, résonnent d’une certaine manière et permettent les rencontres. Si les feuilles que nous noircissons, si l’air que nous remplissons de nos voix en slam ont cette portée alors non, ce n’est pas du luxe.

Dans ce même passage, Audre Lorde dit aussi : « La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. »
J.S. : Cela le rend envisageable et j’ai presque envie de dire, universel. Pour Axelle Magazine, on nous a demandé d’écrire un petit texte sur une auteure qui aborde des questions de racisme. Très vite, j’ai pensé à Audre Lorde ou à des auteures qui sont plutôt connues. Mais j’avais envie d’aller chercher ailleurs et en creusant, j’ai repensé à Warsan Shire, qui a des parents somaliens, est née au Kenya, et qui vit en Grande-Bretagne. Elle a écrit un recueil qui s’appelle Teaching My Mom To Give Birth. Dedans, il y a un poème, Conversations about Home (At the deportation center), où elle parle des préjudices qu’elle rencontre en tant que femme noire en Grande-Bretagne. En lisant un peu sa biographie, on se rend compte qu’elle est arrivée là-bas à 2 ans, que la Somalie ou le Kenya ne sont pas des réalités qu’elle a vraiment vécu de l’intérieur, mais l’expérience dont elle parle dans ce poème-là en particulier, je m’y retrouve. C’est fou combien les mots parlent de nos expériences à tous. La poésie, on en met les fragments les uns à côté des autres et puis ça retentit d’une certaine façon – il y a mille façons, mais l’important est là : dans la résonance.
Dans un entretien à propos de ton roman Le monde est gueule de chèvre, tu précisais : « Je pense qu’il est important de rester en colère ». Comment envisages-tu cette imbrication entre l’écriture et ce sentiment ?
J.S. : C’est drôle, cette discussion date déjà un peu et du coup, je me demande à quel point ça a évolué. Pour moi, la colère, c’est le moteur et l’essence. Je ne sais pas si elle a mûri, mais elle se traduit autrement. Au moment où j’ai écrit le roman, j’étais très en colère, mais elle était presqu’en surface. Récemment, il y a eu la Reclaim The Night à Bruxelles, avec l’attaque de la police de 1000 Bruxelles qui m’a mise hors de moi. Suite à ça, j’ai pondu un texte à chaud que je n’aurais pas écrit autrement. Attention, je n’ai pas besoin de me faire taper dessus pour être dans cette disposition. Mais je sais que le jour où j’arrêterai d’être en colère, j’arrêterai d’écrire. Je sais qu’elle me nourrit, que c’est une compagne. On dit toujours qu’elle est mauvaise conseillère : je veux bien le croire. Il n’empêche qu’elle est là. C’est un peu comme quand tu regardes ces dessins animés où tu as d’un côté le diable et de l’autre côté l’ange et je ne sais pas dans quel pôle ma colère se situe, mais en tout cas, elle est perchée sur mon épaule.

D’où vient le nom du trio collectif Congo Eza ?
J.S. : C’est un projet initié par Rosa Gasquet, metteur en scène, qui travaille avec Lézarts Urbains. Je l’ai rencontrée l’année dernière pour Décolonie Apostasie, un projet où je montais sur scène à Bozar avec les étudiants de l’Ecole de Recherche Graphique de Bruxelles qui organisait son séminaire annuel . Rosa m’a coachée, elle m’a appris à dire mes poèmes sur scène, elle a ouvert les portes du slam et c’est encore un dévoilement autre que sa propre écriture. Un des poèmes que j’ai dit lors de cette restitution d’atelier s’appelle Congo Eza. Ça veut dire « Le Congo existe ». C’était une évidence, un poème où je dis que le Congo est un pays, et qu’on a tendance parfois à l’oublier. La Belgique aussi d’ailleurs est un pays, mais elle flotte au-dessus de la réalité, tandis que le Congo est une diaspora... en colère, encore la colère. Ce poème est toute une déclinaison de ce qu’est le Congo dans mon œil. Rosa avait par ailleurs déjà accompagné Lisette Lombe, une slameuse liégeoise et Badi, un rappeur bruxellois. Ça faisait trois univers, trois voix qu’elle avait envie de voir sur scène, avec des textes qui ont des résonances. De là est née l’idée de faire ce collectif et tout naturellement de l’appeler Congo Eza, puisqu’on est tous les trois d’origine congolaise, avec tout ce que ça implique de tiraillements. Le spectacle dure 40-45 minutes, et parle de ce que j’ai pour l’habitude d’appeler « cette position confortablement installée le cul entre deux chaises ». De ce rapport d’amour-haine, la Belgique, le Congo.
On sent que la multiplicité d’identités est une thématique importante dans ton travail… Ç Ça me fait penser que beaucoup d’afro-féministes historiques ou actuelles – comme Audre Lorde ou la réalisatrice Amandine Gay – se définissent toujours en avant-propos. Est-ce important de pouvoir soi-même s’attribuer des étiquettes qui nous conviennent, qu’on revendique ?
J.S. : Oui, à titre personnel, ça l’est. De plus ou moins savoir qui on est, comment on se définit. Audre Lorde faisait ça avant ses prestations publiques : je suis une femme noire, poétesse, lesbienne, mère de deux enfants, etc. Je trouve ça assez puissant même si moi je n’en éprouve pas nécessairement le besoin de l’exprimer sur scène ou en introduction. Il m’arrive de le préciser dans mes discussions par contre, c’est important. Je me définis comme une lesbienne noire, parce qu’aux yeux de certains, les lesbiennes n’existent pas, les femmes noires ne sont pas tout à fait des êtres comme les autres. Affirmer la multiplicité de son identité, c’est aussi une manière d'esquiver les clichés. Nous sommes des mille-feuilles. Il faut montrer nos intersections pas nécessairement visibles au premier coup d’oeil, parce qu’elles amènent, provoquent forcément quelque chose, et tant mieux.
Je souhaitais entendre ton point de vue sur une initiative récente, « Les afro-belges décolonisent les musées royaux. »
J.S. : Cela me semble important que les musées revoient la manière dont ils présentent l’histoire. Je repense à une exposition qui a eu lieu à Bozar, sur les peintres populaires congolais. Le sujet me semblait porteur, c’est une forme d’art qui brasse des décennies. Mais en arrivant au musée, les toiles étaient encaquées dans des couloirs sans suffisamment de recul par rapport aux tableaux. Les oeuvres étaient finalement peu mise en valeur. À un endroit de l’exposition, il y a les peintures populaires sur les dictatures. La seule légende qu’on pouvait lire c’était : « Au Congo, il y a des dictatures, Mobutu […] ». Quelque chose de très congolo-congolais, sans aucune perspective historique. Je ne me demande pas à ce que les gens s’auto-flagellent, mais il y a tout de même un minimum d’objectivité à avoir. C’en était presque gênant, et pas pour les visiteurs… Aucune lumière sur la responsabilité belge, aucune mise en contexte historique, etc. Je trouve que là, effectivement, il y a lieu de décoloniser les musées. Ça devrait d’ailleurs aller au-delà : s’interroger sur les cours d’histoire, etc.

Passons à ton second projet avec les Midis de la Poésie, Tu devras te souvenir de cela quand on t’accusera de destruction… Un titre avec un poids tout sauf anodin !
J.S. : C’est un projet sur lequel je travaille avec une jeune poétesse, Aurélie Disasi dont le nom de scène est Aru Lee. Pour le titre, c’est une phrase que j’ai lue dans un poème mais je n’arrive pas à me souvenir lequel. À chaque fois qu’on réprime notre parole, qu’on nous accuse de destruction, qu’on dit de nous que nous sommes hystériques, ou que nous tombons dans l’exagération parce que nous avons le malheur de parler fort, ou de taper du poing sur la table, il convient de se remémorer de quoi parlent les femmes ? De l’oppression, d’un système qui ne tient pas compte d’elles, elles évoquent la nécessité de se libérer des carcans – on doit se souvenir de ce qui était juste dans notre cause en amont et de ce qui l’est aussi dans notre façon de l’exprimer. On va certes parler de Maya Angelou, Angela Davis et Audre Lorde qui sont des auteures plus connues mais aussi d’autres voix afro-européennes, africaines qui écrivent de la poésie, dont la colère est légitime et intéressante. On n’intégrera peut-être pas ce que j’écris mais en tout cas bien un ou deux textes d’Aru. Dans cette sororité qu’on essaie de construire, je trouve que c’est important d’avoir aussi le point de vue des plus jeunes. C’est à nouveau une femme noire, queer, etc. mais qui va avoir une parole qui sera différente de la mienne. Elle va l’envisager par une autre porte ou fenêtre.
On résume souvent le black feminism aux grandes théoriciennes des années 60 ou 70 déjà mentionnées : Angela Davis, Maya Angelou, Audre Lorde et je pourrais ajouter bell hooks. Qu’en est-il aujourd’hui ? Notamment en France, pas mal d’initiatives pionnières ont été oubliées.
J.S. : Je pense qu’il y a des figures qui émergent : tu parlais tout à l’heure d’Amandine Gay, elle en fait clairement partie. Ici, ça a été assez compliqué en préparant, en cherchant simplement des auteures féministes africaines. On va parler d’Aminata Sow Fall, de Marie-Gisèle Aka qui a écrit un livre sur la relation presqu’incestueuse entre un père et sa fille. On en revient à ce qu’on disait : il y a très peu de livres, de matière, une mauvaise distribution et c’est difficile de trouver. Par contre, et c’est tout un univers qui s’ouvre, il y a beaucoup de plus jeunes qui sont d’origine africaine et qui vivent en Europe et sont actives. Et en Afrique du Sud, c’est également tout un monde à part : là, il y a énormément d’auteures et de choses qui se font, pas rien que dans l’écriture d’ailleurs. Zanele Muholi, notamment. Je pense aussi à Upile Chisala, à la fois du Malawi et d’Afrique du Sud, qui a écrit un poème assez incroyable qui s’appelle ABC et qui est un peu l’abécédaire des oppressions. Il y a sans doute encore beaucoup d’autres auteures contemporaines qui ont de l’intérêt. Mais effectivement, ma « nourriture » ça sera plutôt Audre Lorde ou des théoriciennes afro-américaines plus contemporaines.

Tu dis que ce n’est pas toujours évident de se documenter et d’avoir accès à certains textes… Même chez les figures d’envergure, on peut remarquer qu’Audre Lorde est publiée dans une petite maison, que bell hooks, dont les textes majeurs datent des années 80, n’a été traduite en français qu’il n’y a qu’un ou deux ans. Est-ce qu’il y a encore du travail de terrain qui devrait se faire sur cette diffusion des œuvres ?
J.S. : Je pense qu’au niveau du terrain, des textes comme ceux de bell hooks circulaient, avant même qu’ils soient édités, publiés et diffusés plus largement. Mais c’était sans doute dans des cercles vraiment restreints et déjà avertis. Le genre de publication qu’on peut se passer en .pdf. Mais c’est surtout une raison économique qui fait que peu de publications sur le sujet trouvent place dans le paysage éditorial : quel serait l’intérêt pour une grosse maison d’édition à traduire Audre Lorde ? Si on prend le cas de Maya Angelou, ses romans sont traduits, mais ses poèmes qui sont d’une puissance incroyable, on ne les trouve pas. Là où il y a une place à prendre, c’est en créant nos propres structures, maisons d’édition, circuits, etc. Pas pour faire un entre-soi, mais pour sortir de l’anonymat.
Tu as utilisé le terme « sororité » plusieurs fois au cours de la conversation… Il me semble important dans vos démarches multiples.
J.S. : Pour moi il est essentiel parce qu’il représente la construction et la famille. Je suis née à Bruxelles, mais j’ai grandi à Kinshasa, mon père et ma mère sont toujours là-bas. Ici, j’ai des cousines, des tantes, etc. Le sang ne fait pas la famille ou ne suffit pas à la faire. Mon quotidien et ma vie est à Bruxelles, mon quotidien, ce sont ses sœurs-là, avec lesquelles on fait des projets. Dans nos démarches – celle d’Aru, celle des Warrior Poets avec Gia Abrassart, celle de Recognition avec Sacha Lyse Ishimwe – dans nos compétences respectives, on se questionne sur comment s’entraider. Comment créer des filets, finalement. Pour ne pas être seules, pour se renforcer, pour partager nos expériences. On est dans la dénonciation, dans la revendication mais à un niveau plus familial, on peut déconstruire. En tant que femme, en tant que femme queer, en tant que femme queer noire, quelles sont les voies qui nous sont tracées ? Est-ce que cette voie nous convient ou pas ? Comment est-ce que je peux la confronter ? Expérimenter d’autres choses par essai-erreur ? S’entourer de la bienveillance de ces sœurs-là est essentiel pour ce travail. On parle très peu de la santé mentale des femmes dans nos communautés afro. Le Noir ne va jamais chez le psy : c’est ta famille qui joue ce rôle. Quand on arrive en Belgique en venant d’ailleurs, comment ne pas rester seule et maintenir un cap fort et solide ?

Audre Lorde a fait tomber le « y » de son prénom et à la fin de sa vie se choisit le nom de Gamba Adisa (« Guerrière : celle qui se fait comprendre ») ; bell hooks choisit que son nom s’écrive en minuscules. Toi-même, suivant les cas, on t’appelle Joëlle Sambi ou Joëlle Sambi Nzemba. Doit-on se libérer du langage et en quoi est-ce que le langage peut-être une libération ?
J.S. : Joëlle Sambi est plus court et c’est mon nom artistique. Ma mère m’a d’ailleurs déjà demandé pourquoi je n’utilisais pas Nzemba, qui est le nom de ma grand-mère. Je suis africaine, j’ai un autre rapport qu’Audre Lorde ou bell hooks à l’esclavage et au fait de se rebaptiser. Mon nom, je n’en changerais pas : je sais ce qu’il signifie, d’où il vient. Mais là où la libération peut intervenir pour moi, c’est dans la manière dont je vais mélanger la langue, faire chanter le français. Au point que ceux qui le liront, et qui parlent le lingala, se disent : « tiens, là, c’est du français en lingala ». La figure de l’assimilé – celui qui a fait des études, parle très bien français – c’est une image qui reste prégnante. Au départ, on parlait exclusivement français avec ma mère, c’était ce qui était jugé correct, posé, etc. C’était surtout un rapport de classe qui était très fort dans ce premier choix. Maintenant, je parle lingala, avec elle. Plus j’ai avancé dans l’écriture, plus il était indispensable de retourner à cette autre langue, d’en connaître le sens, d’aller trouver ce qui chante dans cette langue-là, maternelle au même titre que le français. C’est important pour moi de travestir la langue française, peut-être pour me défaire de cette image d’ « évoluée ». Ça me rappelle à l’humilité, à la nécessité de ne pas oublier d’où je viens et à être accessible un maximum. De là à dire que j’écrirai un jour en lingala, ça n’est certainement pas vrai. Mais peut-être créer un nouveau langage ou une nouvelle façon ?