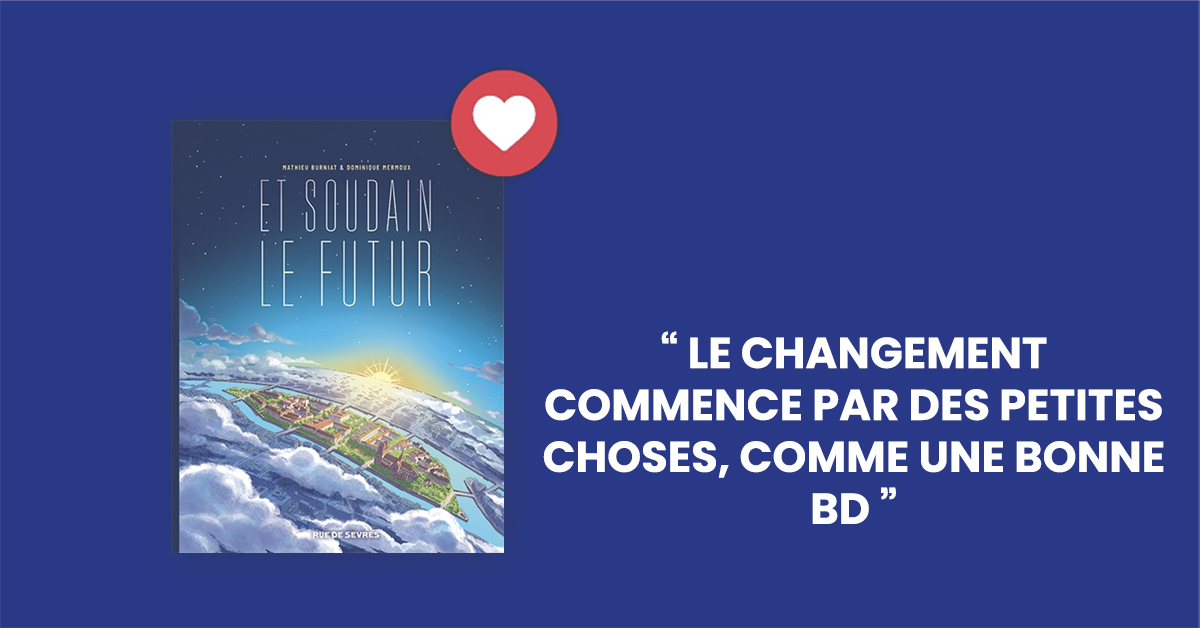
Notre critique de Et soudain le futur
Parfois les réseaux sociaux ont du bon. C’est en tout cas une vidéo TikTok qui est le déclencheur de l’histoire dans « Et soudain le futur » de Mathieu Burniat et Dominique Mermoux.
Mathieu Burniat revient et je dois dire que j’en suis ravi. Celui qu’on avait fortement apprécié pour Furieuse, une relecture féministe des contes du Graal, passe cette fois-ci de la fantasy à la science-fiction. Dans le scénario qu’il propose point de vaisseaux spatiaux ou de robots vengeurs, mais une fiction politique prospective. Suite à une vidéo qui annonce le bouleversement de la biodiversité et qui est partagée par des milliers de personnes, le monde politique ne peut rester muet. Le gouvernement annonce donc un projet pilote. L’Île de la Cité, en plein cœur de la capitale française, sera privée de liens avec l’extérieur pour expérimenter un modèle de vie décroissant. Tout un programme !
Ainsi une partie de la population représentative de la société est isolée sur la portion du territoire français pour tester un mode de vie alternatif, qui, si c’est un succès, sera développé à l’échelle nationale. Mais pour être représentatif de la population, et au bout de plus de 5 ans d’expérience, on constate qu’il manque au panel une personne incarcérée. Mila Weber, une jeune femme, est donc choisie pour intégrer la communauté qui s’est déjà organisée durant plusieurs années. Elle rejoint l’île et est immédiatement mise dans le bain par Carl, un auteur de bande dessinée présent pour documenter l’expérience.
La tentative de société décroissante n’est cependant pas totalement déconnectée de la réalité. En effet, les téléphones sont toujours en usage, ainsi que les télévisions. L’idéal n’est pas de supprimer toute présence technologique, mais de contrer la volonté de croissance exponentielle. Néanmoins, si toute la population est représentée dans cette microsociété, cela implique que des personnes qui sont naturellement réfractaires à la décroissance en fasse partie. En effet, les cornucopiens font tout pour lutter contre la décroissance. Cette tendance croit en la corne d’abondance, c’est-à-dire que le monde peut fournir tout ce que l’humain désire. Ils croient aussi en la théorie d’une croissance verte, qui affirme que l’écologie est compatible avec un développement économique et qu’il suffirait de quelques aménagements mineurs pour rendre cela soutenable sur le long terme.
La société coupée du monde s’essaye donc à d’autres manières de faire collectif. Pour décider les orientations du groupe des assemblées générales sont organisées dans la Cathédrale Notre-Dame, une monnaie locale est d’usage, les potagers sont collectifs et partagés. Les légumes collectés sont lactofermentés pour être conservés ou sont cuits dans des fours solaires avant d’être dégustés dans des cantines collectives. Mais tout n’est pas possible quand on est isolé du monde et des échanges doivent tout de même continuer.
Carl présente à Mila le quotidien de cette société décroissante et, peu à peu, il la convainc de devenir une défenseuse de leur cause commune.
Avec cette science-fiction douce et toutes les pistes de réflexions qu’il nous présente, Mathieu Burniat, et son comparse dessinateur Dominique Mermoux, nous font rêver à des mondes possibles. Le futur désirable, comme ils le présentent, doit se construire sur des modèles théoriques et être proposé dans la joie. La révolution douce peut advenir en repensant nos modes de consommation, de décisions politiques et notre rapport à la possession.
Loin du concept éthéré, le scénariste présente une recherche dense et un bagage théorique solide, dans une bande dessinée très agréable où vulgarisation et légèreté font bon ménage.
Nous ne pouvons que recommander vivement cette lecture car le changement commence par des petites choses, comme une bonne BD.
Clément Fourrey