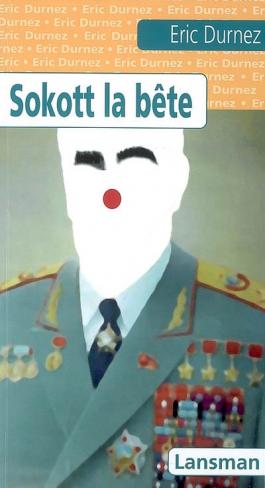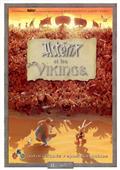Autrice de Souvenirs
Marie Closset est née à Bruxelles en 1873. Au décès de son père, tailleur de profession, elle est envoyée à Mons chez sa grand-mère et sa tante maternelles qui dirigent une école et un pensionnat pour filles. Elle y séjournera jusqu’à ses dix-huit ans. Elle suivra ensuite une formation pour devenir enseignante dans l’établissement qu’a créé à Bruxelles la féministe Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905).Par l’entremise de son amie Blanche Rousseau (1875-1949), rencontrée sur les bancs de l’école Gatti, elle fréquente les milieux anarchistes et devient une proche collaboratrice d’Élisée Reclus (1830-1905). En exil à Bruxelles, Reclus est un habitué du salon de l’oncle et de la tante de Blanche (Ernest Rousseau et Mariette Hannon). Marie Closset deviendra l’assistante de Reclus et participera, avec Blanche Rousseau, à la création de l’École libre des Petites Études, un pendant de l’Institut des Hautes Études destiné aux enfants d’ouvriers. Cette opportunité permettra aux deux jeunes femmes d’expérimenter des conceptions pédagogiques innovantes qui rappellent leur formation à l’école Gatti.Marie Closset publie ses premiers vers en 1895 dans la revue l’Art Jeune. C’est le peintre néo-impressionniste Théo Van Rysselberghe (1862-1926) qui veille à faire connaître son œuvre poétique en intervenant personnellement auprès d’Émile Verhaeren pour qu’un premier recueil soit publié au Mercure de France. De 1903 à 1912, quatre recueils sortent des presses du Mercure : La Gaule blanche (1903), L’Anémone des mers (1906), L’Aile mouillée (1909) et Le Puit d’azure (1912). Ce choix éditorial témoigne d’une volonté de légitimer son statut de poète en s’inscrivant au cœur de l’esthétique symboliste, et en recherchant, à l’instar de ses confrères, la reconnaissance parisienne. Marie Closset choisit également de publier sous le pseudonyme de Jean Dominique, marquant sa volonté d’échapper à une réception genrée de ses œuvres. En atteste aussi l’écriture au masculin de ses deux premiers recueils. Sa poésie ne se démarque cependant pas totalement de la littérature féminine telle qu’elle se développe au tournant du siècle. Les liens intimes qui s’y tissent avec la nature renvoient ainsi à une veine exploitée par Francis Jammes (1868-1938) ou encore André Gide (1869-1951), et qu’illustreront plusieurs autrices, dont Anna de Noailles (1876-1933).Dès ses débuts en poésie, Marie Closset se fait également connaitre dans les milieux avant-gardistes qui gravitent autour de la revue L’Art Moderne. Invitée régulière des Salons de la Libre Esthétique, elle s’y impose à la fois comme poète et théoricienne. Plusieurs de ses poèmes seront interprétés lors des concerts de la Libre Esthétique, dont son poème, Le Don silencieux, mis en musique par Gabriel Fauré (1845-1924). Sa conférence « De la tradition et de l’indépendance » (1903) lui permet également de participer au grand débat qui anime les Salons, à savoir la rupture avec le passé et la volonté de renouveler l’art, dans toutes ses manifestations. Elle y exprime sa conception d’une poésie que seule doit guider l’inspiration et le désir de créer : « Qu’un vers soit régulier ou non, qu’un poème s’écrive dans un rythme connu ou bien d’une nouvelle et inattendue prosodie, ce sont là des détails. »La poésie de Jean Dominique se déploie donc bien au-delà de ses recueils, d’abord dans un geste d’autocréation qui prend pour principal décor sa « Chambre bleue » et auquel fait écho son Éloge de la poésie (1929) : « La poésie est avant tout une manière d’être et, seulement ensuite, une façon d’écrire ». À la fois refuge de la création et espace de rencontres, la « Chambre bleue » de Jean Dominique s’impose ainsi comme un espace scénique où l’archétype de la salonnière est nuancé, désinvesti de sa dimension strictement mondaine, pour véritablement mettre en scène une poésie incarnée. En 1904, aux cimaises du Salon de la Libre Esthétique, le tableau La Promenade de Théo Van Rysselberghe offre un portrait de l’autrice qui reflète toute l’intensité de cette aura poétique. Avec Blanche Rousseau, et une amie commune (Marie Gaspar), Marie Closset a créé une société artistique et littéraire secrète (les Peacocks) que fréquenteront Théo Van Rysselberghe et son épouse, ainsi que plusieurs autres artistes, écrivains et amateurs d’art (Octave et Madeleine Maus, Jules Delacre et son épouse la cantatrice Marie-Anne Weber, les écrivains Arnold Goffin et Francis de Miomandre, ou encore bien plus tard l’écrivaine américaine May Sarton). Sa place à l’avant-plan du tableau de Van Rysselberghe, l’intensité de son regard, tout comme la précision de ses traits qui contraste avec les trois autres silhouettes féminines, indiquent bien l’intention de l’artiste : peindre un portrait de Jean Dominique. Mais avec sa démarche de profil, les tissus colorés qui agrémentent sa robe claire et les voiles de sa coiffe que le vent agite comme une traîne, c’est bien sous les traits d’un paon que Van Rysselberghe a choisi de représenter Jean Dominique.
L’essoufflement de l’esthétique symboliste après la Grande guerre semble marquer le déclin de la carrière poétique de Jean Dominique. Durant l’entre-deux- guerres, elle ne publiera en effet plus que deux recueils (Le Vent du Soir, en 1922, et Sable sans fleurs, en 1925), puis essentiellement des essais, des hommages à plusieurs femmes écrivains ainsi que deux récits autobiographiques (Une Syllabe d’oiseau en 1926 et Souvenirs qui paraitra posthume en 1953). Ces derniers participent cependant pleinement de son travail poétique. Oscillant sans cesse entre récit de soi et autofiction, le biographique y devient matière poétique… invitant du même coup à relire ses poèmes en miroir.