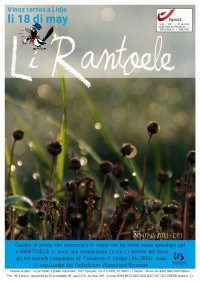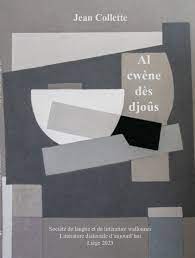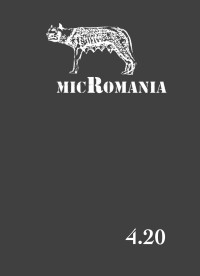Auteur de Pa-drî l's-uréyes
Jean Guillaume nait à Fosse-la-ville en 1918, au sein d’une famille paysanne, dont le père est fermier et marchand de chevaux. Après des humanités gréco-latines au Collège Saint-Paul de Godinne-sur-Meuse, il entre au noviciat des Jésuites, à Arlon, en 1937. Il entreprend des candidatures en Philologie classique et en Philologie romane aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et est diplômé en 1945. La même année, il rejoint la société littéraire Lès Rèlîs namurwès. En 1948, il obtient sa licence en romanes à l’Université de Liège avant de faire sa Philosophie et sa Théologie à l’Université catholique de Louvain. Il est ordonné prêtre le 15 aout 1951. En 1954, toujours à l’Université catholique de Louvain, il termine une thèse de doctorat consacrée à La Chanson d’Ève de Charles Van Lerberghe. À partir de cette même année et jusqu’à 1984, il enseigne la littérature aux FUNDP de Namur. Il décède en 2001, à Namur.
Sa carrière académique s’est orientée autour de deux axes. D’une part, son intérêt porte sur la littérature française, et en particulier sur l’œuvre de Gérard de Nerval. En 1977, il crée ainsi le Centre de recherche NERVAL aux FUNDP, tandis que de 1984 à 1993, il réalise, avec Claude Pichois et Jacques Bony, l’édition des Œuvres complètes de Nerval dans la prestigieuse collection de La Pléiade (Gallimard). D’autre part, il fait découvrir les lettres wallonnes à ses étudiants et s’attache à l’édition critique de plusieurs auteurs wallons (Georges Willame, Michel Renard, Franz Dewandelaer), ainsi qu’à la réalisation de profils de poètes wallons (Jules Claskin, Gabrielle Bernard, Willy Bal, Émile Gilliard, Louis Remacle, Georges Smal, etc.), qui constituent La poésie wallonne, en 1984.
Enfin, en tant qu’auteur wallon, avec notamment Willy Bal, Louis Remacle et Albert Maquet, il est l’une des figures importantes de la génération d’auteurs wallons s’illustrant au sortir de la deuxième guerre mondiale. En 1947, il propose son premier recueil de poésie wallonne : Djusqu’au solia. En 1948, il participe au recueil collectif Poèmes wallons. Au tournant des années cinquante, il publie trois recueils de poésies supplémentaires : Inte li vesprèye èt l’ gnût (1948), Grègnes d’awous’ (1949) et Aurzîye (1951). Ces recueils ont par ailleurs été rassemblés plus tard, dan Œuvres poétiques wallonnes (1989), sous l’égide de la Société de Langue et de Littérature Wallonnes et des Rèlis Namurwès. Deux recueils non publiés, Tchaudès cindes et Tot ç’ qui flame, sont en outre mentionnés dans le Bulletin de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises. Le premier est daté de 1950 et a valu à l’auteur le Prix du Brabant, le second n’est pas daté.
Après la mi-siècle, Jean Guillaume, pris par ses travaux sur Van Lerberghe puis Nerval, n’écrit plus en wallon, si ce ne sont quelques poèmes, publiés notamment dans les Cahiers wallons (Lès Rèlîs Namurwès). Son dernier poème est daté de « 2000, blanc’ sèm’di », soit le samedi saint de 2000, c’est-à-dire le 22 avril 2000. Ces écrits plus tardifs feront l’objet d’une édition posthume : Pa-drî l's-uréyes (2001, puis 2012), dont une partie était cependant déjà rédigée dès 1953. En 2007, son œuvre prend la forme d’archives sonores, sous la forme de 3 CD accompagnés d’un livret.
L’essentiel de son œuvre poétique, produite en un laps de temps assez court, correspond à une période qui a sans doute représenté un tournant dans sa vie : il termine ses études, s’apprête à être ordonné prêtre, le devient…. Son œuvre peut sans doute être lue à cette lumière. Quoi qu’il en soit, les thématiques privilégiées de l’œuvre du père Guillaume sont le souvenir des parents et de l’enfance, la terre (en accord avec ses origines paysannes), les préoccupations sociales pour les simples gens et leurs souffrances, la référence à la guerre (qui vient à peine de se terminer) et l’inspiration religieuse, visible dès le liminaire de son premier recueil : « C’èst vos, mon Diè, qui mès simpès thansons / voûrin.n’ mostrer tot-au d’dilong di m’ voûye… »
Ses écrits lui auront valu plusieurs prix : le prix Biennal de la Ville de Liège (1949), le prix de la province du Brabant (1950) et le prix triennal de littérature wallonne du Gouvernement (1952).