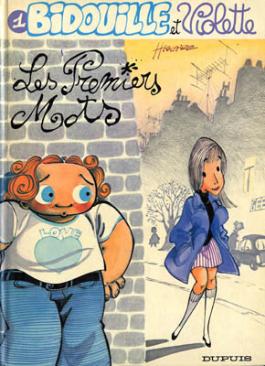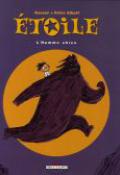Notre père
RÉSUMÉ
Enfant, Thisou a observé timidement son père, un homme impressionnant, dont la colère pouvait sidérer, mais qui expliquait aussi le monde. Son père qui savait décrire le bruit causé par le hérisson, la nuit, et connaissait le nom des arbres. Un homme pieux et exigeant, auprès duquel il n’était pas facile de trouver sa place. Alors sa fille a regardé, minutieusement, tout ce dont ses sens pouvaient se saisir, palliant ainsi la difficile expression au sein de sa famille. Elle a enregistré les plis du pantalon paternel, le cliquetis des épingles de sa mère en train de coudre, la répétition des motifs d’une robe. Échappant ainsi à l’austère vie quotidienne, l’enfant a vu se révéler tout un monde de formes, de couleurs et de sensations, la promesse d’une vie plus pleine s’offrir.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Thisou
Autrice et illustratrice de Notre père
Pseudonyme de Thisou Dartois Née le 23 janvier 1970 à Dinant
Illustration, Saint-Luc, Liège Illustration, Arts décoratifs, Strasbourg
Ma technique : collages de papiers japonais, de papiers d'emballage trouvés ci et là. mélange de feutres, crayons, acryliques. Monotype sur papier de soie. Je travaille en ce moment le tissu amidonné et la broderie. Mes thèmes : l'ailleurs, le voyage, le voisinage, l'autre et sa différence. Ma méthode : je peux très bien commencer par un découpage puis réaliser les images. J'aime aussi me plonger dans les images et ensuite les articuler, les rythmer autour d'un texte. Lauréate d'une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide à la création, 2007

NOS EXPERTS EN PARLENT...
Le Carnet et les Instants
Thisou se souvient. Dans cet album illustré de petit format, elle mêle broderie et dessin pour faire revivre des souvenirs d’enfance fugaces, mais qui ont laissé chez elle une trace vive.Par évocations, sous forme de textes courts, elle dresse le portrait d’un père à la dévotion catholique parfois pesante, aux colères fulgurantes, à la droiture sans faux pli, propre comme un sou neuf. Mais c’est le même père qui lui fait découvrir la forêt, lui apprend le nom des arbres et lui transmet « le plaisir à ressentir et contempler ». Le texte, concis et pudique, calligraphié sur des pages illustrant la mémoire visuelle de l’enfance de l’auteur, laisse percevoir sans trop la dévoiler l’histoire familiale. On y découvre, pêle-mêle, portraits…