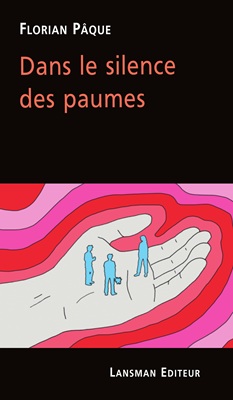
Dans le silence des paumes , la dernière pièce en date de Florian Pâque (qui…
Donner la parole à des pères, recueillir leurs témoignages, sentir leurs voix se briser ou la colère les emporter, être témoin de toutes ces histoires, parfois si banales mais pourtant toutes si particulières… tel est le projet que Julie Annen a entrepris après s’être replongée dans sa propre enfance, son propre rapport à cet homme qui faisait pleinement partie de son entourage et pourtant qu’elle avait – et a encore – l’impression de mal connaître. Convaincue que ces paroles, aussi anodines qu’elles puissent paraître, faisaient écho en chacun de nous et s’avéraient finalement universelles malgré les origines très différentes de ceux qui les prononçaient, elle a décidé d’en réunir un certain nombre dans cet ouvrage, puis de les mettre en scène. En espérant que le lecteur aura autant de plaisir et d’intérêt qu’elle à les découvrir, et que d’autres créateurs manifesteront le désir de les faire partager à travers les formes d’expression les plus diverses.
Auteur de Les pères
"De là d'où je viens quatre noms suffisent pour ne pas se perdre: ceux des trois montagnes et du lac qui entourent la vallée. Depuis neuf ans que je vis à Bruxelles, il m'arrive encore d'hésiter sur la direction du métro quand je monte à bord. Et pourtant, depuis tout ce temps, j'ai mis au monde un premier fils qui connait le plan de la STIB par coeur, vu des spectacles aux quatre coins de la ville, mis en scène six pièces à droite et à gauche, fait quatre ans d' études à l'INSAS en déménageant presque une fois par an, mis au monde un deuxième fils qui part toujours dans la direction opposée à la mienne et acheté une carte du Bruxelles cyclable pour rouler en vélo. Peut-être est-ce pour cela que je suis heureuse ici: une ville où l'on se perd nous oblige à rester toujours en éveil, attentif et curieux du monde qui nous entoure."
Julie Annen est originaire de Genève. Née en 1980, elle passe son enfance en Suisse, avant de s’installer à Bruxelles pour suivre, de 2001 à 2005, les cours de mise en scène et techniques de plateau à l’Institut National Supérieur des Arts du spectacle (INSAS), dont elle sortira diplômée.
C’est logiquement en mise en scène qu’elle fait ses premières armes théâtrales : en 2005, La Sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari (spectacle primé à Huy en 2006, et qui tournait encore en décembre 2009) ; en 2006 Eros Medina de Thierry Debroux ; en 2007, Histoires d’hommes de Xavier Durringer, etc.
Elle assure également, en parallèle, sur différents projets, les rôles d’assistante, assistante à la mise en scène, chargée de production, etc.
Par nécessité d’abord, par goût ensuite, Julie Annen se lance dans l’écriture dramatique, tout en poursuivant son travail de mise en scène.
Elle s’attaque d’abord à la traduction et à l’adaptation (La Tempête de Shakespeare, Messieurs les enfants de Daniel Pennac) puis s’engage dans une écriture originale avec Ceux qui courent, créé à Lausanne en 2009.
Elle est par ailleurs co-fondatrice de la compagnie PAN ! (www.panlacompagnie.org), née en Suisse et basée à Bruxelles, qui est active dans le secteur jeune public.
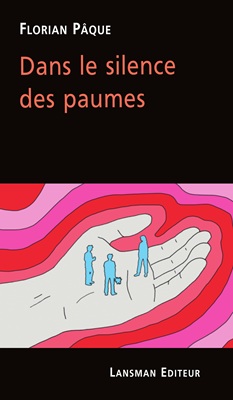
Dans le silence des paumes , la dernière pièce en date de Florian Pâque (qui…