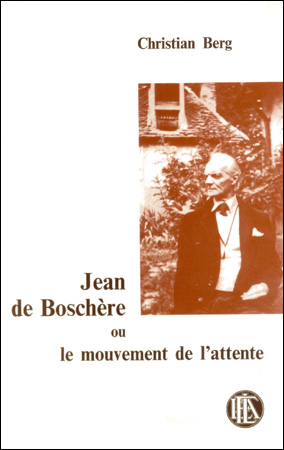L’autoédition, – un vivier pour les éditeurs ? – Entretien avec Laure Prételat
Difficile de passer à côté du phénomène : l’autoédition en ligne connaît un véritable essor depuis la fin des années 2000, porté par le succès d’auteurs lancés sur internet (Hugh Howey, E. L. James, Agnès Martin-Lugand, John Locke, etc.) et par la montée en puissance de plateformes dédiées à cette activité (Lulu, Kindle Direct Publishing, Smashwords, Wattpad, Kobo Writing Life, Authors Solutions, etc.).
Difficile de passer à côté du phénomène : l’autoédition en ligne connaît un véritable essor depuis la fin des années 2000, porté par le succès d’auteurs lancés sur internet (Hugh Howey, E. L. James, Agnès Martin-Lugand, John Locke, etc.) et par la montée en puissance de plateformes dédiées à cette activité (Lulu, Kindle Direct Publishing, Smashwords, Wattpad, Kobo Writing Life, Authors Solutions, etc.).
Toute une industrie de l’autoédition se développe actuellement, mais la vision d’un marché totalement extérieur au secteur éditorial est à relativiser, puisque des éditeurs se sont emparés de cette problématique et récupèrent régulièrement des auteurs dont la notoriété s’est construite en ligne.

Retrouvez également l’article de Louis Wiart, « L’édition sans éditeurs », qui complète cet entretien, sur le site du PILEn !
À quelques jours du prochain Apéro du numérique consacré à cette thématique, nous avons interrogé Laure Prételat, fondatrice de Librinova, un service d’autoédition en ligne passé par l’incubateur de start-up du Labo de l’édition à Paris, qui propose de faire le lien avec le monde de l’édition traditionnelle.

Quelles sont grandes tendances qui irriguent aujourd’hui l’industrie de l’autoédition ?
L’autoédition est un secteur en plein boom en France depuis 2013. Le secteur attire aujourd’hui aussi bien des start-up que d’autres acteurs du marché, à travers des modèles très variés, qui vont des outils d’écriture en ligne jusqu’à des plateformes de promotion d’auteurs en passant par le crowdfunding. De leur côté, les éditeurs sont de plus en plus attentifs à ce qui se passe et s’engagent dans des partenariats afin de tester ce nouveau marché, à l’instar des éditions Harlequin qui ont organisé un grand concours d’écriture avec ma société, Librinova, en 2014.
En termes de genres, la fiction est très largement dominante et, au sein de la fiction, la romance, les thrillers et la fantasy sont surreprésentés. Les formats courts (nouvelles, romans courts) ont également la cote.
Ne peut-on pas dire qu’il existe plusieurs types d’autoédition, qui répondent finalement à des objectifs assez différents ?
Tous les auteurs qui passent par l’autoédition n’ont en effet pas les mêmes objectifs. De façon assez schématique, on peut distinguer trois principaux types d’auteurs autopubliés :
— Les auteurs déjà publiés et reconnus, dits auteurs « hybrides » : on a vu aux États-Unis des auteurs très connus s’emparer du phénomène de l’autoédition, avec pour objectifs d’innover, de s’affranchir des contraintes et de conquérir de nouveaux lecteurs via ce nouveau canal de publication. Ce n’est pas encore le cas en France : si des auteurs publiés de façon traditionnelle se tournent parfois vers l’autoédition, c’est souvent parce que leur texte a été refusé par leur éditeur, ou que leur éditeur « papier » a fait faillite et qu’ils souhaitent faire vivre leurs écrits.
— Les auteurs « inconnus » qui souhaitent partager leurs écrits avec leur famille et leurs amis. Ce sont les auteurs « témoins » : ils ne cherchent pas à faire des ventes importantes, ils souhaitent avant tout être accompagnés dans leur processus de publication et rendre leurs écrits disponibles pour leurs proches en papier et en numérique.
— Les auteurs « inconnus » qui souhaitent que leur livre soit lu par la population la plus large possible et dont le rêve est souvent de se faire repérer par un éditeur traditionnel : je pense que c’est la catégorie d’auteurs la plus large, la catégorie des « auteurs-entrepreneurs ».
Dans ce contexte, comment se positionne Librinova ?
Librinova s’adresse à tous ces auteurs pour leur permettre de diffuser largement leur œuvre, grâce à une offre transparente et professionnelle. Nous aimons nous définir comme un site « d’autoédition accompagnée », car l’expérience nous a montré que, dans la « jungle » de l’autoédition, les auteurs avaient souvent besoin qu’on les guide !

Notre offre se décompose en trois parties. Le socle, c’est notre « formule publication », qui permet à chaque auteur de créer en quelques clics son livre numérique à partir de son fichier Word et de le commercialiser sur plus de quatre-vingt-dix librairies en ligne, au prix qu’il a choisi. Notre diffusion est la plus large du marché et couvre toutes les grandes e-librairies. Cette formule coûte à l’auteur 50 ou 75 € (en fonction de la taille de son manuscrit) et il touche 100 % des revenus nets de ses ventes, qui lui sont reversés deux fois par an.
Librinova permet également aux auteurs d’avoir un accès à la carte à tous les services que pourrait leur offrir une maison d’édition : correction, couverture, impression, services promotionnels… Ces services sont tous réalisés par des professionnels de l’édition qui travaillent par ailleurs pour de grandes maisons. L’idée est d’aider chaque auteur à se professionnaliser et à avoir le manuscrit le plus abouti qui soit, en fonction de ses besoins.
Enfin, la grande spécificité de Librinova est de considérer le livre numérique comme un tremplin vers l’édition traditionnelle et le livre papier. En effet, quand un livre publié chez nous est plébiscité par les lecteurs, c’est à dire s’il est vendu à plus de mille exemplaires, l’auteur intègre notre programme « En route vers le papier ». Nous devenons alors son agent et allons présenter son manuscrit à des éditeurs afin de lui permettre de signer un contrat d’édition « classique ».
Quel est le profil des auteurs qui passent par vos services ?
Il est difficile de déterminer un profil type de l’auteur Librinova tant nos auteurs sont variés ! Tous les profils décrits plus haut sont représentés : l’auteur connu qui autoédite certains de ces livres et publie les autres dans l’édition traditionnelle (nous avons par exemple publié Merde à la déprime de Jacques Séguéla), l’auteur « témoin » qui cherche surtout à partager son livre avec ses proches ou encore l’auteur qui cherche à toucher le maximum de lecteurs dans l’espoir de décrocher un contrat avec un éditeur.
Aujourd’hui, nous avons une petite majorité d’auteurs masculins, alors que nous savons qu’il y a plus de femmes qui écrivent. Peut être ces dernières ont-elles un peu plus de difficulté à passer le cap de la publication, à rendre leurs écrits publics ?
Nous avons également des auteurs de tout âge : du jeune étudiant au sénior qui écrit pour le plaisir ou pour laisser un témoignage à ses petits-enfants. Les plus dynamiques en termes de promotion ne sont pas toujours ceux qu’on croit : nous avons des séniors extrêmement doués en terme d’autopromotion !
Le point commun de nos auteurs est que, s’ils ont envie de se lancer dans l’aventure de l’autoédition, ils souhaitent aussi le faire de façon professionnelle et donc être soutenus. C’est pourquoi ils se tournent vers nous.
Est-ce que vous avez un auteur ou un livre qui commence à rencontrer du succès ?
Oui, tout à fait, nous en avons même plus d’un ! Lorsque nous nous sommes lancées, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir un grand nombre de manuscrits de qualité, qui ont ensuite rencontré un vif succès auprès des lecteurs. Ainsi, en à peine quelques mois, nous avons déjà huit auteurs qui ont vendu plus de mille exemplaires et sont donc entrés dans le programme « En route vers le papier ».

Notre plus belle histoire à ce jour est celle de Marilyse Trécourt, auteur d’Au-delà des apparences, publié en août dernier. Il s’agissait de son premier roman et elle se lançait sans avoir vraiment d’attentes. Il s’est aujourd’hui écoulé à plus de deux mille cinq cents exemplaires numériques et sera publié d’ici la fin de l’année par un éditeur prestigieux. Dans un genre très différent, le Petit Guide de la drague par sms, qui a connu un très beau succès dans sa version numérique, paraîtra en librairie le 18 juin dans la collection « Petit livre de » des éditions First. Quant au titre le Défilé des vanités, qui est toujours publié en numérique chez Librinova, son auteur a signé un contrat d’édition avec les éditions Points (Le Seuil) et le livre est paru directement en format poche en février 2015. Nous avons actuellement quatre autres contrats en cours de négociation avec des éditeurs.
Globalement, le bilan est très positif : les lecteurs sont enthousiastes à la perspective de découvrir de nouveaux auteurs, et les éditeurs de les publier lorsque le succès numérique est au rendez-vous… Bref, Librinova remplit son rôle « d’entremetteur » entre les auteurs et les lecteurs puis les auteurs et les éditeurs !
Retrouvez également l’article de Louis Wiart, « L’édition sans éditeurs », qui complète cet entretien, sur le site du PILEn !