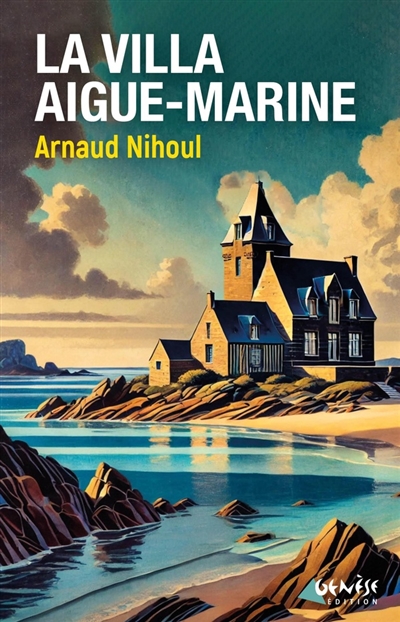
Au décès d’Alice Terneuve, Alistair, journaliste et auteur de carnets de voyage écossais,…
Auteur de La notification
Né le 30 mars 1958 à Ixelles.
Licencié en Philologie romane à l'Université libre de Bruxelles. Professeur de français à l’Athénée Fernand Blum de Schaerbeek
Mes romans s'inspirent de la vie, du quotidien; ils parlent de moments et d'êtres qui nous rencontrent tous. Je travaille le matin. J'écoute le silence et c'est de lui que naissent mes mots, dans l'ouverture que je peux avoir sur le monde. Et, quand j'ai fini mon premier jet, je relis, je relis et je relis encore.
Lauréat d'une Bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2008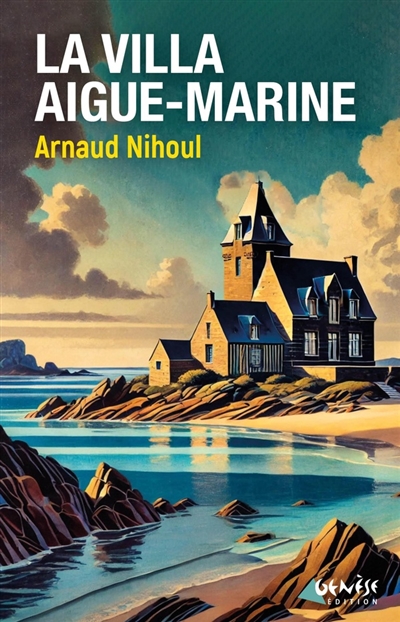
Au décès d’Alice Terneuve, Alistair, journaliste et auteur de carnets de voyage écossais,…