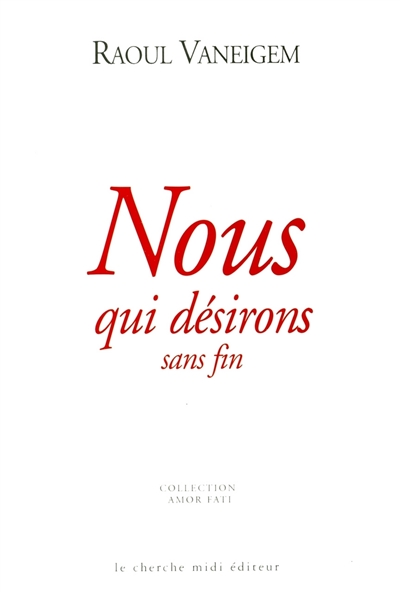
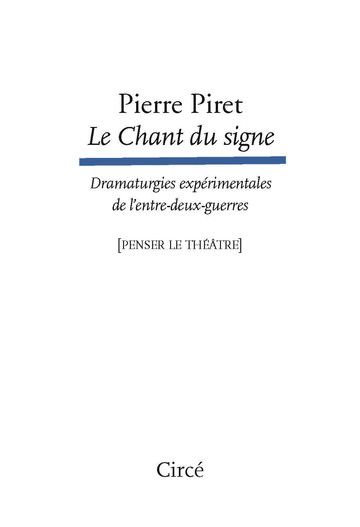
Le chant du signe : Dramaturgies expérimentales de l’entre-deux-guerres
Pierre PIRET , Le chant du signe. Dramaturgies expérimentales de l’entre-deux-guerres , Circé, coll. « Penser le théâtre », 2024, 210 p., 24 €, ISBN : 978-2-84242-510-4 Nonobstant le fait qu’ils ont produit leur œuvre pour l’essentiel dans l’entre-deux guerres, que peuvent avoir en commun des dramaturges aussi différents que Fernand Crommelynck, Paul Claudel, Michel De Ghelderode, Jean Cocteau, Roger Vitrac, Henry Soumagne, Guillaume Apollinaire ? Si l’on se réfère aux études existantes, seules quelques analogies très partielles sinon superficielles ont été mises en lumière. Or, malgré sa brièveté, cette période fut marquée dans les domaines tant musical que plasticien et littéraire par une forte volonté des créateurs de mettre en question les codes établis – notamment ceux du théâtre de boulevard – et d’innover sans craindre de provoquer. Cette volonté s’étant exprimée dans un grand désordre apparent, sans qu’on puisse la ranger dans le tiroir « avant-gardes », c’était une gageure d’y reconnaitre une logique commune et, à fortiori, de détailler les rouages d’une telle logique. Voilà le défi que vient de relever brillamment Pierre Piret, professeur au Centre d’Études théâtrales de l’UCLouvain, en s’appuyant sur la panoplie conceptuelle de la psychanalyse lacanienne – on voit mal, tout compte fait, quelle autre grille d’analyse aurait pu convenir à la tâche. Déjà naissante avant la guerre de 14-18, une prise de conscience s’est progressivement répandue et amplifiée chez les dramaturges concernant le système et les fonctions du langage verbal. Loin de se réduire à un outil docile d’expression et de communication, celui-ci impose sa loi différenciatrice et structurante à l’ensemble de l’activité psychique et, par là, permet rien de moins que la genèse de la pensée. De cette primauté fondamentale résultent trois grands effets aliénants. D’abord, la langue est léguée à l’enfant par ses prédécesseurs : les seuls mots disponibles pour s’identifier et s’exprimer sont venus de l’Autre. Chacun à leur manière, Crommelynck, Ghelderode et Vitrac ont illustré cette altérité dans Le cocu magnifique, Pantagleize, Victor ou les enfants au pouvoir et plusieurs autres pièces. Une deuxième contrainte résulte de ceci que les mots forment un système clos sur lui-même et radicalement incomplet ; ainsi le sujet est-il entrainé dans une chaine infinie de renvois sans origine ni aboutissement. Les pièces de Claudel et de Soumagne sont particulièrement déterminées par cette organisation langagière, qu’il s’agisse du Soulier de satin ou de L’autre Messie. Enfin, la parole étant structurellement équivoque, elle fait de l’allocutaire non pas un simple « décodeur » comme on le croyait, mais le véritable faiseur de la signification, amené à se frayer un chemin parmi l’entrelacs de signifiants auquel il est confronté. Préoccupés par ce renversement, Cocteau et Apollinaire ont accordé une place stratégique au mécanisme allocutif dans leurs pièces Les mariés de la Tour Eiffel, La voix humaine, Les mamelles de Tirésias. Au-delà de leur grande diversité, et grâce à un examen extrêmement minutieux, Pierre Piret montre que toutes ces pièces présentent plusieurs points communs. Dans chacune le héros (l’héroïne) suspend son existence à la question de la vérité et joue par là sa propre vie. Partagé entre le rôle qu’il tient et le rôle qu’il désire, il n’entre pas vraiment en conflit avec ses semblables mais s’efforce de les discréditer : devenant incompréhensible à leurs yeux, il s’écarte irrémédiablement du cercle familial ou social. Il s’agit en bref d’une « dramaturgie métonymique », soutenue par une fuite en avant continuelle où chaque solution successivement espérée se révèle illusoire, et où dès lors nul dénouement n’est possible. Rompant avec la tradition théâtrale, les pièces analysées mettent en cause de manière insistante la fonction du mode interpellatif inhérent au théâtre, soulignent l’aliénation qui en est inséparable, en ce compris le rôle du public, et précisent dans ce but les conditions de mise en scène. L’entre-deux-guerres théâtral en langue française n’est donc pas aussi disparate qu’on le croyait. Les pièces étudiées dans Le chant du signe – jeu de mots lacanien ? – reflètent la mutation épistémique majeure amorcée par le linguiste Ferdinand de Saussure et y réagissent par des innovations dramaturgiques très imaginatives. Ceci dit, et c’est regrettable, le livre de Pierre Piret n’est accessible qu’à des lecteurs avertis, de préférence familiers des théories de Jacques Lacan. Mais, après tout, celui-ci ne parlait ni n’écrivait pour le grand public… Daniel Laroche Les stratégies d’expérimentation théâtrale mises en œuvre par Apollinaire, Claudel, Cocteau, Crommelynck, Ghelderode, Soumagne ou Vitrac radiographient, selon l’auteur, une mutation civilisationnelle majeure. Ces innovations dramaturgiques qui paraissent gratuites ou absurdes témoignent en réalité d’une interrogation fondamentale…
