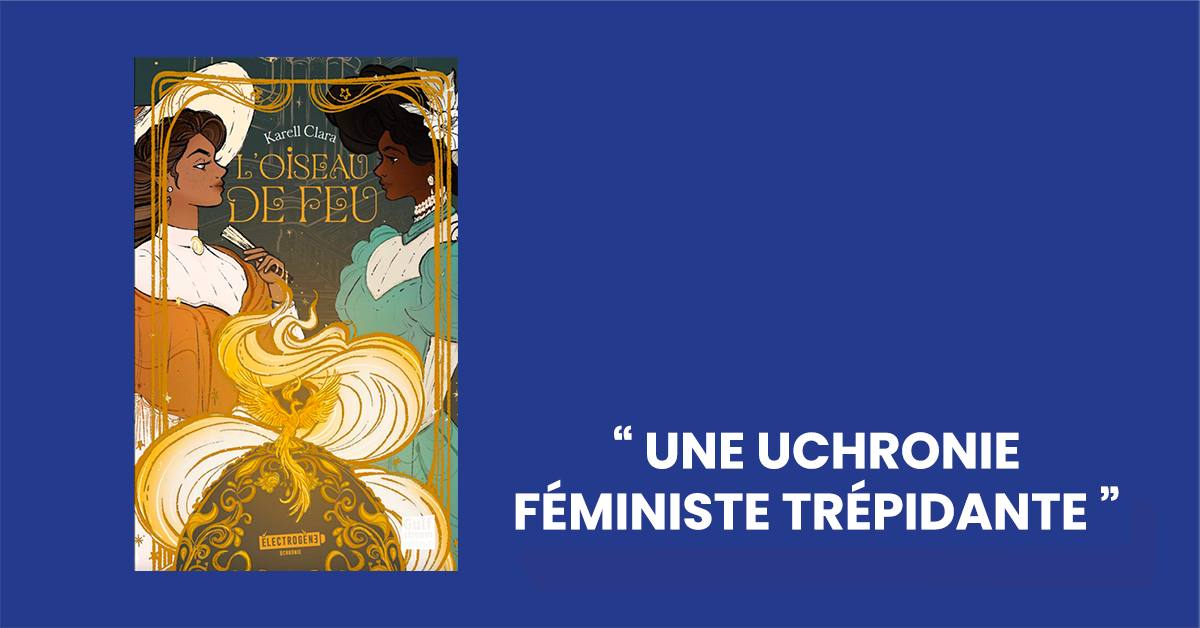
Notre critique de L'oiseau de feu
Une jeune aristocrate que sa tante cherche à marier à un bon parti, un bal grandiose à la cour des Habsbourg, une modiste du nom de « Mme Delacroix »… La bonne société décrite dans L’oiseau de feu n’est pas sans nous rappeler les Chroniques de Bridgerton. Sauf qu’à la différence de la série, j’ai trouvé dans cette uchronie des héroïnes réellement modernes et anticonformistes.
Outre une diversité des représentations – à l’aube du XXe siècle, la France sera bientôt gouvernée par une impératrice métisse qui assume ses cheveux frisés –, Agathe et Laureanne, les deux protagonistes, recherchent une vie qui n’est pas celle qu’on leur a destinée. Et Chacune va se battre pour elle-même, dans une enquête rocambolesque mêlant disparitions et complot politique.
La principale force de ce roman, destiné à un lectorat ado averti, réside dans ses personnages et ses thématiques féministes et inclusives, amenées avec subtilité et justesse.
D’une part, Agathe, aristocrate de 20 ans originaire de la Nouvelle-Orleans et recueillie par sa tante après décès de ses parents, découvre qu’il existe peut-être une existence en dehors du mariage de convenance que lui réserve sa tutrice. Si elle aime les bals, les belles tenues et les potins, elle aspire à la liberté dont bénéficie son frère jumeau. D’autre part, Laureanne, fille d’un couple d’artisans horlogers, rêve d’étudier l’astronomie et de mener sa propre barque, même si cela signifie s’opposer aux projets de ses parents et éconduire un amoureux parfait sous tous rapports. Elle vivra une aventure initiatique qui la fera quitter l’enfance, confrontée à des jeux de pouvoir, mais aussi aux failles de ses proches.
L’autrice nous campe deux héroïnes fortes, au caractère bien trempé, qui prennent leur vie en main et font entendre leur voix, sans gommer leurs faiblesses ni les difficultés qu’elles rencontrent en tant que femmes. Celles-ci doutent, se laissent parfois aller au désespoir et font face à des sentiments et des situations inconnues (vous m’autoriserez bien l’accord de proximité). À cela s’ajoute un panel de personnages secondaires hétéroclites, vivants et bien construits, même quand ils n’apparaissent que très peu.
Si l’univers uchronique constitue finalement une toile de fond discrète à l’enquête menée par les deux héroïnes – la dimension politique et les jeux de pouvoir sont en effet peu décrits –, il permet de traiter de thématiques très actuelles, dans un contexte historique rappelant la Belle Époque. L’autrice dépeint une cour noire et métissée, des amitiés féminines authentiques, des femmes artistes indépendantes et même une romance lesbienne, sans minimiser les obstacles qui se dressent sur la route des personnages : racisme, misogynie, micro-agressions, exigences de son rang (Agathe, à 20 ans, est presque trop vieille pour se trouver un mari). Toute cette ambivalence contribue au mystère qui plane sur cette intrigue. L’autrice manie d’ailleurs très bien les descriptions et dépeint de manière vivante les ambiances les plus diverses : du bayou de la Nouvelle-Orléans aux froufrous de la cour, en passant par un Salon des RefuséEs, version féministe.
Alors, si vous aussi, vous êtes plutôt team Héloïse/ Pénélope – deux personnages des Chroniques de Bridgerton, sans pour autant cracher sur une dose de jupons et corsets, prenez-vous au jeu de cette course contre la montre au dénouement haletant. Mais, un conseil, évitez de lire la 4e de couverture pour profiter de toutes les surprises que recèlent cette uchronie féministe trépidante.
Nathalie Nikis